Né en 1952, j’ai donc eu 65 ans cet été. Ma mère, née en 1923, était de la génération qui aura connu les voitures à chevaux et les voyages sur la lune; les plus grands bouleversements technologiques et sociaux : montée du féminisme, des mouvements de libération nationale, sortie de la société québécoise hors du carcan religieux. Les formes traditionnelles d’autorité et de hiérarchie ont volé en éclats dans la foulée les « 30 glorieuses » années d’après-guerre dans un mélange explosif de croissance économique et démographique accélérée, de laïcisation précipitée des institutions d’éducation et de santé.  La seule décennie des années 60 verra l’émergence d’Hydro-Québec, de la Caisse de dépôt, de l’assurance hospitalisation, du ministère de l’Éducation, du réseau des universités du Québec… Une période de révolution qui a sans doute été d’autant plus tranquille que ses principales victimes avaient fait vœux de pauvreté et d’humilité. (Dominique Laperle, 2015).
La seule décennie des années 60 verra l’émergence d’Hydro-Québec, de la Caisse de dépôt, de l’assurance hospitalisation, du ministère de l’Éducation, du réseau des universités du Québec… Une période de révolution qui a sans doute été d’autant plus tranquille que ses principales victimes avaient fait vœux de pauvreté et d’humilité. (Dominique Laperle, 2015).
L’éclatement, la dissolution du cadre institutionnel catholique a laissé s’échapper ce qui était gardé sous pression depuis trop longtemps. Libres penseurs, artistes et intellectuels sont passés du statut de parias et excommuniés à celui de chantres d’idéaux et modèles de vie. Des communautés de religieuses avaient éduqué les jeunes filles et soigné les malades. Des pédagogues, travailleuses sociales et infirmières qui étaient aussi religieuses.
À 7 ans je voulais me faire prêtre.
À 17 ans, j’étais devenu nationaliste québécois, influencé par la contreculture – un mélange de « flower power » de la côte ouest ´67 et de mai 68 parisien.
À 21 ans, j’étais marxiste-léniniste, dans l’espoir de réunir de manière organisée, démocratique mais centralisée les forces sociales opposées à l’impérialisme américain (nous étions en pleine guerre du Vietnam) et au capitalisme. La lecture de Gramsci et une vision romanesque de la Grande révolution culturelle prolétarienne chinoise nous font imaginer des guerres de tranchées institutionnelles afin de construire, comme « intellectuels organiques », l’hégémonie de la classe ouvrière vers une nouvelle société.
En 1981, à 29 ans, nous mettions fin à l’organisation En lutte ! que nous avions soutenu dans l’enthousiasme et avec ferveur depuis ses débuts, en 1973. Il apparaissait futile sinon impossible de rassembler autour du leadership d’une classe ouvrière en rapide recul (A. Gorz, 1981) les fils multiples, vigoureux et anarchiques des nouveaux mouvements sociaux qu’étaient les mouvements des jeunes, des chômeurs, des femmes, des écologistes, des autochtones… Il semblait préférable de soutenir le développement de ces divers mouvements plutôt que de tenter de les harnacher autour de… de quoi ? De quel programme? Quelles perspectives ? Quel modèle de société? La situation du bloc de l’Est n’était pas particulièrement inspirante. Mieux valait soutenir mille projets épars, quitte à rassembler de manière sporadique les forces autour d’objectifs tactiques. Et le temps allait peut-être permettre de préciser le fameux projet de société.
Thatcher et Reagan au pouvoir, c’était vraiment la fin des 30 glorieuses. Et le début de 30… (affreuses ?) années dominées par le néo-libéralisme conservateur, puis, avec Blair, Clinton, (Bouchard ?), un néo-libéralisme de gauche. Marcel Gauchet (Le nouveau monde, 2017) parle de cette période comme de la déconstruction idéologique du socialisme. Qui précède la chute du mur et la fin du soviétisme. Mais la critique des 30 glorieuses ne venait pas que de la droite. La gauche populaire et communautaire refusait de plus en plus de voir s’étendre encore le pouvoir technocratique des grandes institutions, exigeant le droit à la participation, le droit à la différence. [Certains arguaient que mieux valait laisser l’initiative (et les choix, la planification) à la société, au monde privé plutôt qu’à un État technocratique prétentieux devenu dangereux par la puissance qu’il commandait.] Plusieurs programmes publics s’étaient accumulés par sédimentation, fonctionnaient en silos quand ce n’était pas en contradiction, avec peu d’autonomie locale et peu de souplesse laissées pour s’adapter aux problèmes complexes ou nouveaux.
Le réseau des garderies populaires a résisté longtemps aux offres d’intégration au réseau de l’éducation (à la manière française). Pour garder plus de place aux parents. Mais aussi les réseaux de refuges pour femmes, de maisons de jeunes, de centres de femmes qui ont su se développer durant les années ’80 malgré le discours dominant de l’époque souhaitant réduire l’ampleur de l’intervention publique. L’indépendance par rapport au réseau public correspondait aussi au refus politique de poursuivre le développement de l’intervention publique comme il l’avait fait durant les années 70.
Des réseaux communautaires qui développeront une expertise en complémentarité et parfois en opposition à celle des institutions. Les ressources alternatives en santé mentale étant exemplaires dans leur bataille pour la reconnaissance et l’autonomie en relation dialectique avec la psychiatrie institutionnelle. Des développements sectoriels qui conduiront à une première reconnaissance publique du rôle et de l’importance des ressources communautaires (1992).
Depuis le milieu des années 80 les expériences en développement économique communautaire se multiplient. Les programmes de création d’emploi sont devenus des programmes de développement de l’employabilité. Il faut maintenant former en fonction du marché du travail. Créer des stages en milieu de travail. En particulier pour les populations en difficulté d’insertion. Cela dépend… de la conjoncture, du taux de chômage, des gouvernements, des modes : boutiques jeunesse; clubs d’entrepreneurs; formes plus ou moins subtiles de « workfare ».
En 1996, avec le Sommet sur l’économie et l’emploi, les premiers programmes d’économie sociale (notamment en aide domestique) permettent de consolider un secteur qui vivotait de programmes d’employabilité depuis trop longtemps. Le débat sur l’économie sociale divise la gauche : certains syndicats y voient de la privatisation en perspective alors que certains réseaux communautaires y voient le danger d’assujettissement de leurs missions à des critères de rentabilité économique.
La fin des années 90 et le début de la décennie suivante seront des années fastes en termes de politiques sociales : AccèsLogis, Centres de la petite enfance, Centres locaux de développement, Conférences régionales des élus, Politique de la ruralité, Politique sur l’action communautaire autonome, Loi pour combattre la pauvreté et l’exclusion… (Vaillancourt 2016). Des politiques qui seront, soit freinées ou carrément renversées par les gouvernements libéraux Charest et Couillard des années subséquentes : disparition des CRÉ, des CLD…
Alors que les mouvements djihadistes prennent de l’ampleur après les attaques de septembre 2001, auxquelles riposte une coalition de gouvernements occidentaux, la conscience du danger associé au réchauffement climatique devient plus présente que jamais : les différents rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), en 2001, 2007 puis 2014 sont de plus en plus affirmatifs et alarmants. La Conférence de Paris en 2015 marque un point tournant par l’unanimité avec laquelle l’obligation morale d’agir est reconnue.
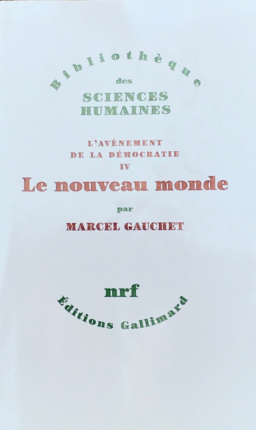 Mais nous vivons dans « une société des individus qui gravite autour des droits de l’homme » (Gauchet, 2017) conduisant à des « démocraties incapables de se gouverner ». Il faudra re-légitimer l’intervention publique et les impôts. Pour cela il faudra « sortir de la seule protection des acquis des uns et des autres » (Favreau 2017, p. 132). Dans son dernier ouvrage, Mouvement communautaire et État social – Le défi de la transition sociale-écologique, Louis Favreau propose de mobiliser autour d’un État social-écologique, seul capable de mettre en œuvre les transformations radicales imposées par l’urgence écologique. Son petit bouquin (160 pages) retrace rapidement l’histoire du mouvement communautaire québécois, distingue les concepts de communautaire, tiers secteur et économie sociale, relate l’émergence de la question écologique et des
Mais nous vivons dans « une société des individus qui gravite autour des droits de l’homme » (Gauchet, 2017) conduisant à des « démocraties incapables de se gouverner ». Il faudra re-légitimer l’intervention publique et les impôts. Pour cela il faudra « sortir de la seule protection des acquis des uns et des autres » (Favreau 2017, p. 132). Dans son dernier ouvrage, Mouvement communautaire et État social – Le défi de la transition sociale-écologique, Louis Favreau propose de mobiliser autour d’un État social-écologique, seul capable de mettre en œuvre les transformations radicales imposées par l’urgence écologique. Son petit bouquin (160 pages) retrace rapidement l’histoire du mouvement communautaire québécois, distingue les concepts de communautaire, tiers secteur et économie sociale, relate l’émergence de la question écologique et des  mouvements récents de résistance (aux gaz de schiste, aux pétrolières) pour conclure sur l’importance d’un New Deal écologique, d’une écologie politique comme troisième utopie mobilisatrice, après celle des droits politiques et civiques et celle des droits sociaux. « On doit considérer la question écologique comme la coordonnée centrale de ce siècle ».
mouvements récents de résistance (aux gaz de schiste, aux pétrolières) pour conclure sur l’importance d’un New Deal écologique, d’une écologie politique comme troisième utopie mobilisatrice, après celle des droits politiques et civiques et celle des droits sociaux. « On doit considérer la question écologique comme la coordonnée centrale de ce siècle ».
Peut-on vraiment imaginer un État providence renouvelé, capable d’imposer un changement drastique des modes de production et de consommation tout en assurant des protections accrues aux victimes du changement ? Le discours de Favreau se situe clairement du côté des mouvements sociaux, des territoires. Il aborde très peu la question des partis politiques. Et au-delà des partis locaux, nationaux ou fédéraux, trop de questions et conditions sont déterminées par un marché mondial sur lequel les sociétés nationales n’ont que peu de pouvoir. Contre l’évasion fiscale, mais aussi contre la transgression des nouvelles règles écologiques que les humains devront s’imposer collectivement, nous devrons développer de nouvelles alliances internationales afin que les politiques économiques, sociales et écologiques qui seront adoptées par nos pays, provinces et villes soient respectées.
Sources :
- Dominique Laperle, Entre Concile et révolution tranquille – Les religieuses au Québec : une fidélité créatrice, 2015, Médiaspaul.
- André Gorz, Adieux au prolétariat, 1981, Seuil.
- Yves Vaillancourt, Marges de manœuvre des acteurs locaux de développement social en contexte d’austérité, 2016, CRISES
- Marcel Gauchet, Le nouveau monde, L’avènement de la démocratie – volume IV, 2017, Gallimard.
- Louis Favreau, Mouvement communautaire et État social – Le défi de la transition sociale-écologique, 2017, Presses de l’Université du Québec.
