Pourquoi les populistes sont-ils si anti-intellectuels? Alors que durant les premières vagues du populisme (1890, 1930) les intellectuels étaient alliés ou parties prenantes du mouvement populiste (Le populisme, voilà l’ennemi !, Thomas Frank). Spontanément certains pourraient penser que c’est normal que les populistes s’opposent aux intellectuels puisque ces derniers semblent souvent mépriser les populistes qui seraient, par définition, incultes ou à tout le moins peu éduqués et facilement manipulables par des leaders retors et peu scrupuleux.
Se faire traiter d’intellectuel est devenu une insulte, au Québec. Ou en tout cas, même les politiciens éduqués ne veulent surtout pas qu’on les prenne pour des intellectuels. Et ne parlons pas des politiciens populistes ! Ils sont passés maîtres dans l’art de titiller ou attaquer les intellectuels pour faire plaisir et mobiliser leurs troupes. Pas besoin d’aller jusqu’à Trump, notre Harper bien canadien s’amusait ferme alors que sa décision d’abolir le « questionnaire long » du recensement avait fait monter au créneau tous les intellectuels du pays. Mais c’est peut-être, finalement, ce qui a causé sa perte !
Les intellectuels étaient avec le peuple, quand il s’agissait de défendre le droit à l’éducation ou à des services de santé. Quand il s’agissait de définir les grands travaux à développer, dans l’intérêt public, pendant la crise des années ’30… ou encore durant la révolution tranquille. À la fin de ces trente années dites glorieuses (1945-1975), les Thatcher et Reagan surent profiter des défauts, lenteurs et de quelques monstruosités qui s’étaient produits pendant les décennies de développement très rapide des institutions d’éducation et de santé, mais aussi des industries de l’énergie, des communications, du transport… pour légitimer une réduction drastique des prélèvements fiscaux sur les grandes fortunes et les revenus élevés. Cela ne put se faire qu’en réduisant le pouvoir d’initiative des gouvernements pour le remettre, le laisser entre les mains des propriétaires et agents du « privé ».
Comme par hasard, la fin de cette période social-démocrate ou progressiste d’après-guerre, période où l’intérêt public et l’accès aux services publics pouvaient encore constituer le cœur d’un programme politique, cette période prend fin alors que l’impact négatif et insoutenable de ce développement très rapide (de l’industrie et de la population) devient évident[1] et aurait demandé une prise en compte accrue de l’intérêt public. Mais c’est plutôt à l’amorce d’une longue période de domination de l’intérêt privé, de laisser-faire et de retrait de l’initiative publique que nous assistons. Le rôle de l’État n’était plus que de soutenir la libéralisation des échanges, qui amenait une pacification des relations internationales en même temps qu’un développement économique des pays « pauvres ».
Les intellectuels d’aujourd’hui sont le produit des gains socio-démocrates des années d’après-guerre. Formés dans les cégeps et universités, mais aussi sur le tas, dans les labos et les usines, les studios et les bureaux. Piketty, dans Capital et idéologie, a suivi l’évolution du soutien électoral accordé aux partis socio-démocrates, qui passe de la classe ouvrière à celle des « éduqués ». Des éduqués parmi lesquels l’auteur identifie deux camps : la droite marchande et la gauche brahmane. Deux camps qui se partagent et se disputent la gestion de l’appareil gouvernemental. Les éduqués ayant profité de l’accès plus démocratique à l’éducation supérieure gagné par la classe ouvrière dans la période de l’après-guerre et la révolution tranquille au Québec, se sont créé de belles niches dans les appareils, organisations et institutions. Ils ont fait le pari du libre-échange… puis de la financiarisation de l’économie. Ce n’est pas que les éduqués ou les intellectuels avaient vraiment le choix, ou le pouvoir de décider. Ceux qui décidaient n’étaient pas obligatoirement éduqués, ni nécessairement intellectuels. Certains étaient seulement riches.
Les intellectuels ont-ils trahi la classe ouvrière et le peuple ? C’est ce que défendait déjà en 1995 Christopher Lasch dans La révolte des élites et la trahison de la démocratie. Mais c’est beaucoup demander à une seule génération d’intellectuels d’inventer une nouvelle culture démocratique tout en préservant le meilleur de la culture élitiste d’antan. Aussi les intellectuels ont-ils sans doute simplement été… achetés. Ils ont suivi leurs intérêts immédiats personnels (ou corporatistes-professionnels) sans se préoccuper de l’intérêt public. Pourquoi auraient-ils à s’en préoccuper plus que les autres ? Mais parce que c’est leur rôle de réfléchir, de connaître, de prévoir. D’imaginer, de dire, de prédire. Ici il faudrait faire des distinctions entre intellectuels, éduqués, élites, dirigeants, décideurs, gestionnaires… Mais tous (ou presque) ont été subjugués par le néolibéralisme et ses richesses, sa facilité, ses libertés (Populisme et néo-libéralisme. Il est urgent de tout repenser, de David Cayla). Les limites qui commençaient à se manifester dans le champ des possibles n’étaient que des défis à relever, des opportunités d’affaires.
Les intellectuels d’aujourd’hui ont été formés par les intellectuels d’hier. Mais ils se sont aussi formés dans leur opposition aux dogmes et croyances d’hier. Ils poursuivent avec passion la construction d’édifices et de théories qu’ils partagent dans des chapelles et colloques. Persuadés qu’ils sont de contribuer à façonner, orienter l’action des humains dans le monde. Oui la science, la technologie, l’art sont des champs où excellent les intellectuels. Mais la vérité, la beauté ne sont pas encore les valeurs dominantes. La propriété, le pouvoir, l’autorité ont préséance. Les sciences, les technologies, les arts se sont développés trop souvent en réduisant les autres à un rôle passif de public, de consommateurs, de profanes qui doivent se fier aux experts et aux professionnels.
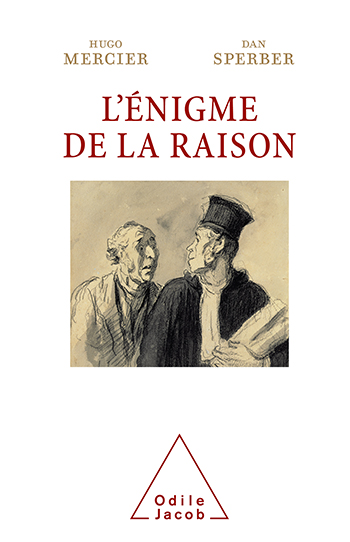
La logique de l’expertise s’oppose trop souvent aux savoirs tacites, intuitifs et non-verbaux. Les intellectuels de demain, moins verbomoteurs et plus à l’écoute, reconnaîtront la primauté de l’intuition sur la raison, et l’importance de la discussion, de l’opposition des idées et arguments pour faire émerger l’intelligence d’une situation. (L’énigme de la raison, H. Mercier)
Mais pour cela il faut que les parties se respectent suffisamment pour s’écouter.
Pourquoi les populistes sont-ils de droite ?
Même si on a pu voir quelques exemples d’une stratégie populiste de gauche (Espagne, Grèce) théorisée par Chantal Mouffe (Pour un populisme de gauche) la plupart des leaders populistes sont de droite, de Le Pen à Trump, à Duhaime et Poilièvre ou Orban (Hongrie) et Erdogan (Turquie). Pourquoi cela ?
Peut-être parce qu’il est plus difficile de mobiliser le peuple tout en construisant la démocratie (principe essentiel du populisme de gauche, selon Mouffe) plutôt qu’en la démolissant (Entre populisme et élite, le populisme de droite, par Frédérick Guillaume Dufour); plus facile de flatter les préjugés que de les corriger…
Justement, parlant de corriger les préjugés, d’éduquer le « peuple » dans le respect des différences, des identités, des subtilités et susceptibilités… il est facile de tomber dans le mépris et la bienséance.
« [T]ous les mouvements populistes authentiques ont visé à rassembler les travailleurs par-delà les barrières de race, de religion et d’ethnicité. (…) C’est l’un des objectifs traditionnels des mouvements de gauche depuis le 19e siècle. Mais ça n’intéresse pas particulièrement les prophètes de l’opprobre qui composent la gauche moderne. »
Thomas Frank, Le populisme, voilà l’ennemi ! p. 308)
« Une politique sans joie, une politique de la réprimande c’est là tout ce que ce centrisme nous a laissé : une politique de la vertu individuelle qui ne considère pas les gens comme une force à mobiliser mais comme une menace à blâmer et à discipliner. »
idem, p. 328
C’est parce que la gauche s’est repliée sur elle-même que la droite a pu prendre le devant de la scène. Scène qui s’adresse au peuple plutôt qu’à la chapelle.
Lorsque l’extrême-gauche s’est sabordée, au début des années ’80, alors qu’il aurait fallu accentuer la critique du néolibéralisme qui triomphait aveuglément, c’était pour mieux plonger, participer aux luttes des nouveaux mouvements sociaux (femmes, jeunes, autochtones, écologie, nouveaux médias…) que la « classe ouvrière » avait bien de la peine à suivre, alors qu’elle aurait dû les diriger ! En tout cas c’est le sens que les militants d’En Lutte, dont j’étais, ont donné à la dissolution de leur organisation politique.
On peut dire que nous avons réussi : nos énergies ont été investies dans la création de réseaux, d’organisations populaires, professionnelles ou civiques, dans la poursuite de réformes utiles et novatrices. Mais la réunion de toutes ces forces dispersées, que nous imaginions pouvoir réaliser « au besoin », ne s’est jamais vraiment produite. Au contraire, les intérêts des uns semblent s’éloigner toujours plus des autres, les différences se multiplier, s’accroître. Si des rassemblements larges ont pu parfois se créer, c’était ponctuel : manif contre tel traité de libéralisation des échanges (et de réduction de la souveraineté des États); journée pour la Terre…
La construction d’une alliance des forces populaires n’est pas l’affaire d’une négociation autour d’une déclaration ou d’une manifestation. Il faut négocier des équivalences entre les valeurs et désirs portés par différentes fractions populaires. C’est la négociation de ces « chaines d’équivalences » (Mouffe) qui permet de « construire le peuple », le peuple des opposants à l’oligarchie des pouvoirs oppressifs.
Pour pouvoir tricoter ces « chaines d’équivalences » les uns doivent descendre de leur piédestal, d’autres doivent oser s’affirmer, s’exprimer, s’engager. Quand les intellos, ces hommes et femmes de tête, auront compris que la raison n’est qu’une justification, après coup, de l’intuition, ils porteront plus d’attention à ce savoir tacite, cette intelligence du corps et du cœur, qui ne s’exprime pas toujours par des mots. Cela devrait faciliter l’expression, même maladroite et peu assurée, des porteurs de sens et de rêves qui ont peu de mots mais beaucoup de vécu.
Après 40 ans de développement néolibéral débridé, où le succès à court terme et le retour maximal aux investisseurs dictaient la loi, il faut revenir à plus de prudence et de planification. Au-delà de la planification, c’est la capacité d’agir dans l’économie qui doit être regagnée par les États. Le New Deal ou la course à la lune aux États-Unis, ou encore la révolution tranquille au Québec sont de bons exemples de cette capacité à regagner. Elle ne se fera pas sans que certains aient l’audace d’imaginer un autre monde.
Oui, bon. Mais demain, pour qui je vote ? Pour celle ou celui qui sera plus à même de rassembler les forces démocratiques (sociales, économiques, culturelles) dans une aventure historique déterminante : le business as usual n’est plus possible.
[1] Si j’avais été « cheikh » du pétrole en 1972, au moment de la publication de Limits to growth, alors que l’essence se vendait 10 cents le gallon, je me serais empressé de pousser le prix du pétrole au maximum, en présumant que mes clients s’affaireraient bientôt à réduire drastiquement leur consommation de ce produit nocif.

