Réaction spontanée (et échevelée) au billet Write the Docs et réflexions sur les plateformes d’En commun? de Benjamin Allard, sur En commun.
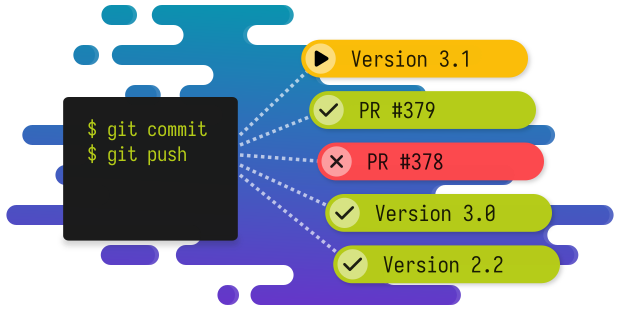
Write the Docs : un blog de documentalistes passionnés.
le paradigme du document (extrait)
« À Projet collectif, nous défendons l’idée comme quoi il faut modifier notre rapport collectif à la production de savoirs, afin de tendre vers un nouveau paradigme où les savoirs sont ouverts par défaut.
- – Lorsque vous créez un nouveau document dans votre traitement de texte, vous ne vous demandez pas toujours si une partie des savoirs que vous prévoyez y consigner pourraient plutôt être créés de manière ouverte pour bénéficier à d’autres.
- – Lorsque vous avez beaucoup d’informations ou de connaissances à consigner et à diffuser, il vous vient plus naturellement l’idée de créer un document avec une table des matières qu’une base de connaissances ouverte sur le web.
- – Vos collègues vous regarderaient avec de grands yeux si vous leur proposiez de repenser la manière d’organiser votre production de savoirs de manière à privilégier les bases de connaissances ouvertes. »
Des bases de connaissances ouvertes, donc.
Mais vise-t-on le paradigme du document ou de la documentation, comme le suggère Benjamin Allard dans son billet Write the Docs et réflexions sur les plateformes d’En commun? Ce que j’entends dans ce passage d’un paradigme à l’autre (du document [même comme base de connaissance] à la documentation), c’est le mouvement, la participation, la transformation de la connaissance.
De là mon malaise avec la conception de la collaboration autour d’un document (avec l’importance accordée aux versions, à la propriété) comme un travail visant à créer le document parfait, le plus adéquat, le plus fidèle ou efficace… c’est peut-être souhaitable pour un guide de l’usager d’un logiciel ou un recueil de textes pour un cours au cégep…
Alors que, dans le domaine social plutôt que du codage numérique, les documents sont fluides, ils se répandent et se transforment comme des tendances, des rumeurs, formant courants et évènements !
J’ai bien aimé la page sur l’Enquête conscientisante et ses références à l’éducation populaire. Le retour à l’enquête de Marx… oui mais John Dewey aussi aurait pu être inspirant. Mais le contexte syndical…
Entre la position syndicale de négociation sur un terrain délimité par le travail produit ou l’activité rémunérée et la position du « public » (celle de Dewey) qui peut évaluer le produit, définir ses attentes, ses besoins… Et l’action militante, communautaire ou civique, souvent liée, ancrée dans un territoire, à une communauté, cette dernière action se situe à mi-chemin entre le public et le syndicat.
En tant qu’usagers individuels, nous avons peu de prise sur les processus et décisions de Projet collectif. Est-ce que les membres corporatifs ou les collectifs-communautés en ont plus ? J’en doute même si, entre professionnels engagés dans les efforts de documentation et gestion des savoirs, les échanges ne se limitent pas aux espaces En commun. Chaque équipe, responsable de la doc dans les grandes et moyennes organisations a son bagage, ses principes… mais surtout des moyens limités pour des attentes démesurées de la part de ses clients-patrons. Pourtant plusieurs équipes, projets, organisations soutiennent une approche de partage du savoir comme un commun, appartenant à la collectivité de ses utilisateurs-producteurs. Des bases de connaissances ouvertes, peut-être ?
Quelle est la fluidité du savoir que nous désirons partager ? À qui appartient-il, ce savoir ? Qui est habilité à le mettre en oeuvre, le faire servir ? Il ne faut pas se cacher la part d’intérêt qui se joue dans l’accessibilité au savoir. L’intérêt de l’expert ou du professionnel qui a fait de cette « base de connaissances » son carré de sable ! Ou celui de l’organisation qui embauche ce professionnel et incorpore son savoir dans son « branding », son essence. Ou plus simplement dans son produit.
Des connaissances inutilisées cessent vite d’être des connaissances. De là le succès des communautés de pratique. Les utilisateurs de la connaissance s’en parlent… mais ils se parlent aussi, et se connaissent, se comprennent, s’entraident. La connaissance tacite ou la part d’ombre et de silence de la connaissance.
Il y a dans l’action, dans l’engagement social ou politique, une grande part de connaissances tacites et d’intuitions, de préférences et d’attachements. Finalement assez peu de connaissances explicitées, qu’on peut accumuler dans une BdC.
Par ailleurs la multitude de points d’ancrage et de vecteurs d’orientation que constitue la société actuelle nous demande des efforts de liaison et d’interface. Nous avons cru, au départ de l’initiative En commun-Praxis, que cet espace numérique « autogéré » allait contribuer à relier, « interfacer » cette multitude. Mais j’en doute, de plus en plus. La protection du code original et de l’espace commun contre les attaques et le « scraping » des moteurs de recherche semblent plus importants que la fluidité et la circulation de l’information. Si tel n’était pas le cas on se serait préoccupé depuis longtemps de rendre les flux d’infos compatibles avec le « fedivers » ou simplement avec les agrégateurs RSS.
Pourquoi les débats entourant ces questions sont-ils fermés ? Trop compliqué ? Pas le temps de rendre explicite toutes les raisons qui nous motivent ou nous freinent… de consigner l’expertise qui nous oriente ?
Pas le temps, pas les moyens… mais en ouvrant le débat un peu plus, ne pourrait-on mobiliser non seulement sémantiquement mais financièrement différents partenaires. Combien les organisations partenaires investiront-elles au cours de la prochaine année dans leur site, leurs interfaces, leurs « app » ? Et si on y mettait des moyens ensemble pour faire avancer cette fluidité et transparence ?
Ces considérations me semblent bien petites, pour ne pas dire mesquines, devant l’ampleur et l’urgence des menaces que font peser les propriétaires de nos espaces numériques et informationnels. Nous sommes les locataires d’espaces numériques appartenant à des impérialistes qui n’ont pas l’intention de reculer ou de perdre les avantages que nous, utilisateurs de leurs produits et réseaux, leur avons laissé prendre.
Il nous faudra se concerter à plus grande échelle que le Québec pour que notre initiative ait quelque chance de réussir dans la quête d’un espace numérique démocratique indépendant des GAFAM, et du MAGA !
La capacité d’échanger et de retenir la propriété de nos productions, liens et connaissances doit se jumeler à la capacité de mémoire, de référence et de construction : on a vu nos voisins faire disparaître des pans entiers de savoirs. Le prochain dirigeant de droite au Canada ou au Québec pourrait bien effacer lui aussi les infos et connaissances qui lui déplaisent ou contredisent sa vision du monde.
Derrière l’appel à la souveraineté numérique lancé par Cédric Durand et al. (Reclaiming Digital Sovereignty voir aussi mon billet Amazon, « panier bleu » et souveraineté numérique) il y a aussi cet impératif de consigner les datas et savoirs (les « piles publiques ») à l’abris des visées impérialistes et rétrogrades. Le TIESS 2.0, qu’en pensez-vous ? Mais c’est une autre discussion que nous pourrions avoir ici… ou pas.
En terminant, j’aimerais bien discuter un texte de Durand (The Problem of Knowledge in the Anthropocene. Hayekian Environmental Delusion and the Condition of Ecological Planning. 2025). Cet autre texte de Durand (2024), Planning beyond growth: The case for economic democracy within ecological limits j’en ai même fait une traduction en français [grossière au niveau des coupures de page à cause du traitement des PDF par DeepL].
Ce billet est d’abord paru sur mon carnet Praxis : transition, organisation communautaire, développement des communautés, le 23 février 2025
