Dans ce billet je veux surtout revenir sur les livres dont je n’ai pas parlé en 2020 mais qui m’ont tout de même occupé l’esprit. Des livres qui ont passé parfois plusieurs mois sur ma table, auxquels je suis revenu à plusieurs reprises. Ou encore que j’ai lu et relu en cherchant comment je vous en parlerais. Mais il me fallait tout de même revenir rapidement sur les travaux et lectures de l’année dont j’ai tiré les quelques 25 billets1Cette année fut finalement assez productive, plus que 2019 et 2018 où je n’avais publié que 16 billets chaque année. Ce n’est pas la « frénésie » de 2012-2013, où j’ai publié près de 80 billets par an, encore moins celle des années 2008-2009 où le rythme atteignait 150 billets par an ! Pas besoin de vous dire que ces billets n’étaient pas tous élaborés… publiés en 2020, ne serait-ce que pour me replonger rapidement sur les moments forts (ou difficiles) de cette 19e année de publication2Hé oui, je commencerai ma 20e année début février ! sur Gilles en vrac… et pour situer ces dernières réflexions dans leur contexte.
On peut dire que l’année qui vient de se terminer fut propice à la réflexion. Situation de crise globale, économique, sanitaire qui nous a, pendant un moment, fait croire que nous allions saisir l’occasion, collectivement, de changer des choses. Le thème de la transition a été et restera sans doute un axe important (10 ans pour y arriver; petits et grands gestes; beau temps pour la fin du monde; barbarie ou civilisation; une convention citoyenne à la québécoise ?; ce que tous devraient savoir). Aussi un article synthèse sur le tiers-secteur québécois, rédigé pour un colloque qui n’a pas eu lieu (le tiers secteur québécois, un aperçu), et évidemment, plusieurs billets sur et autour de la pandémie : rôle des gouvernements, de la science, des croyances…
J’ai lu et commenté dans mes billets plusieurs livres qui portaient un regard de haut, sur l’avenir, la transition, la nature humaine ou les enjeux de civilisation : Au temps des catastrophes — résister à la barbarie qui vient, Collapsus, Climate Leviathan, The Decadent Society, Une nouvelle terre, The Uninhabitable Earth, Humankind, A Planet to Win, La transition c’est maintenant…
territoire et capital
L’an dernier à pareille date, la fin du premier billet de l’année 2020, 10 ans pour y arriver, je référais à un projet (ou une étude) mené par Dark Matter Labs qui proposait de récupérer une fraction de la croissance de la valeur des immeubles d’un quartier qui ont profité des investissements publics… afin de réduire les impacts négatifs qu’ont aussi ces développements. Une telle approche pourrait-elle être utilisée dans le contexte d’un projet comme le REM de l’Est?
Le développement urbain (ou régional) soumis aux dictats et aux intérêts des grandes entreprises… il faut trouver une autre manière de planifier nos villes et nos régions. Je croyais avoir trouvé une piste, en mettant la main sur Le promoteur, la banque et le rentier, une étude de Louis Gaudreau. Un retour historique édifiant sur le développement, assez récent, du « marché de l’habitation ». L’importance du soutien public a été cruciale pour que les banques « daignent » prêter aux gens qui n’étaient pas déjà riches… La transformation graduelle du « produit » habitation d’un bien d’usage à un investissement, un produit financier. L’auteur conclut sur des pistes telles les fiducies foncières et l’investissement public pour « démarchandiser » l’habitation… mais je n’étais pas satisfait : ce n’était pas la « balle d’argent » que j’espérais.
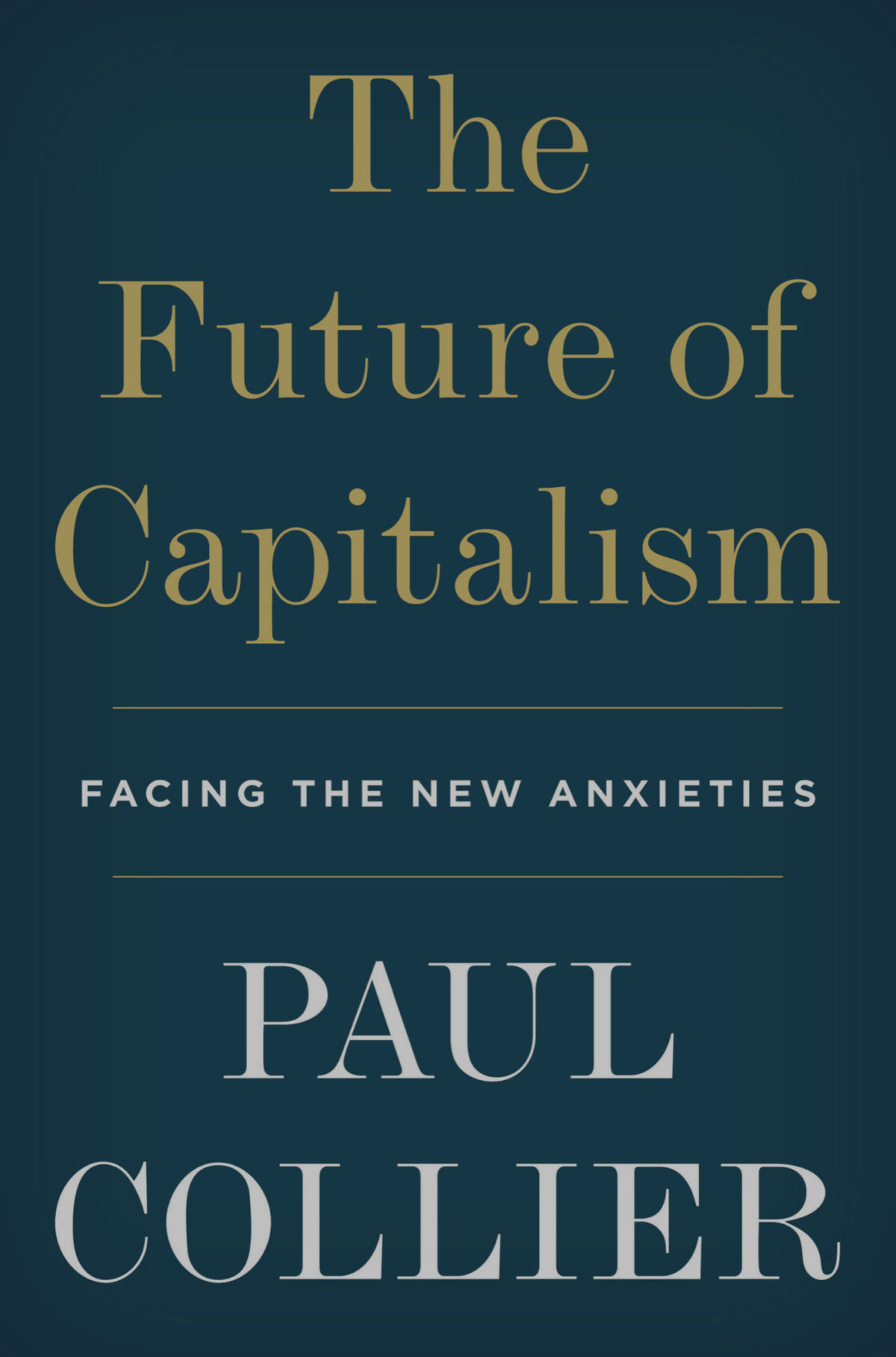
Dans un chapitre de The Future of Capitalism, Paul Collier suggère à propos de l’accroissement exagéré de la valeur des logements, en particulier dans les grandes villes et métropoles, qu’une partie de cette valeur ajoutée devrait revenir aux collectivités. Par ailleurs, dans un chapitre du recueil Our Commons, Ostrom in the City: Design Principles and Practices for the Urban Commons, les auteurs Christian Iaione et Shella Foster s’inspirent d’Ostrom (dont j’ai parlé ici) pour dégager 5 principes (gouvernance collective, État facilitateur, la mise en commun [pooling] économique et sociale, le caractère expérimental et la justice technologique) pour gérer les villes comme des communs, en mobilisant ressources et collaboration de 5 catégories d’acteurs : les innovateurs sociaux, les autorités publiques, le milieu des affaires, les organisations de la société civile et les institutions du savoir.

Mais cette perspective proposée par Foster et Iaione est directement critiquée par Pierre Sauvêtre, dans son chapitre (Le municipalisme des communs contre la gouvernance urbaine collaborative) du recueil de textes Du social business à l’économie solidaire : critique de l’innovation sociale (éd. ÉRES, juillet 2020). « La gouvernance urbaine collaborative correspond à une version faible des communs parce qu’elle ne remet en cause ni les rapports de pouvoir politiques (…) ni les rapports de pouvoir économiques. » Laurent Fraisse dans sa contribution au recueil : Janus et l’innovation sociale nous rappelle à quel point « la société civile n’a plus le monopole de l’innovation sociale ».
Cependant la vision du community organizing présentée par Julien Talpin dans ce même recueil (La force du nombre : un impératif managérial ? Le community organizing travaillé par le tournant néolibéral) est un peu caricaturale et semble surtout servir à dénoncer l’influence de certaines fondations philanthropiques.
Par ailleurs l’ensemble (dont une dénonciation du virage vers l’autoritarisme du « modèle québécois » par Lachapelle et Bourque) propose une perspective critique dans un discours sur l’innovation sociale qui trop souvent donne l’impression que les bonnes intentions et l’agir ensemble viendront à bout de tous les obstacles.
Un autre recueil sur le même thème était paru 16 mois plus tôt, aux PUQ : Trajectoires d’innovation : des émergences à la reconnaissance, sous la direction de Klein, Boucher, Camus, Champagne et Noiseux. « [U]ne vision large de l’innovation, orientée vers le développement économique, mais aussi vers la création d’un écosystème d’innovation où les progrès technologiques et sociaux se croisent et se complètent ». Un tel écosystème « devrait repenser les rapports inégalitaires entre les genres, les populations et les territoires. »
Le compte-rendu d’un riche colloque du CRISES tenu en 2017 rassemblant 28 chapitres regroupés en 9 parties. Laville y faisait une intervention en ouverture du colloque qui annonçait déjà la publication de 2020, dénonçant la récupération du discours de l’innovation sociale par le Social Business et une seconde vague de néolibéralisme qui prétend que le capitalisme peut être moralisé et que l’innovation sociale, grâce aux outils de l’entreprise, pourra mieux résoudre les problèmes sociaux.
Une autre publication récente (janvier 2020) sur un thème corollaire: Intervenir en développement des territoires, par René Lachapelle et Denis Bourque. Le territoire, l’évolution du « modèle québécois de développement », le virage néolibéral des années 2000… En présentant huit démarches de développement territorial les auteurs mettent en lumière la contribution de l’intervention collective à ces processus. De la mobilisation des réseaux institutionnels à l’accompagnement des élus locaux dans leur nouveau rôle de « gouvernement de proximité », en passant par « une philanthropie qui sait faire la différence »… les auteurs identifient des enjeux posés aux intervenants en développement territorial. Un court document (156 pages) dont on aurait aimé qu’il développe un peu plus la présentation des autres réseaux institutionnels que celui de la santé dans leur ancrage territorial… Systèmes locaux d’action et opération en réseaux d’acteurs. Dans un ordre d’idée semblable, je me propose de lire « Un avenir pour le service public – Un nouvel État face à la vague écologique, numérique, démocratique », publié par Sébastien Soriano en novembre 2020 chez Odile Jacob.
Voir aussi, sous la direction de Marc-Urbain Proulx et Marie-Claude Prémont, La politique territoriale au Québec, 50 ans d’audace, d’hésitations et d’impuissance, paru aux PUQ en 2019.
À propos des nouveaux défis posés aux municipalités, sous la direction de Gérard Divay, parus en deux volumes aux PUQ en 2019 : Le management municipal, Volume 1 : Un gouvernement de proximité ? Volume 2 : Les défis de l’intégration locale.
un intellectuel dans la salle ?
La question du rôle, de la responsabilité des intellectuels a été « renouvelée » en quelque sorte récemment avec la montée des populismes anti-élites, glissant facilement vers l’anti-science. Ce qui ne veut pas dire que les intellectuels sont à l’abris des dérives complotistes… comme le soulevait un reportage récent de Radio-Canada sur le fonctionnement du cerveau.
La transparence, la franchise, le partage des savoirs, l’ancrage culturel… la compétence à transmettre, à traduire, à produire la culture sont des qualités, des continuums de qualités auxquels les intellectuels peuvent aspirer ou à l’aulne desquels ils seront mesurés.
Les intellectuels sont-ils toujours militants ? Ou les militants, des intellectuels ?
Ce sont des « maudits intellectuels » quand ils posent trop de questions ou qu’ils se prennent pour d’autres… et des « traîtres » quand ils quittent le Parti ou négligent la Cause. Certains sont idéalistes ou croyants et participent à des mouvements sociaux, des activités charitables ou éducatives, ou de critique et de contestation… Mais peut-être sont-ils assis devant leur écran à consommer des opinions politiques ou des prestations culturelles quand ce n’est pas à redistribuer des vidéos de chat.
La « gauche brahmane » et la « droite marchande » 3Capital et idéologie, p. 933sont ces élites diplômées qui ont remplacé, en alternance, l’influence des syndicats sur les gouvernements socio-démocrates.
Ici nous ne parlons que du temps (relativement) court, depuis l’après-guerre, le milieu du siècle dernier. Mais ces interprétations du rôle de l’intellectuel, à gauche promoteur de droits, de justice, d’accès, ou à droite promotrice de liberté individuelle, de réussite, de découverte… sont des propos et postures beaucoup plus anciens. Des rôles qui, dans le cas du Québec, ont été marqués, polarisés par la fracture nationale-linguistique-religieuse avec une droite marchande très largement dominée par les anglo-saxons canadiens et une gauche divisée entre catholiques et faction libérale-anti-cléricale.

Dans Les intellectuel.les au Québec, une brève histoire, Yvan Lamonde et consort tracent une histoire pas si brève, remontant au XVIIIe siècle avec les débuts de la presse écrite, en tissant la toile des tensions et relations entre l’Église, l’État, les médias. Un chapitre sur les femmes intellectuelles permet de souligner l’apport des fondatrices (1880-1929). Une brève histoire tout de même (160 pages) publiée chez Delbusso — pour moins de 10$ en format numérique. Intéressant de saisir dans leur contexte historique les abbé Groulx, père Lévesque, frère Marie-Victorin ou Marie Gérin-Lajoie, ou ces Parent, Gérin, Montpetit, Laurendeau, Dumont, Vadeboncoeur , Trudeau ou Aquin… Mais aussi de situer ces figures moins connues : Éva Circé-Côté, René Garneau, Fernande St-Martin…
La question nationale et le « cosmopolitisme », les idéaux de liberté, de justice ou d’égalité… la lutte à l’ignorance, à la complaisance ou à l’exploitation, l’anticléricalisme ou le féminisme anti-paternaliste, le syndicalisme, la promotion des arts, des lettres et des sciences sociales… la promotion des compétences scientifiques et de la culture québécoise… les intellectuel.les portent des flambeaux, allument des feux, éclairent des enjeux ou chantent des louanges. Longtemps critiqués (paresseux incapables d’un « vrai » travail productif, i.e. manuel) et vus comme de mauvaises influences aux moeurs débridées, qu’en est-il aujourd’hui ?
« Le départage entre intellectuels souverainistes et fédéralistes a vraisemblablement masqué la rupture gauche/droite pendant plusieurs décennies » souligne Lamonde dans son chapitre le plus contemporain (1970-2015). La formation d’une parole souverainiste à gauche, indépendante de la coalition du PQ, autant que l’expression plus libre d’un nationalisme de droite, ou encore l’ampleur et la profondeur des paroles féministes ou éco-féministes… ont complexifié la scène intellectuelle québécoise même si de vieilles questions, telle la laïcité et la place de la religion dans la cité, continuent d’occuper l’avant-scène. Complexité accrue, comme le reconnaissent les auteurs en conclusion, quand les nouveaux médias entrent en jeu, que les traces et la mémoire (matériau nécessaire à l’analyse) ne sont plus les mêmes.
[Parlant de médias sociaux et de mémoire… le téléchargement pour fin d’archivage (et de preuve) de l’ensemble de la plate-forme Parler qui a servi à préparer et soutenir l’attaque contre le Capitol, le 6 janvier dernier, soulève plusieurs questions mais aussi, peut-être, des avenues de responsabilisation].
Les intellectuels sont-ils toujours des écrivains ou des journalistes ou des profs d’université qui, par définition écrivent, produisent des papiers, un discours écrit ? Mais ces animateurs, « motivateurs », organisateurs syndicaux ou communautaires qui n’écrivent pas beaucoup mais peuvent tout de même « soulever des foules » sont-ils aussi des intellectuels ? Et qu’en est-il de ces psychologues, travailleurs sociaux et psychothérapeutes ? Des « travailleurs intellectuels » certainement, manipulateurs de symboles ou administrateurs de programmes mais pas intellectuels dans le sens de producteurs d’un discours sur la place publique.
Il y a les Grands intellectuels, ceux qui ont publié et qu’on lit… ou qu’on écoute sur YouTube parce qu’ils ont de la notoriété et ceux qu’on rencontre, qui ont lu et rendent accessibles les textes des Grands. L’intellectuel de café, de brasserie ou de la famille… Les mouvements sociaux ont besoin d’intellectuels pour formuler, justifier leurs objectifs, leurs exigences. Quand ces mouvements fondent des partis, ou des institutions, leurs intellectuels deviennent fonctionnaires ou consultants. D’autres intellectuels prendront parole ou contesteront à la frontière ou dans les corridors de ces institutions.
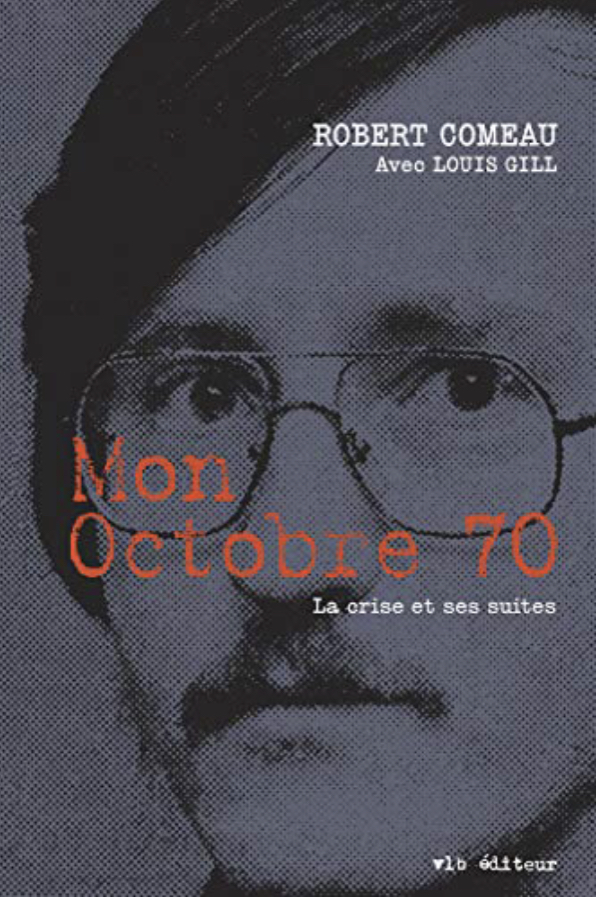
Il y a ces jeunes intellectuels qui n’ont pas encore publié mais qui participent à un moment historique dont ils peuvent témoigner, plusieurs décennies après coup, comme le fait Robert Comeau dans Mon octobre 70. Une certaine histoire du FLQ et de la Crise d’octobre, mais aussi une histoire de trahison, de silence honorable et de révélation nécessaire. Un récit très personnel qui amènera ceux qui ont connu l’époque à se demander « Où donc étais-je en octobre 1970? »
Je réserve ma réponse à cette question pour un autre billet…

Et ces intellectuels de gauche, dont François Saillant trace une Brève histoire de la gauche politique au Québec ? Là je me reconnais un peu mieux dans le portrait des groupes de gauche des années ’70, ’73 pour être précis, époque où les étudiants du pavillon Read de l’UQAM devaient traverser une haie d’honneur de propagandistes ayant chacun son journal, sa ligne juste avant d’accéder aux classes. L’histoire de Saillant est intéressante parce qu’elle remonte aux premiers exemples d’élus et de candidats ouvriers, à la fin du XIXe jusqu’aux tractations et négociations ayant conduit à la création de Québec Solidaire. En s’attachant à la gauche « politique » entendue comme électorale, l’auteur évite ainsi l’écueil d’avoir à se prononcer sur les théories et principes de la gauche, ce qui serait incompatible avec l’idée d’une « brève histoire ». Les succès électoraux croissants de QS, faisant élire 1, 2,3 puis 10 députés sont remarquables. J’aurais aimé qu’il élabore un peu plus sur les rapports avec la base militante maintenant que le parti peut embaucher des dizaines de professionnels pour épauler l’action des députés.
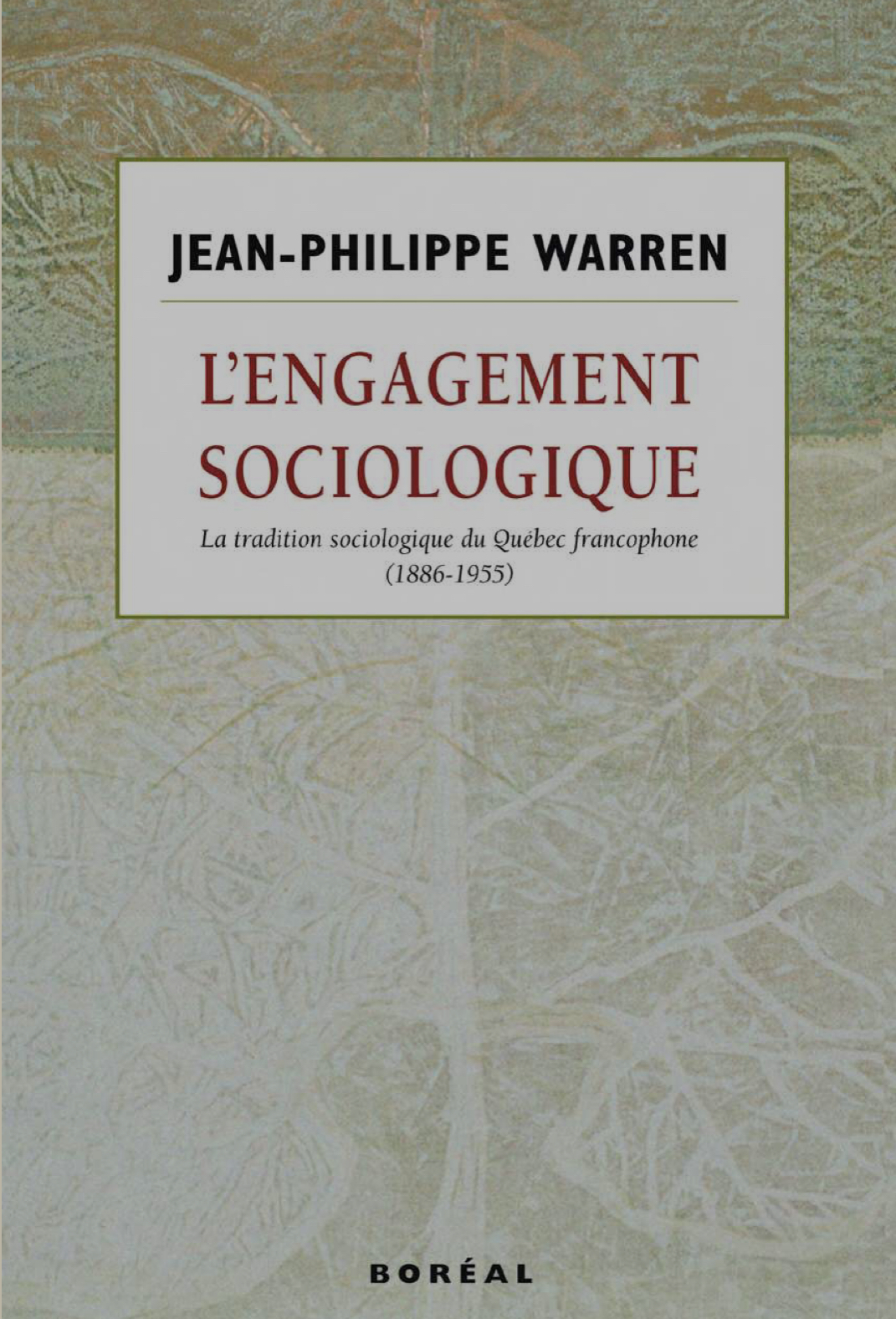

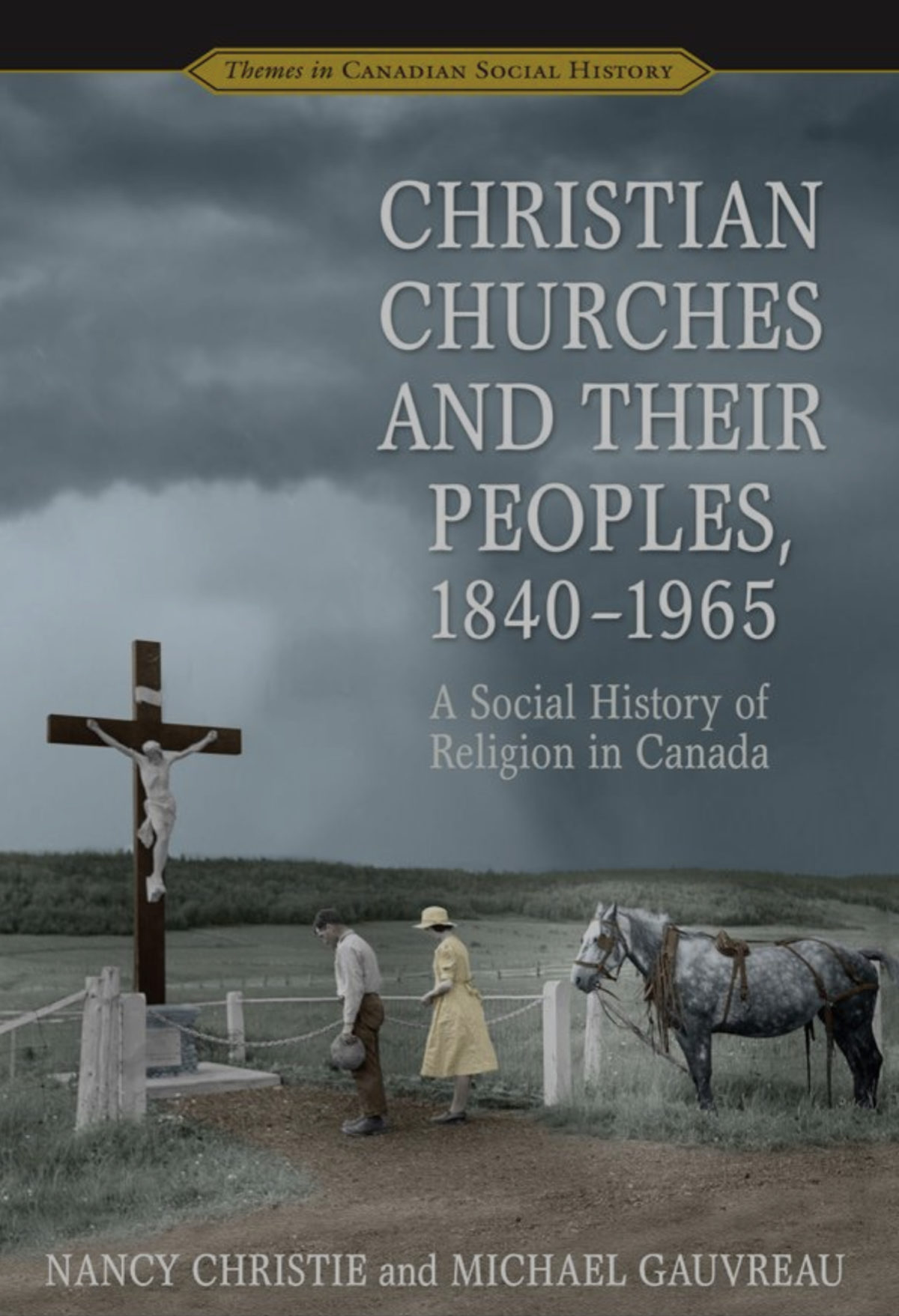
Sur la question des intellectuels et de la gauche, Jean-Philippe Warren a publié (au moins) deux livres : L’engagement sociologique — La tradition sociologique du Québec francophone – 1886-1955 (2003), où il suit l’émergence des enseignements et de la recherche sociologiques. Dans Ils voulaient changer le monde — Le militantisme marxiste-léniniste au Québec (2007), il retrace la montée du radicalisme et l’expérience maoïste telle qu’incarnée par des groupes comme En Lutte ou le Parti communiste ouvrier. De manière incidente et parce que j’avais beaucoup apprécié Les origines catholiques de la révolution tranquille, j’ai voulu lire, du même auteur (Michael Gauvreau avec, cette fois, Nancie Christie) Christian Churches and Their Peoples, 1840-1965 — A social history of religion in Canada. L’action sociale et politique menée par les différentes églises chrétiennes (protestantes et catholique) jusque dans les années ’60. Une gauche chrétienne qui continue d’être active, voir L’Utopie de la solidarité au Québec – Contribution de la mouvance sociale chrétienne (2011) par Lise Baroni, Michel Beaudin, Céline Beaulieu, Yvonne Bergeron, Guy Côté ou encore Nous sommes le territoire (2016) de Michel Beaudin , Céline Beaulieu et Ariane Collin. Dans L’Utopie… le chapitre de Michel Beaudin nous offre une synthèse magistrale Une mémoire à reconstituer : un siècle d’engagement social chrétien.
Si on élargit notre conception des intellectuels jusqu’à inclure la population des diplômés on peut comprendre une partie du développement des dernières décennies comme la montée au pouvoir de ces nouvelles générations de diplômés, ces gauche brahmane et droite marchande dont parle Piketty((Capital et idéologie, Thomas Piketty 2020)) qui ont fait prévaloir leurs intérêts (ont su saisir les opportunités) sur ceux représentés par les syndicats dans les gouvernements d’après-guerre (Collier 2018).
Le fait de situer les valeurs dominantes, axiales de nos société dans leur trame historique récente (30 ans) ou un peu moins récente (75-100 ans) devrait nous inciter, au minimum, à plus d’humilité et à une appréciation plus réaliste et nécessaire du caractère insoutenable du développement des dernières décennies.
histoire profonde
Les cinq ou dix derniers millénaires sont courts lorsqu’on les rapporte à l’histoire de l’humanité (entre 200 000 et 400 000 ans). La période récente, fut marquée par la sédentarité et le développement de l’agriculture et de l’élevage, puis de l’écriture et des sciences qui ont permis un accroissement vertigineux des forces productives, mais aussi des forces de destruction (Engels’s Second Theory — Technology, Warfare and the Growth of the State, de Wolfgang Streeck, NLR 123, May/June 2020).
Pendant la plus grande partie de son existence (95-99%), homo sapiens a vécu en nomade, obligé de se déplacer continuellement pour tenir compte d’un climat qui oscillait entre périodes de glaciation et de réchauffement.
Autrement dit cet âge d’or de l’humanité pendant lequel notre espèce se sera multipliée par… 10 000, cette période de croissance exponentielle n’est pas d’abord attribuable à l’ingéniosité humaine — bien que cela a certainement contribué — mais plutôt à la grande stabilité du climat, à la réduction importante de l’amplitude des oscillations climatiques, comme le montre bien ce graphique publié dans le billet précédent.
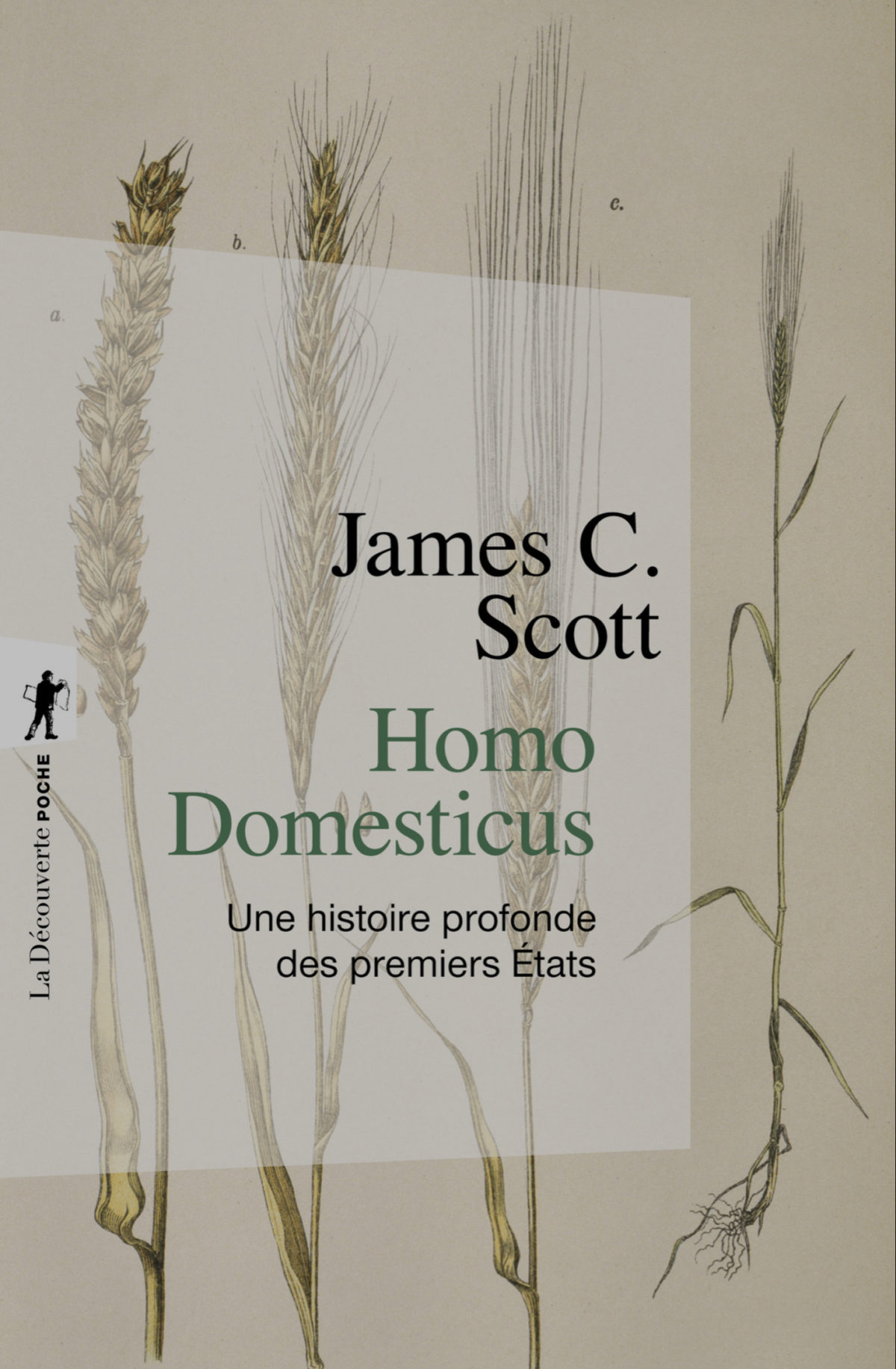
James C. Scott, dans Homo Domesticus — Une histoire profonde des premiers États (2021), tente de retracer cette période de passage du nomadisme à la sédentarité, à la domestication des plantes, des animaux et des hommes. Un passage qui, contrairement à l’image qu’on peut en avoir, ne s’est pas fait de manière linéaire, comme une simple progression vers plus de sécurité, plus de confort… mais plutôt comme une lutte de longue haleine pour harnacher et soumettre les forces de la nature et la capacité productive des hommes. Les humains ne se sont pas laissés embrigader facilement. Les guerres contre les « barbares » visaient autant à ramener des esclaves, pour remplacer ceux qui s’étaient sauvés ou qui étaient morts, qu’à punir les pillards attirés par les récoltes et réserves… Les maladies et épidémies que la coexistence en grand nombre favorisait, tant chez les animaux que les hommes, ont aussi ponctué l’histoire des civilisations. Sur ce dernier sujet, Kyle Harper donne un « édifiant » récit dans Comment l’empire romain s’est effondré — Le climat, les maladies et la chute de Rome.
Ce que James Scott met en lumière, assez clairement, avec son histoire des premiers États, c’est le temps long, et la fragilité de ces civilisations qui nous ont laissé des traces (architecture, écriture) alors que les modes de vie « sans État » ont été le propre de la majorité des peuples humains jusqu’à une époque plutôt récente (quatre ou cinq siècles). Une lecture fascinante faite dans sa version originale (Against the Grain — 2017) juste avant que la version française ne soit publiée 🙁
Alors qu’il laisse entendre à plusieurs reprises que la vie des peuples nomades était plus riche (nourriture plus diverse, mobilisation de connaissances plus étendue), ce que Scott laisse dans l’ombre cependant c’est la réussite indéniable que représentent à la fois l’accroissement (vertigineux) de la population humaine et l’allongement de l’espérance de vie. Des « progrès » qui ne pouvaient se produire sans la sédentarisation et la concentration (des savoirs et de la puissance) de l’urbanisation. Une question demeure : la « flèche du progrès » n’est-elle pas allée trop loin ? Dix milliards d’humains, dont plusieurs milliards de carnivores…
Un autre examen au long cours de l’évolution des civilisations, mais cette fois sous l’angle de l’énergie : Energy and Civilisation, A History, par Vaclav Smil. Un examen minutieux et détaillé de l’évolution des outils, du rendement énergétique des premières cultures, et des équivalences en terme de puissance de travail entre les forces humaines, animales et mécaniques. L’évolution et la comparaison en terme de retour énergétique des types de culture autant que des machines aratoires… Saviez-vous qu’on pouvait harnacher jusqu’à 40 chevaux à une immense moissonneuse dans les grands champs de blé américains au début du 20e siècle ? !
prochaines lectures
Je sais que j’achète plus de livres que je suis capable d’en lire ! Mais ma culpabilité a baissé d’un cran lorsqu’un commentateur comparait sa bibliothèque à un cellier. « Est-ce qu’on demande à un amateur de vin s’il a bu toutes les bouteilles de sa cave ? »
J’ai bien hâte de me replonger dans ces grandes questions, ou de retrouver ces auteurs vénérables.
Charles Taylor, avec The Language Animal; Anna Lowenhaupt, avec Friction — Délires et faux-semblants de la globalité; Lionel Naccache, avec Le cinéma intérieur — projection privée au coeur de la conscience; La tête, la main et le coeur — La lutte pour la dignité et le statut social au XXIe siècle, de David Goodhart; Être forets — Habiter des territoires en lutte, de Jean-Baptiste Vidalou; Écologie intégrale — Le manifeste de Delphine Batho; Qu’est-ce qu’une plante, de Florence Burgat.
Et encore, de divers auteurs, Les transitions écologiques; Le monde jusqu’à hier; The Conservation Revolution — Radicals Ideas for Saving the Nature Beyond the Anthropocene; Future Sea; The Future Earth; The Smart Enough City; Perdre le Sud; The Metamorphosis of the World; La guerre du Péloponèse; Black Morocco — A History of Slavery, Race and Islam; Ils voulaient changer le monde — Le militantisme marxiste-léniniste au Québec…
L’année 2021 promet d’être remplie. Remplie de ce que nous y mettrons. Nos objets et projets. Mais elle sera, surtout, pleine de ce qui nous est donné : la vie, l’amour de nos proches, la beauté du monde. Nous devons en profiter tout en les protégeant.
Notes
- 1Cette année fut finalement assez productive, plus que 2019 et 2018 où je n’avais publié que 16 billets chaque année. Ce n’est pas la « frénésie » de 2012-2013, où j’ai publié près de 80 billets par an, encore moins celle des années 2008-2009 où le rythme atteignait 150 billets par an ! Pas besoin de vous dire que ces billets n’étaient pas tous élaborés…
- 2Hé oui, je commencerai ma 20e année début février !
- 3Capital et idéologie, p. 933


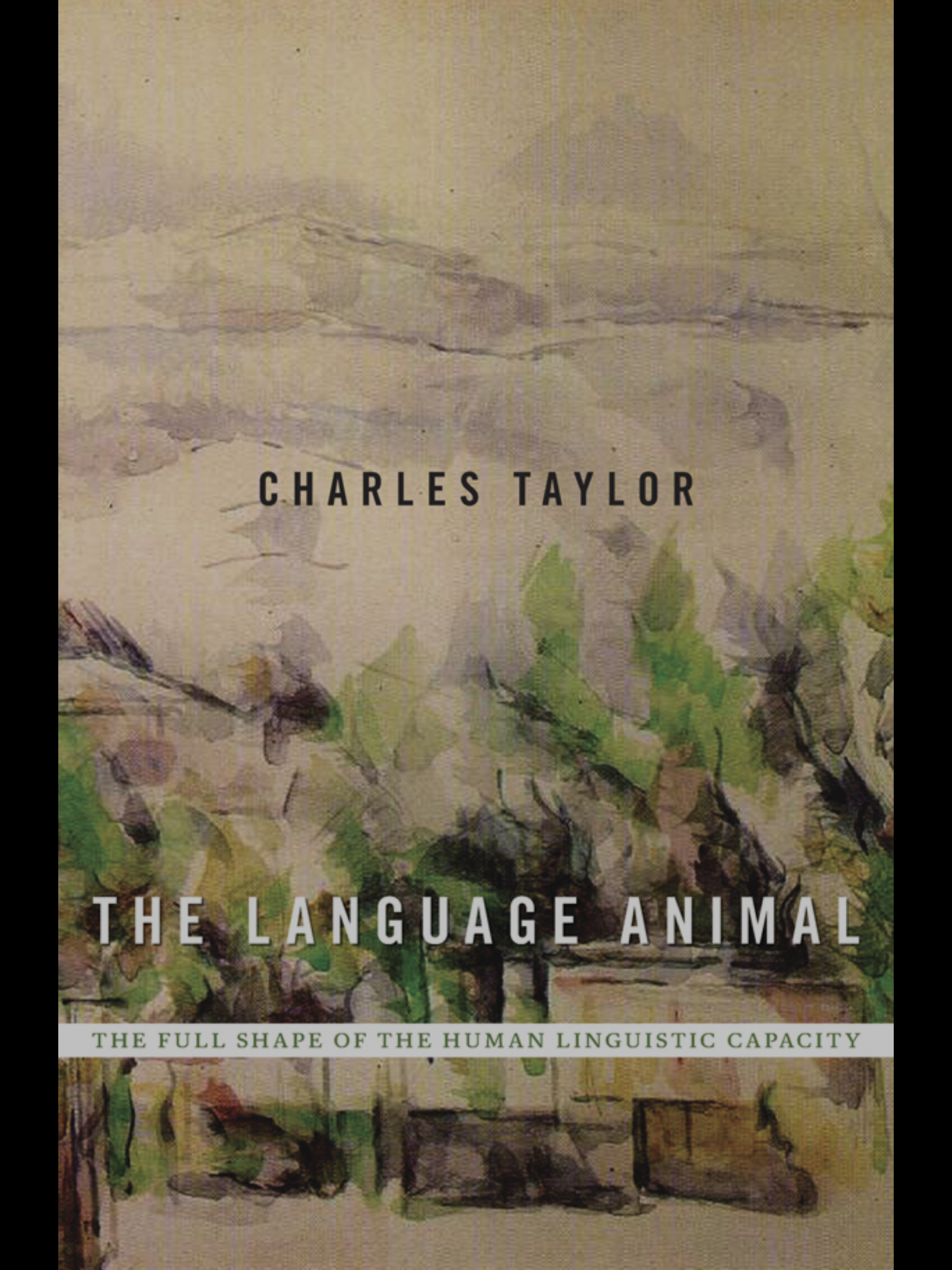
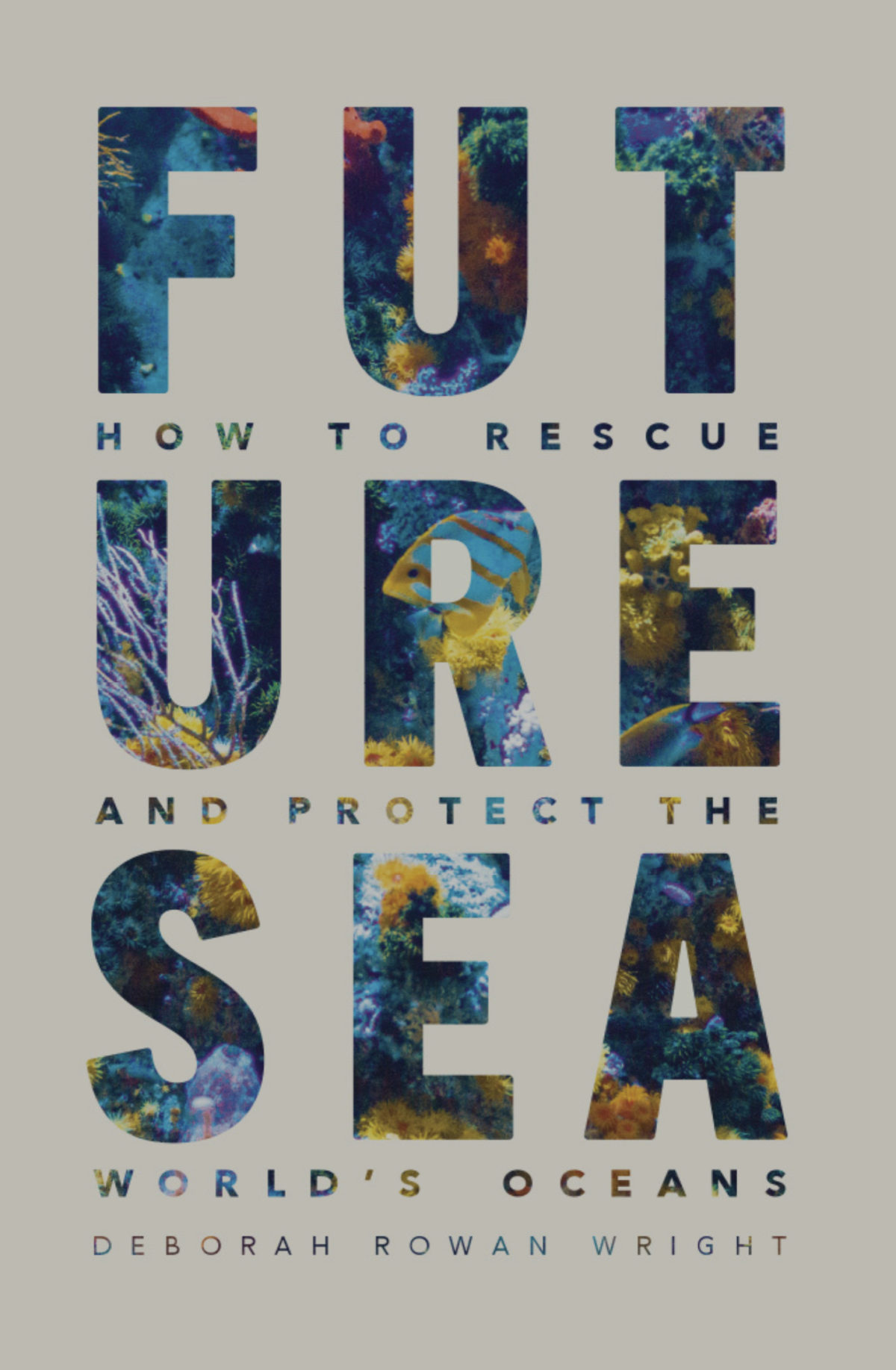
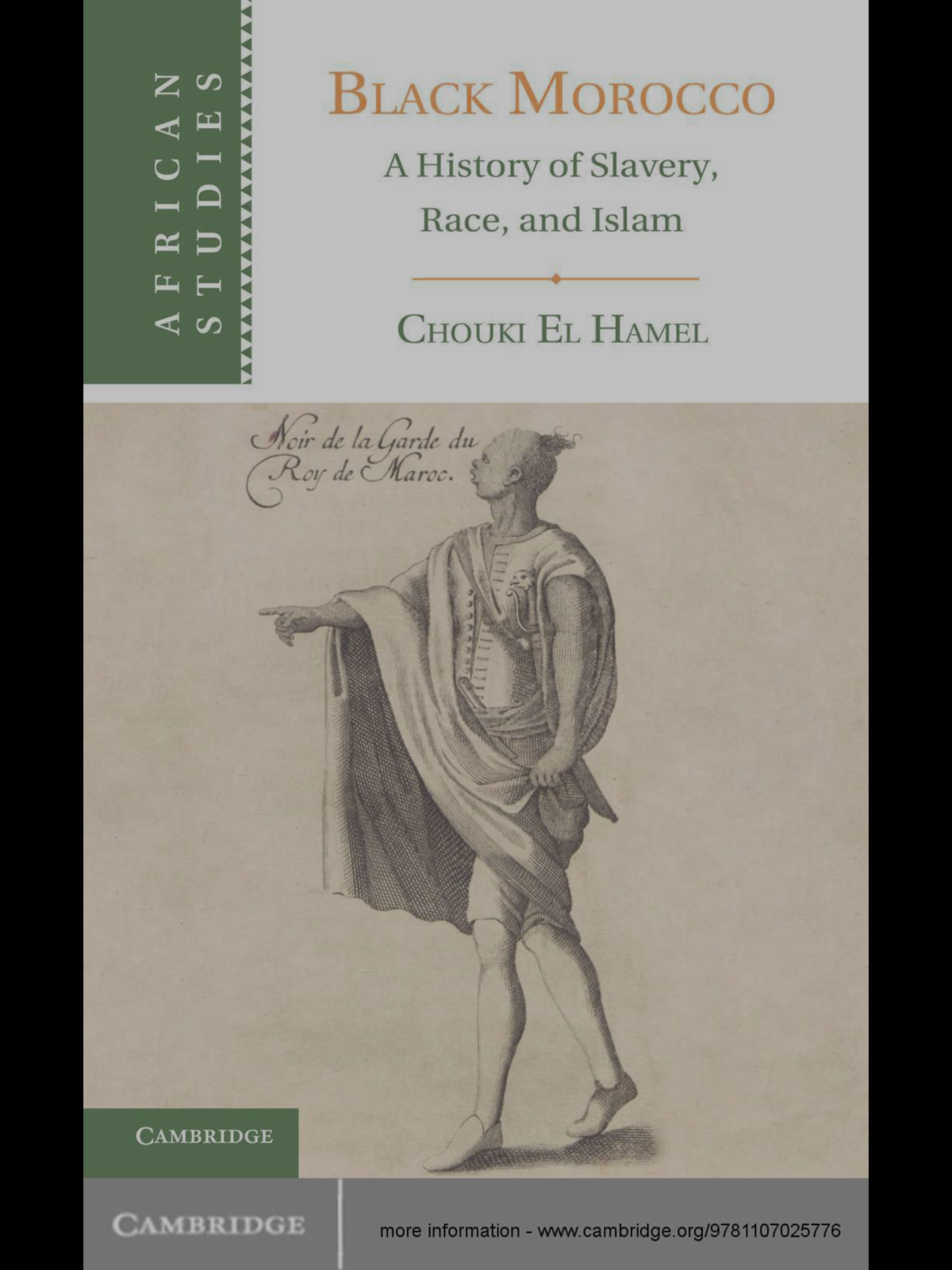



Une réponse sur “pour boucler 2020”