Traduction de The Overshoot Scam publié sur The Brooklyn Rail par Peter St. Clair
Nous vivons désormais pleinement dans l’Anthropocène, l’ère du dérèglement climatique provoqué par l’homme. L’ère où « forez, forez » signifie « tuez, tuez ». Les bombes carbone lancées dans le passé s’abattent sur Los Angeles et font des victimes qui n’étaient peut-être que des bébés lorsque ces gigatonnes de CO2 ont été rejetées dans l’atmosphère, provoquant les incendies qui ont ravagé leur ville.
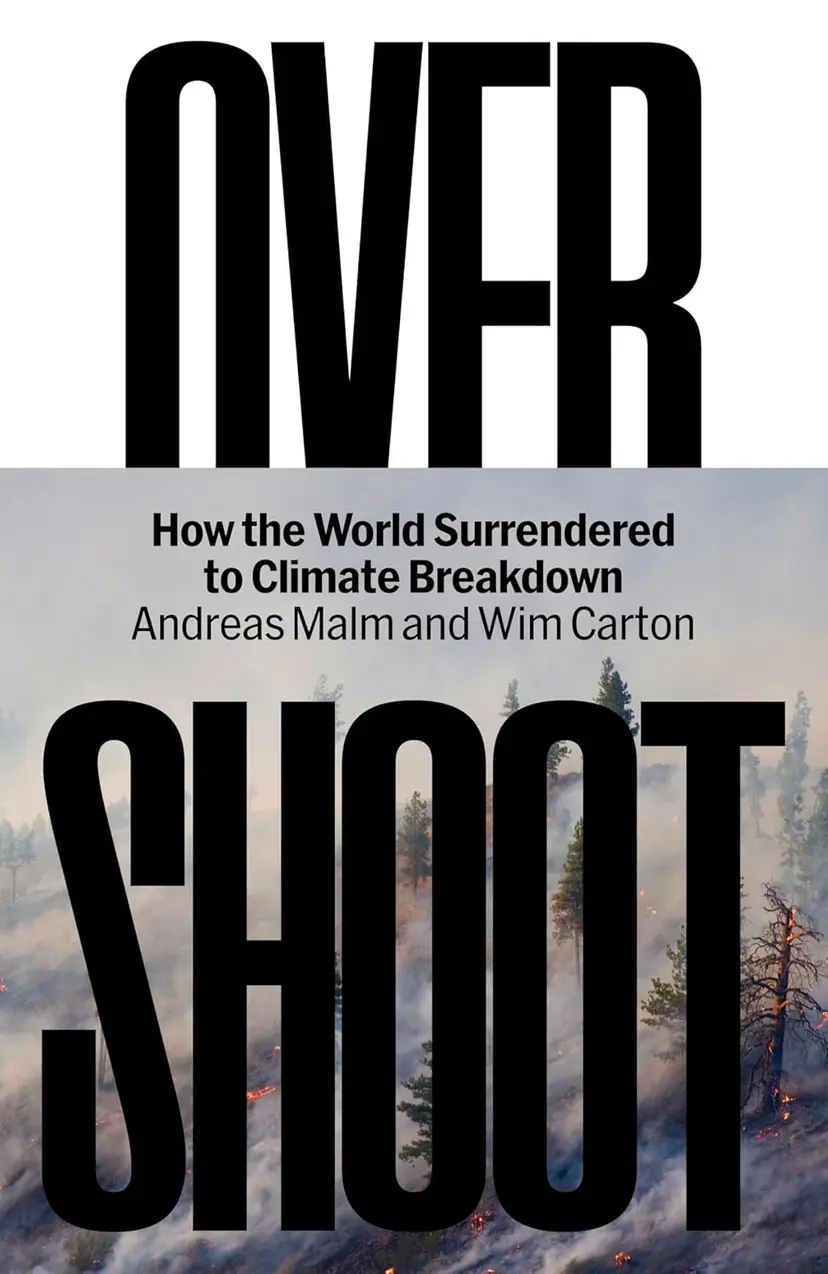
Dans Overshoot : How the World Surrendered to Climate Breakdown, Andreas Malm et Wim Carton, s’appuyant sur l’analyse du capitalisme par Marx (et en clin d’œil aux idées de Freud sur la psychopathologie), ont réussi à donner un sens à l’époque actuelle, où la perturbation du système climatique terrestre causée par l’homme nous mène vers une planète en grande partie inhabitable, une Terre serre. La trajectoire est claire, la cause est bien connue, la solution évidente ; et pourtant, la société humaine est incapable ou refuse de prendre les mesures nécessaires pour éviter la catastrophe.
Cette refus collectif d’affronter le danger réel et présent tout en continuant à s’autodétruire répondrait à la définition de la folie clinique, mais en même temps, il est tout à fait rationnel du point de vue de la logique capitaliste, où la maximisation du profit et l’expansion de la valeur sont les principaux moteurs, et où le statu quo se présente comme un objet immuable. « En raison de la manière dont l’économie était constituée, une folie clinique et immorale tenait l’avenir de la planète entre ses mains. »1 C’est cette situation intenable que Malm et Carton s’attaquent, une situation qui doit être expliquée si nous voulons un jour élaborer une stratégie pour changer la trajectoire qui nous mène à la catastrophe et nous engager sur la voie d’un avenir plus durable.
La cause du dérèglement climatique est désormais bien connue. La science est claire : l’extraction et la combustion continues des combustibles fossiles et l’ajout de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère qui en résulte. Afin de mettre un terme à cette augmentation accélérée des émissions de carbone, l’humanité doit passer le plus rapidement possible à un système énergétique zéro émission, avant qu’une série de points de basculement en cascade ne se déclenche et que le système terrestre ne soit plongé dans un état de surchauffe où la survie de l’humanité deviendra incertaine. La crise est déjà bien engagée, mais les solutions n’ont pas encore été mises en œuvre.
Dire que mettre fin à l’économie fossile est une tâche colossale est un euphémisme, mais il faut y parvenir le plus tôt possible, sinon la Terre elle-même y mettra fin, emportant avec elle la civilisation qui l’a engendrée. C’est un projet qui semble tout à fait impossible, même si les technologies nécessaires à cette transition sont disponibles et à portée de main. Cela semble impossible à beaucoup, car à l’heure actuelle, non seulement l’ensemble de l’humanité dépend de l’extraction, du raffinage et de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz pour satisfaire ses besoins énergétiques quotidiens, mais la production de combustibles fossiles est également intégrée dans toutes les facettes de l’économie, de la production de plastiques à la fabrication de produits pharmaceutiques, en passant par l’édifice financier mondial où le capital fossile joue un rôle inégalé.
Nous sommes habitués à considérer cette économie fossile comme le résultat naturel du développement et du progrès humains, dans laquelle la productivité du travail et l’innovation technique ont permis à l’humanité de s’épanouir et de se multiplier. Andreas Malm, dans son ouvrage précédent, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming, a montré qu’il était loin d’être inévitable que le charbon et la vapeur remplacent la première « force motrice » de l’industrie cotonnière émergente en Angleterre au début du XIXe siècle. Ce n’est qu’au cours d’une période de trente ans que la force gratuite de l’eau qui tombe a été supplantée par la force coûteuse du charbon et des machines à vapeur. Bien que le monde dans lequel nous vivons soit issu de cette transition, nous ne pouvons pas en attribuer la cause à un résultat imprévisible. À l’époque, il était difficile de convaincre les capitalistes d’investir dans la vapeur, coûteuse, plutôt que dans l’énergie hydraulique gratuite. Comme l’a montré Malm, ce sont les contraintes liées au maintien d’une main-d’œuvre bon marché et docile dans les campagnes, ainsi que la difficulté d’obtenir la coopération nécessaire entre les propriétaires de filatures de coton concurrentes pour construire des infrastructures hydrauliques, qui ont finalement conduit à l’adoption des machines à vapeur et au déplacement de l’industrie vers les villes. Depuis lors, les industriels n’ont cessé de vanter les avantages des machines par rapport aux « particularités gênantes des travailleurs humains, précisément en installant toujours plus de machines actionnées par des machines à vapeur toujours plus puissantes ».2 Ce n’était pas que les machines à vapeur étaient plus efficaces ou techniquement supérieures aux moulins à eau existants. C’est le contrôle accru sur la main-d’œuvre qui a fait pencher la balance. Bien que les moulins à eau eux-mêmes fussent très rentables, l’approvisionnement en énergie hydraulique des moulins ne générait que peu de profits – il s’agissait d’un « cadeau de la nature » –, mais une fois la transition vers les machines à vapeur effectuée, la demande en charbon, qui alimentait la révolution industrielle naissante, s’est accélérée. C’est l’exploitation rentable du charbon qui a alimenté l’expansion de la vapeur dans de nouveaux domaines de la fabrication et du transport, et finalement l’électrification du monde. Ce circuit était profitable à tous les niveaux, depuis le combustible qui alimentait les moteurs jusqu’aux produits finis.
Ces développements ont eu pour conséquence d’augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre, cachée et invisible dans les nuages de fumée noire et nauséabonde qui recouvraient le ciel de Manchester et des autres villes industrielles qui avaient vu le jour à travers le monde. Cette conséquence involontaire a entraîné une lente accumulation de gaz à effet de serre et une augmentation de la température à la surface de la Terre. Les émissions et la hausse des températures se sont fortement accélérées à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et encore plus rapidement au cours des trois premières décennies du XXIe siècle.
Malm et Carton retracent l’histoire de cette accumulation au cours du premier quart de ce siècle, en rendant compte de l’accélération du développement des combustibles fossiles : exploration, extraction, expansion des infrastructures, notamment des plateformes offshore plus nombreuses et plus grandes, des pipelines, des raffineries, des usines pétrochimiques, des centrales électriques au charbon et au gaz, et augmentation du transport maritime avec des navires plus grands et de nouveaux terminaux plus importants. Puis, en 2020, un phénomène étrange s’est produit. Les émissions de CO2 ont chuté, non pas grâce aux politiques climatiques, mais grâce aux mesures prises pour contrôler la propagation du coronavirus. Cela s’est produit, notent-ils, à un moment où le mouvement climatique était à son apogée, « le mouvement social qui a connu la croissance la plus rapide de l’histoire ». L’industrie pétrolière et gazière s’est effondrée lorsque les avions ont été cloués au sol, les voitures immobilisées et les lieux de travail vidés. La panique s’est emparée du secteur, qui a brièvement cru à la fin du pétrole. Cela aurait pu être le point de départ d’une transition vers l’abandon des combustibles fossiles, mais les émissions ont rebondi dès la fin des mesures de confinement. Le pétrole a fait un retour en force. L’année 2021 a été marquée par des profits records pour les combustibles fossiles, tandis que les émissions ont augmenté, ajoutant deux gigatonnes supplémentaires dans l’atmosphère.
Malm et Carton montrent comment, à un moment où il n’était plus possible d’ajouter de nouveaux oléoducs ou gazoducs et où les investissements dans le développement de nouvelles énergies fossiles devaient être stoppés si le monde voulait avoir une chance de maintenir la température en dessous de 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel, c’est exactement le contraire qui s’est produit. Les investissements dans de nouveaux projets pétroliers, gaziers et charbonniers ont explosé, tout comme les profits des super-majors mondiaux. Les bénéfices ont encore augmenté après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’embargo sur le pétrole et le gaz russes, qui ont fait grimper les prix. Les cinq plus grandes compagnies pétrolières ont toutes enregistré les plus gros bénéfices de leur histoire. Qu’ont-elles fait de tout cet argent ? Après avoir distribué des dividendes aux actionnaires, elles l’ont immédiatement réinvesti dans l’expansion de leur production. L’année 2022 a vu les investissements dans les énergies fossiles se déchaîner, avec la planification, le financement et la construction de nouveaux oléoducs, gazoducs, mines de charbon et plateformes pétrolières offshore. De nouveaux territoires ont été ouverts à l’exploration pétrolière sur terre et en mer. Malm et Carton concluent que, compte tenu des récentes catastrophes mondiales attribuées au changement climatique et de l’augmentation exponentielle concomitante des investissements dans les énergies fossiles, on ne peut que supposer que le monde est devenu fou ! Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, l’avait déjà dit en 2022 : « Les gouvernements et les entreprises à fortes émissions ne se contentent pas de fermer les yeux, ils jettent de l’huile sur le feu. Ils étouffent notre planète, guidés par leurs intérêts particuliers. » Il a qualifié cela de « folie morale et économique ». Les auteurs vont encore plus loin. « Investir dans de nouvelles infrastructures pour les combustibles fossiles au cours de la troisième décennie du millénaire n’était pas seulement une folie morale : c’était une folie sans qualificatif, une folie au sens clinique du terme. »
Les objections soulevées par le passé à l’encontre de l’énergie éolienne et solaire, à savoir que le coût de leur production d’électricité était prohibitif, ont été rendues caduques par la baisse rapide des coûts au cours de la dernière décennie. Malm et Carton font référence aux travaux de Mark Jacobson et de son équipe à Stanford, qui ont démontré qu’il est désormais techniquement possible de convertir l’ensemble de la planète à un système énergétique zéro émission. Depuis 2009, ils élaborent des scénarios pour une transition totale vers l’énergie éolienne et solaire. Ils ont commencé par déterminer comment cela serait possible pour des villes individuelles, puis ont étendu leurs recherches à des pays et des régions entiers.3 Ils ont envisagé une transition par étapes, en commençant par la plus évidente et la plus facile, à savoir la conversion de toute la production d’électricité aux énergies renouvelables, puis l’électrification de toute la consommation d’énergie, y compris les moteurs à combustion interne, et le remplacement des hauts fourneaux par des fours électriques à arc pour fondre le minerai de fer. Toute l’énergie thermique utilisée pour chauffer les bâtiments serait remplacée par l’énergie solaire et éolienne.
Si la transition est techniquement possible, si le coût de construction des infrastructures est moins élevé que celui des combustibles fossiles et si le coût de production de l’électricité est plus bas, pourquoi, alors que les énergies renouvelables se développent, cette transition ne se fait-elle pas assez rapidement pour remplacer les énergies fossiles ?
Pourquoi les énergies non renouvelables connaissent-elles une croissance plus rapide ? Leur coût moindre et l’énergie gratuite qu’elles fournissent une fois mises en service ne devraient-ils pas les rendre plus attractives pour les investisseurs ? Le marché ne dicterait-il pas une transition vers une source d’énergie moins coûteuse ? Brett Christophers a écrit un livre consacré à cette question. Dans The Price is Wrong, il examine les systèmes de production d’électricité et les facteurs qui influent sur la rentabilité de l’énergie éolienne et solaire, et qui les ont rendues beaucoup moins rentables que le charbon, le pétrole et le gaz.4 Ce n’est pas le prix ou le coût qui importe aux investisseurs, mais la rentabilité. Dans ce cas, le coût de production de l’électricité n’est pas directement assimilé au profit. D’autres coûts, « ceux qui ne sont pas liés à la production, peuvent être simultanément élevés : de plus, le potentiel de génération de revenus peut ne pas être le même ». Ce sont les dispositions institutionnelles particulières relatives à la production et à la distribution de l’électricité qui ont « construit, organisé et transformé les systèmes électriques de telle manière que le remplacement d’une production polluante et relativement coûteuse par une production moins chère et plus propre n’est absolument pas garanti ».
Le système complexe et alambiqué de commercialisation de l’électricité donne lieu à des phénomènes étranges, notamment des prix négatifs qui affectent davantage les énergies renouvelables que les énergies non renouvelables. Ce sont en partie la structure du marché et le système de tarification qui désavantagent l’énergie solaire et éolienne, et en partie le pouvoir économique et politique de l’industrie des combustibles fossiles elle-même. Il existe également une multitude d’obstacles bureaucratiques, notamment les autorisations et les raccordements au réseau, qui peuvent retarder considérablement les projets éoliens et solaires, l’obtention des autorisations nécessaires pouvant parfois prendre jusqu’à dix ans. Cela contribue à l’imprévisibilité du potentiel de profit, ce qui affecte la disponibilité et le coût du financement de nouveaux projets. L’obtention de financements est un problème auquel les entreprises fossiles anciennes et riches n’ont pas à faire face.
À ces problèmes, Malm et Carton ajoutent une cause plus intrinsèque de la rentabilité relativement faible des énergies renouvelables. L’énergie éolienne et solaire, que Malm a toujours qualifiée de « flux », est une énergie gratuite – comme l’eau au XVIIIe siècle – une fois que les moyens de la capter ont été mis en place, tandis que les combustibles fossiles, ou « le stock », sont une marchandise qui peut être achetée et vendue. Ils doivent être constamment renouvelés, ce qui nécessite de la main-d’œuvre pour les produire, créant ainsi de la valeur pour les fournisseurs, les propriétaires des combustibles. Il s’agit là d’une différence essentielle : le flux provenant du vent et du soleil est un « don gratuit de la nature » qui résiste à la marchandisation. Selon Marx, la valeur provient du travail socialement nécessaire incarné dans une marchandise, exprimé sous forme de valeur d’échange, base sur laquelle le prix est établi. Une fois que le travail nécessaire pour capter le vent ou le soleil a été effectué, l’énergie est produite sans travail supplémentaire. Par conséquent, comme le disent Malm et Carton, « le flux n’est pas rentable […] car il ne peut s’inscrire dans le cadre rigide de la forme marchande ». Cela s’apparenterait davantage aux « marchandises fictives » théorisées par l’économiste hongrois Karl Polanyi : des biens qui sont traités comme des marchandises sur le marché, mais qui ne sont pas créés pour le marché.5 Ils correspondraient également aux « biens non rivaux », nous disent les auteurs, que l’économiste Paul Samuelson appelait « biens de consommation collective », qui peuvent être consommés sans être épuisés. Le fait est que les biens de ce type sont par nature publics. « Même en termes d’économie bourgeoise, l’énergie solaire et éolienne semblerait donc finir dans la catégorie des biens publics, qui seront sous-fournis par les entreprises à but lucratif. »6
Si le marché ne peut pas faire en sorte que les investissements se détournent des énergies polluantes, qu’est-ce qui le peut ? Qu’en est-il de la réponse internationale à la crise climatique ? Qu’en est-il de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et des Conférences des Nations unies sur les changements climatiques (Conférences des Parties, COP), qui se réunissent chaque année depuis 1995 pour négocier des traités sur le climat et évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre le changement climatique ? Chaque année, nous recevons un rapport. On pourrait supposer que ces négociations progressent. Les auteurs nous retracent cette histoire, qui a commencé par un effort apparemment sérieux pour faire face au danger posé par la poursuite des émissions de gaz à effet de serre. L’idée était de soutenir la recherche scientifique et d’assurer la coopération internationale afin de réduire les émissions en limitant les quantités que chaque nation serait autorisée à émettre. Depuis le protocole de Kyoto en 1997, qui a vu la signature de traités et la fixation d’objectifs, jusqu’à la COP15 à Copenhague, où la limite de 1,5 degré par rapport à la température préindustrielle a été fixée pour la première fois, les émissions mondiales ont continué d’augmenter. La fixation d’une limite tolérable à 1,5 degré serait une victoire pour les militants pour le climat et pour les nations insulaires les plus vulnérables du Pacifique, qui considéraient qu’au-delà de cette limite, elles seraient condamnées à disparaître sous la montée des eaux. Les pays du Sud qui avaient fait pression pour obtenir la limite de 1,5 °C ont finalement obtenu gain de cause à Paris lors de la COP 21 en 2015, lorsque la pression des défenseurs du climat, des ONG et des manifestations dans les rues a fait céder la résistance des pays développés du Nord. Mais cette victoire a été rendue caduque lorsque Barack Obama « a présenté au monde un projet de texte qui supprimait les engagements : dorénavant, disait-il, il appartiendrait à chaque pays de faire ce qu’il voulait, sans obligation ni risque de sanction ». La limite de réchauffement a été ramenée à 1,5 degré, mais le concept de limite a été vidé de sa substance. Les entreprises de combustibles fossiles seraient autorisées à continuer d’augmenter leur production et à engranger leurs énormes profits malgré les catastrophes qu’elles provoquaient.
La COP21 a toutefois chargé le GIEC de rédiger un rapport spécial sur les impacts d’un réchauffement de 1,5 degré. Publié en 2018, ce rapport répondait à la question de savoir quels risques pourraient être évités si le réchauffement était limité à 1,5 degré plutôt qu’à 2 degrés ou plus. « Le Groupe a constaté une réduction notable des risques : les pluies torrentielles destructrices, les sécheresses prolongées, les mauvaises récoltes, la pénurie d’eau seraient toutes moins fréquentes et moins dévastatrices. »7 Des vagues de chaleur mortelles, repoussant les limites de la survie humaine, balayeraient les régions tropicales à 1,5 °C, bien que cette température ait déjà été enregistrée dans le golfe Persique et la vallée de l’Indus, et ces « vagues de chaleur meurtrières commenceraient à durer trois ou quatre jours ». Le rapport spécial a déclenché une vague d’activisme en 2018, de Greta Thunberg au Sunrise Movement, en passant par Extinction Rebellion et le Green New Deal. Les scientifiques se sont également montrés plus virulents et plus actifs à mesure qu’ils assimilaient les nouvelles données issues de multiples rapports et articles de recherche. Mais en 2023, tout cela n’avait abouti à rien. Les émissions ont continué d’augmenter et l’espoir de rester en dessous de 1,5 °C s’est évanoui. La contradiction entre les profits en plein essor et la flambée des valeurs boursières, d’une part, et la dégradation du climat qu’ils engendraient, d’autre part, est désormais manifeste. Malm et Carton citent Inger Anderson, présidente du Programme des Nations unies pour l’environnement : « Nous avons eu la possibilité d’apporter des changements progressifs, mais ce temps est révolu. Seule une transformation radicale de nos économies et de nos sociétés peut nous sauver de l’accélération de la catastrophe climatique. » Les rapports officiels du GIEC évoquaient la nécessité d’une transition systémique d’une ampleur sans précédent. Il existait désormais un consensus croissant sur le fait que les politiques actuelles n’étaient pas suffisantes pour ralentir le changement climatique et que l’objectif de 1,5 °C était impossible à atteindre, car ces transformations sans précédent étaient irréalisables. Dans le même temps, on prenait de plus en plus conscience des implications révolutionnaires de cette situation. C’est là qu’intervient le concept de « dépassement ».
Les modèles d’évaluation intégrée, ou IAM, étaient les modèles informatiques préférés des décideurs politiques de l’UE et des autres signataires des protocoles de Kyoto à la fin des années 1990. Comme l’expliquent Malm et Carton, les IAM étaient des tentatives d’intégrer les processus économiques et les processus qui produisent des gaz à effet de serre dans un modèle « intégré ». Ces modèles différaient des modèles climatiques qui cartographiaient les processus physiques impliqués dans le réchauffement climatique. Le problème est que, si les effets physiques des gaz à effet de serre découlent des lois de la chimie, de la thermodynamique et de la physique – lois de la nature dont la précision mathématique est prouvée –, les abstractions utilisées dans les modèles économiques sont très différentes. Elles sont basées sur l’économie néoclassique et supposent des marchés concurrentiels pleinement fonctionnels et des sujets rationnels, plutôt que les relations sociales chaotiques et souvent conflictuelles du capitalisme réel. Les équations introduites dans les modèles informatiques ne reposaient que sur des éléments considérés comme mesurables dans la théorie économique dominante, c’est-à-dire le coût et le prix, laissant de côté, selon les termes de William Nordhaus, qui se décrit lui-même comme le père des MTI, les éléments qui ne peuvent être mesurés : « la santé humaine, la diversité biologique, les valeurs d’agrément de la vie quotidienne et des loisirs, et la qualité de l’environnement ». 8 Les IAM ont été conçus pour calculer le coût le plus bas possible pour éviter des dommages coûteux et pour produire la politique climatique optimale. Ils regorgeaient d’hypothèses non prouvées, telles que celle selon laquelle la tarification du carbone réduirait les émissions au fil du temps, alors qu’elle s’est continuellement révélée politiquement inacceptable. Ils partent du principe que les coûts diminueront avec le temps, de sorte que les mesures d’atténuation coûteuses pourraient être reportées à une date ultérieure, lorsqu’elles deviendraient plus abordables. Comme ils étaient basés sur l’économie néoclassique, les réductions immédiates et profondes préconisées dans de nombreux rapports ont été écartées. Les IAM étaient une prescription pour retarder l’atténuation, car celle-ci serait trop douloureuse pour l’industrie des combustibles fossiles et trop préjudiciable au PIB. Ils ignoraient l’immoralité de faire peser sur les générations futures le fardeau de l’aggravation des conditions climatiques afin d’éviter des difficultés économiques dans le présent. Les modèles devaient proposer un scénario permettant de limiter le réchauffement à 2 degrés. L’UE a trouvé un modèle capable d’y parvenir, appelé IMAGE, développé par un groupe de recherche néerlandais. En inversant le modèle et en choisissant l’année 2100 comme date butoir, ils ont estimé qu’il serait possible de dépasser la limite pendant un certain temps si l’on trouvait un moyen de la ramener à un niveau sûr d’ici cette date. Ils ont proposé d’utiliser la bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS) comme moyen d’extraire le carbone de l’air en plantant d’immenses champs de plantes à croissance rapide qui absorbent naturellement le dioxyde de carbone de l’air, puis en les brûlant pour produire de l’énergie tout en capturant le carbone libéré dans la cheminée et en le pompant sous terre dans des puits de pétrole épuisés. Alors que d’autres modèles prévoyaient une augmentation de 3 degrés ou plus d’ici 2100, IMAGE a abouti à un dépassement.
Nous sommes aujourd’hui dans une situation de dépassement. C’est une période où les mesures d’atténuation ont été abandonnées car jugées trop coûteuses, et où la transition vers les énergies renouvelables sera reportée à une date ultérieure. L’idée du dépassement est que la limite de 1,5 °C proposée pour la première fois lors de la conférence de Paris sur le climat peut être dépassée et que, grâce à des processus non éprouvés de géo-ingénierie et de capture du carbone, la température de la Terre pourrait finalement être ramenée à un niveau sûr. Pendant ce temps, la combustion des énergies fossiles se poursuivra. Les investissements dans l’exploration, l’extraction et le développement des infrastructures, ainsi que les profits qu’ils génèrent, augmentent à mesure que le pétrole et le gaz non brûlés s’accumulent dans le sol, comptant comme des actifs précieux pour leurs propriétaires.
Cependant, le dioxyde de carbone s’accumule, de sorte que plus les émissions se poursuivent, plus il faudra capturer et séquestrer de carbone. L’idée du dépassement repose sur l’hypothèse erronée que l’accumulation des gaz à effet de serre est un processus linéaire, alors qu’en réalité, le système terrestre fonctionne comme un processus complexe non linéaire impliquant des boucles de rétroaction qui peuvent intensifier l’augmentation de la température, activant des points de basculement supplémentaires dans une cascade en cascade qui conduit à des changements d’état irréversibles à l’échelle humaine. Cela révèle, comme le déclare le sous-titre du livre, une capitulation face à la dégradation du climat.
« Les émissions sont hors de contrôle et nous n’avons aucun projet pour les maîtriser, nous devons donc essayer des solutions différentes des mesures d’atténuation classiques. » C’est ce que Malm et Carton appellent la doctrine fondamentale de l’idéologie du dépassement. Cherchant désespérément un moyen de sortir de l’énergie fossile, d’éviter des pertes de milliards et de conserver des méga-profits, alors que le budget carbone diminuait rapidement, le capital fossile a embrassé le BECCS et le dépassement comme son sauveur. Cependant, le BECCS s’est révélé être une entité fictive, une licorne, comme l’appellent les auteurs. Après des années de promesses, personne n’a produit de projet fonctionnel. Il ne restera donc que la proposition effrayante et fantastique de la géo-ingénierie solaire comme substitut à la poursuite de la politique de dépassement, un scénario dans lequel la lumière du soleil serait bloquée par l’injection de sulfates dans l’atmosphère. Cela entraînerait un assombrissement global et une baisse des températures, mais les gaz à effet de serre continueraient à s’accumuler dans l’atmosphère. Une fois lancé, si le processus est interrompu, l’augmentation soudaine de la température qui en résulterait pourrait entraîner une extinction massive. Jacob Blumenfeld décrit cela comme « une escroquerie capitaliste visant à continuer à brûler des combustibles fossiles afin de sauver les investissements enfouis dans le sol. Il est très tentant d’utiliser la technologie pour libérer des aérosols solaires afin de bloquer les effets du réchauffement, plutôt que de supprimer la cause, car cela ne bloque pas des milliers de milliards d’actifs sous terre ».9
Les grandes compagnies pétrolières et leurs bailleurs de fonds réinvestissent depuis 2022 leurs énormes profits dans l’exploration et le développement de gisements de pétrole, de gaz et de charbon, d’usines et de projets d’infrastructure dont la durée de vie productive est estimée à plusieurs décennies. Malm et Carton énumèrent quelques-uns des nombreux projets en cours, des investissements qui mettront des années, voire des décennies, à être rentables et qui constitueront ensuite une source de profits colossaux dans un avenir prévisible. Ils posent la question suivante : « Que faudrait-il faire pour rester en dessous de 1,5 °C dans un monde où l’accumulation primitive de capital fossile se poursuit à ce rythme, ou en dessous de 2 °C, ou 3 °C… ? Il faudrait que les investisseurs subissent le coup qu’ils redoutent le plus : les installations qui viennent d’être financées, ou qui viennent d’être finalisées, ou qui viennent d’être inaugurées, ou qui sont sur le point d’atteindre le seuil de rentabilité ou de commencer à générer des profits, devraient être scellées et fermées à clé pour de bon. » En d’autres termes, des actifs échoués.
C’est-à-dire « des actifs qui subissent des dépréciations anticipées ou prématurées, une réévaluation à la baisse ou une conversion en passifs ». Dans le cas des combustibles fossiles, les actifs échoués ont commencé à faire l’objet de discussions et de débats au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle. Soulevée pour la première fois par les militants pour le climat et les communautés et nations les plus vulnérables, cette question mettait en évidence la menace que l’atténuation pourrait faire peser sur les investisseurs. Les actifs échoués sont un phénomène courant dans le développement capitaliste depuis l’aube de l’ère industrielle, à mesure que les technologies deviennent obsolètes et sont remplacées par des moyens de production plus efficaces. Dans le cas des combustibles fossiles, cependant, il n’y a aucune raison qu’ils deviennent économiquement obsolètes. Leur faible coût et leur intégration dans presque tous les aspects de la production mondiale leur permettent de se développer continuellement et de générer des profits extraordinaires malgré leur obsolescence en tant que source d’énergie durable. Par conséquent, l’abandon des actifs fossiles devrait nécessairement être une décision politique plutôt qu’économique. « L’abandon des actifs se produirait à travers une transition vers l’abandon des combustibles fossiles imposée par des acteurs politiques, qu’il s’agisse de gouvernements, de mouvements ou d’une combinaison des deux. »
La contradiction fondamentale mise en évidence par le concept de dépassement et soulignée par Malm, Carton et Brett Christophers est que la transition vers un système énergétique sans énergie fossile ne sera pas suffisamment rentable pour attirer des investissements suffisants, tandis que les investissements dans les énergies fossiles continueront à générer d’énormes profits et à attirer des investissements croissants, tout en garantissant l’aggravation de la crise climatique. Elle n’attirera pas suffisamment d’investissements tant que « les acteurs qui décident des investissements seront guidés par le profit » ; par conséquent, pour que la transition ait lieu, elle doit être impulsée par l’État dans le cadre d’une initiative politique visant à faire de la production d’énergie un bien public. En d’autres termes, dans un système régulé par le marché, la transition vers un système énergétique non destructeur ne sera pas possible sans une forme d’expropriation de l’industrie des combustibles fossiles et son remplacement par la propriété commune.
Le dépassement est apparu lorsque la nécessité d’une transformation révolutionnaire est devenue évidente pour les scientifiques, les décideurs politiques, les populations les plus vulnérables du Sud et les capitalistes fossiles eux-mêmes. Le changement climatique conduit si clairement à la catastrophe écologique que les classes dirigeantes comprennent intuitivement la menace de révolution, même là où aucun mouvement révolutionnaire n’existe, car le seul moyen d’éviter l’effondrement total du climat habitable est une refonte immédiate et complète du système capitaliste. Considérant cela comme un résultat irréalisable, une impossibilité, la seule alternative est de repousser le problème, de botter en touche ; et la seule façon de justifier cette approche suicidaire est de développer une logique illogique – le dépassement – et une politique anti-révolutionnaire pour contrer les propositions de plus en plus radicales des climatologues, des militants et des victimes du Sud. Les milliardaires ultra-riches et leurs riches actionnaires sont hantés par la menace d’abandonner le système énergétique basé sur les combustibles fossiles depuis le début du mouvement climatique. La logique du « laisser dans le sol » était une présence puissante qui se cachait dans l’ombre, même si aucun mouvement révolutionnaire digne de ce nom n’existait.
Malm et Carton font une distinction entre « contre-révolution » et « anti-révolution ». La première est la réponse d’un régime au pouvoir à un soulèvement populaire qui cherche à renverser l’ordre ancien. « L’essence d’une situation révolutionnaire est que la transformation profonde, sociale ou politique, passe de quelque chose qui ne pouvait pas arriver à quelque chose qui pourrait très bien arriver. »10
Un mouvement révolutionnaire issu de la crise climatique signifierait une force populaire menaçant le capital fossile à un point tel que sa capacité à maintenir son pouvoir serait remise en question. Mais « alors que la résistance germait un peu partout au début du millénaire, aucune situation révolutionnaire n’était en vue, et donc aucune contre-révolution n’était nécessaire ; mais la logique inhérente à la situation planétaire était telle qu’une _anti-_révolution devait être imaginée ». Alors qu’une contre-révolution se mobilise contre une révolution réelle, une anti-révolution mobilise la classe dirigeante contre une révolution imaginaire.
Cela explique en grande partie la montée actuelle du fascisme aux États-Unis et dans d’autres parties du monde. Dans The Anatomy of Fascism, Robert Paxton souligne que les seules fois où les fascistes ont accédé au pouvoir – en Italie et en Allemagne – Hitler et Mussolini n’ont pas renversé le régime existant. Ils ont été invités à gouverner par les classes dirigeantes qui craignaient des révolutions de type bolchevique. Bien que les mouvements socialistes et communistes aient été bien présents dans ces deux pays, il s’agissait davantage, selon les termes de Malm et Carton, d’anti-révolutions que de contre-révolutions contre un soulèvement réel qui a conduit les classes dirigeantes à accueillir les fascistes avec le soutien populaire, leurs alliés conservateurs et leur rhétorique anti-bolchevique.11
Y a-t-il une analogie avec le phénomène Trump ? Il n’est pas arrivé au pouvoir par ses propres moyens, porté par son talent ou son intelligence. Il n’est pas non plus arrivé au pouvoir grâce aux frustrations refoulées de la classe ouvrière blanche. D’innombrables autres aspirants Führer racistes tout aussi bouffons étaient présents. L’industrie capitaliste du divertissement l’a propulsé sur le devant de la scène pour la raison habituelle : le profit. Mais son attrait en tant qu’animateur de téléréalité de droite lui a donné l’idée de passer du divertissement à l’information en se présentant à l’élection présidentielle. Il l’a fait pour la raison habituelle, sans s’attendre à gagner : cela lui apporterait non seulement de l’argent, mais aussi la célébrité, sa drogue préférée. Il était soutenu par Rupert Murdoch et son équipe de charlatans de Fox News, toujours prêts à gagner de l’argent en flattant ce qu’ils perçoivent comme la culture dysfonctionnelle de la classe ouvrière blanche et des petits entrepreneurs. Ce revirement de situation a conduit à la farce politique qui se joue actuellement à Washington.12
Les entreprises du secteur des énergies fossiles et leurs financiers ont compris qu’ils pouvaient s’emparer du Parti républicain, et par conséquent du gouvernement, s’ils parvenaient à se débarrasser de leur dégoût « élitiste » pour Trump et à rejoindre le mouvement. Ils ont sauté sur l’occasion. Mais cela soulève la question suivante : pourquoi le capital fossile ressentirait-il le besoin de gagner plus de contrôle sur le gouvernement, alors qu’il avait déjà tant d’influence, c’est-à-dire de pouvoir ?13 Réponse : parce qu’un noyau dur de milliardaires, de multimillionnaires et de leurs employés sont conscients, même si certains d’entre eux ne le sont que semi-consciemment, que leur existence en tant que profiteurs est menacée par le changement climatique. Pas par la destruction physique de leur biosphère, cependant. Ils craignaient que si ce qu’ils savaient était vraiment compris par la population humaine, ils seraient expropriés et remplacés par la propriété publique dans une course à la transition vers l’énergie solaire et éolienne. Le fait qu’une telle voie soit la solution logique pour sauver le monde d’une souffrance énorme ne leur a même pas effleuré l’esprit. Ils semblent vivre selon une logique différente, celle des affaires, du profit, du capital en expansion constante. Une logique qui, pour ces seigneurs du monde et vassaux du capital, doit prévaloir sur toute autre. Ainsi, la folie des émissions continues de gaz à effet de serre est désormais guidée par la folie de la politique américaine et du sociopathe qui la dirige.
Andreas Malm et Wim Carton ont fourni une analyse pénétrante de la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons tous. C’est un monde en déclin, avec un effondrement climatique inévitable dû aux émissions passées et des dirigeants qui nous entraînent sur une trajectoire suicidaire. Le seul espoir qu’ils soulignent réside dans les contradictions du système capitaliste lui-même. L’interconnexion de toutes les entreprises par le biais des marchés financiers rend le capital fossile, avec ses profits gonflés, vulnérable à un krach provoqué par une menace perceptible de voir ses actifs perdus. C’est peut-être le seul moyen de freiner ce train fou. Vive l’effondrement ! disent Malm et Carton. Si une telle crise pourrait être l’occasion d’exproprier les capitalistes fossiles, leur pouvoir politique constitue un obstacle de taille. En attendant, ils nous exhortent à ne pas baisser les bras et à faire tout notre possible pour lutter contre la folie du dépassement.
- Andreas Malm et Wim Carton, Overshoot (Londres : Verso 2024).
- Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (Londres : Verso, 2016).
- Voir Mark Z. Jacobson, No Miracles Needed: How Today’s Technology Can Save our Climate and Clean Our Air (Cambridge : Cambridge University Press, 2023).
- Brett Christophers, The Price is Wrong: Why Capitalism Won’t Save the Planet (Le prix est faux : pourquoi le capitalisme ne sauvera pas la planète) (Londres : Verso, 2024).
- Karl Polanyi, The Great Transformation (La grande transformation) (New York : Farrar and Rinehart, 1944).
- Malm et Cartyon, Overshoot.
- p. 58
- p. 78
- Jacob Blumenfeld, « Managing Decline », dans Cured Quail 3, https://curedquail.com/Managing-Decline?mc_cid=6d8f4cfd98&mc_eid=326e790f07
- p. 94. Cité par Jamie Allinson, The Age of Counter-Revolution: States and Revolutions in the Middle East, 2022
- Robert O. Paxton, Anatomy of Fascism (New York : Vintage, 2005).
- Les meilleures analyses de l’ère Trump ont été fournies il y a longtemps par Sinclair Lewis (Babbitt, It Can’t Happen Here), Anthony Trollope (The Way We Live Now), Guy Debord et les situationnistes (Society of the Spectacle), sans oublier l’iconoclaste Gore Vidal dans ses romans historiques américains (de Burr à son dernier ouvrage).
- Voir Adam Hanieh, Crude Capitalism, Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market (Londres : Verso, 2024).
