
Traduction de Storage, Investment, and Desire: An Interview with Jonathan Levy
par Daniel Judt
Dans cet entretien, Daniel Judt s’entretient avec Jonathan Levy, historien renommé de la vie économique aux États-Unis, au sujet de son livre récemment publié, [The Real Economy : History and Theory][1] (Princeton University Press, 2025). L’ouvrage rassemble des essais, publiés ou non, que Levy a rédigés au cours de la dernière décennie. Nombre d’entre eux élaborent une toile de fond théorique pour son livre précédent, Ages of American Capitalism (Random House, 2021). Partant du principe qu’« aucune discipline des sciences humaines ou sociales ne dispose aujourd’hui d’une théorie convaincante de l’économie », Levy construit un nouveau récit de la vie économique à partir de la base. Pour ce faire, les essais de The Real Economy rassemblent des sources éclectiques. Les anciennes pratiques comptables éclairent l’histoire de l’entreprise moderne ; de nouvelles lectures des théories keynésiennes de l’investissement accompagnent les récits psychanalytiques du désir ; les approches pragmatistes de la vérité éclairent le processus du capital. Dans ce qui suit, nous commençons par une discussion sur la méthodologie de Levy avant de passer à sa conception de « l’économie réelle » et à ses implications pour l’histoire intellectuelle et la théorie critique.
Daniel Judt : J’aimerais commencer par une question sur la méthode. Dans The Real Economy, vous adoptez une approche méthodologique particulière, et peut-être même philosophique, pour penser l’économie, à savoir le pragmatisme. Tel que je le lis, vous utilisez le pragmatisme sur deux registres dans L’économie réelle. Le premier est une méthode qui encourage à la fois la « critique » et la « construction » – les titres des deux parties du livre – de l’idée de « l’économie réelle ». La seconde, sous-jacente, est l’affirmation selon laquelle le pragmatisme nous aide à comprendre le fonctionnement de l’économie. D’une certaine manière, le processus de la vie économique, en particulier dans le cadre du capitalisme, [s’accorde avec un processus d’enquête pragmatique][2]. Qu’est-ce qui rend le pragmatisme utile lorsqu’il s’agit de théoriser l’économie ?
Jonathan Levy : Le titre du livre, « l’économie réelle », est une construction issue de l’économie néoclassique d’après-guerre. Afin de modéliser l’économie et d’obtenir le type de traction analytique que l’économie d’après-guerre souhaitait atteindre mathématiquement, certains phénomènes devaient être exclus : principalement l’incertitude, l’argent et les préférences dérivées d’un contexte social. C’est la vision néoclassique de l’économie réelle de l’après-guerre que mon livre critique.
Mais je ne pense pas que l’économie en tant que corpus de connaissances puisse être simplement rejetée par une critique idéologique ou une critique de son « individualisme méthodologique ». Je suis beaucoup plus intéressé par le fait de jouer avec elle. Le pragmatisme est une façon très ludique d’aborder la vie. Je ne pense pas que nous puissions simplement dire « les cent dernières années ont été une erreur, revenons à la période d’avant-guerre et recommençons ». Un engagement critique envers l’économie d’après-guerre est nécessaire. La première partie du livre examine donc ce que l’économie néoclassique a exclu et tente de donner un sens à ces sujets, d’écrire leur histoire afin d’élaborer une théorie positive différente de l’économie réelle. Mes méthodes dans la première partie du livre sont principalement historiques et empiriques. Il y a une sensibilité pragmatique derrière cela : si nos concepts ne fonctionnent pas correctement, nous devons nous ouvrir au monde au lieu de passer immédiatement à un niveau d’abstraction plus élevé !
Dans la deuxième partie du livre, intitulée « construction », j’essaie d’aller au-delà de la critique et de proposer un concept d’économie théorisé de manière positive. Mais mon but ici n’est pas d’établir une définition objective et transcendante de l’économie sur laquelle nous pourrions tous nous mettre d’accord et qui existerait pour toujours. Au contraire, l’intention est de garder ce concept positif ouvert à la critique elle-même, tout en considérant que cet effort de construction en vaut la peine, qu’il est productif.
Je n’avais pas pensé à ce deuxième registre, le lien entre le pragmatisme et le processus du capitalisme, mais cela me semble juste.
DJ : Pour réussir ce double mouvement de critique et de construction, vous faites appel à un moment de la pensée économique du début du vingtième siècle – une période que l’économiste britannique G. L. S Shackle a appelée « [les années de la haute théorie][3] ». La plupart des protagonistes de votre livre sont issus de cette période. Thorstein Veblen et J. M. Keynes sont particulièrement importants, mais il y en a d’autres aussi : Des économistes américains comme Irving Fisher et Frank Knight, mais aussi Sigmund Freud, qui joue un rôle essentiel dans votre examen de Keynes. Qu’est-ce que vous trouvez de généreux dans cette période du début du vingtième siècle ? Comment ses théoriciens nous aident-ils à prendre la mesure de « l’économie réelle » ?
JL : Les disciplines universitaires modernes sont apparues à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais elles ne se sont consolidées que dans l’après-guerre. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des disciplines – Keynes et Veblen étaient professeurs d’économie – mais elles étaient beaucoup plus poreuses. Il y avait plus de circulation entre elles et beaucoup de débats sur la manière dont les nouvelles disciplines allaient s’articuler les unes avec les autres. Pour moi, l’une des raisons de revisiter cette période de l’entre-deux-guerres, ces « années de haute théorie », est que de nombreux penseurs ont posé des questions telles que « qu’étudions-nous, et comment savons-nous que nous l’étudions ? » Ce sont ces débats que je trouve particulièrement générateurs pour reposer la question de ce qu’est l’économie.
Dans l’après-guerre, l’économie en tant que discipline est devenue obsédée par la méthode. Cette démarche a été en partie couronnée de succès. Permettant de parcourir une grande variété de sujets, l’économie est devenue, à bien des égards, la méthodologie de référence des sciences sociales (et elle le reste encore aujourd’hui). Mais le prix à payer pour l’obsession méthodologique de l’économie est qu’elle a complètement perdu de vue son sujet : l’économie elle-même.
DJ : Vous appelez à « une nouvelle ère de pluralisme méthodologique » en partie parce que « à notre époque, l’économie doit à nouveau être fixée », c’est-à-dire maintenue stable en tant qu’objet d’étude. Je me demande si ce que vous dites ici n’est pas un corollaire de cela : nous devons défixer nos disciplines. Il faut un peu plus d’itinérance entre les frontières disciplinaires durcies et calcifiées si nous voulons avoir une prise sur ce qu’est notre sujet d’étude.
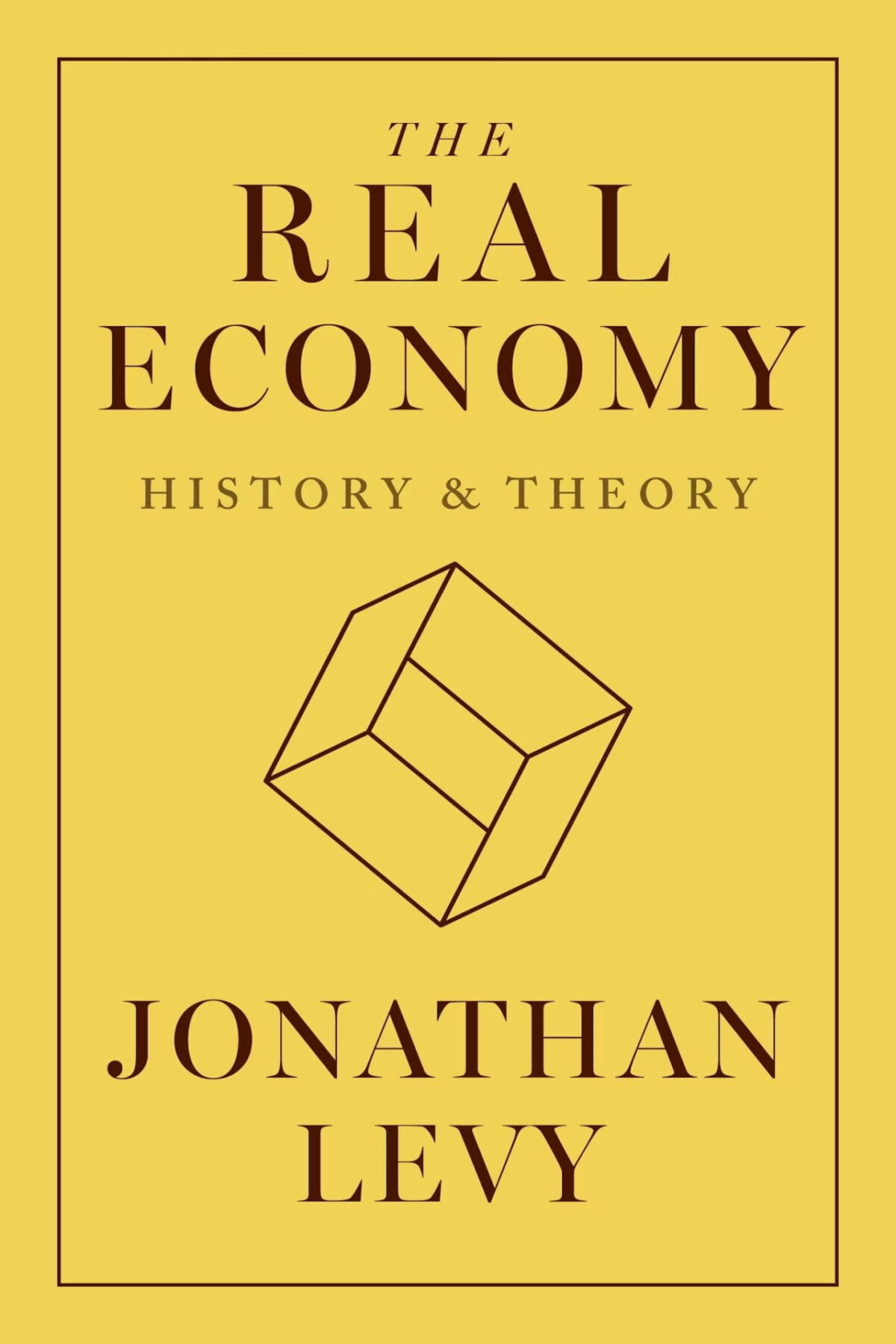
JL : C’est très bien présenté. Il y a un aspect autobiographique à mon argumentation. J’ai obtenu mon doctorat en 2008, au moment même où la crise financière éclatait et où les départements d’histoire, en particulier les départements d’histoire des États-Unis, s’intéressaient de nouveau aux sujets économiques au sens large. À cette époque, l’« histoire économique » en tant que sous-domaine n’était pas du tout présente dans les départements d’histoire. Au cours des années 1970 et 1980, ce que l’on a appelé la nouvelle histoire économique aux États-Unis a placé l’histoire économique dans les départements d’économie, l’idée étant qu’en utilisant la méthodologie de l’économie, on pouvait mieux écrire l’histoire économique. En conséquence, les historiens (moi y compris) ne se sentaient pas à l’aise en se décrivant comme des historiens économiques. Cela ressemblait trop à une méthodologie qui appartenait aux départements d’économie et non aux départements d’histoire.
Pourtant, je trouvais ce clivage assez étrange. Pourquoi les historiens n’ont-ils pas laissé l’histoire politique aux départements de sciences politiques ? Pourquoi les historiens n’ont-ils pas laissé l’histoire culturelle aux départements d’anthropologie ou l’histoire sociale aux départements de sociologie ? Qu’y a-t-il de si spécial dans l’histoire économique ? Et qu’est-ce que « l’économie » a de si particulier ? Est-elle différente des autres sujets étudiés par les historiens, qu’il s’agisse de la société, de la culture ou de la politique ? Par ailleurs, est-il vrai qu’il n’y a rien dans la discipline moderne de l’économie qui soit utile aux historiens ?
Ce livre est le résultat de ces questions. J’ai le sentiment que les historiens ont besoin de s’engager de manière productive dans l’économie et l’histoire économique (telles qu’elles sont pratiquées dans les départements d’économie) – même les historiens qui, comme moi, critiquent la méthodologie de l’économie néoclassique dominante. En d’autres termes, une partie de ma motivation ici est d’affirmer qu’il existe des traditions littéraires dans la théorie économique qui présentent un intérêt œcuménique. Keynes et Veblen, tous deux théoriciens de l’économie, sont de bons exemples pour la raison précise que vous suggérez. Ils ont pensé et écrit à une époque où les frontières étaient floues entre ce qui était considéré comme tel et ce qui ne l’était pas.
DJ : Je pense qu’il serait utile de passer maintenant à votre image de l’économie réelle, puis de revenir aux critiques et aux récits historiques que vous proposez dans la première moitié du livre. Le chapitre 8, « La théorie générale de l’économie », s’appuie sur Keynes pour proposer une définition pratique de « l’économie réelle » : « un ordre spatio-temporel limité de production sous contrainte de demande, déterminé par des relations comptables logiques entre les différents stocks de richesse dans l’économie qui génèrent les différents flux de revenus dans le temps au sein de celle-ci ». Pouvez-vous nous expliquer cette construction ? Qu’est-ce que l’économie réelle ?
JL: Dans tout le livre, s’il y a une source à laquelle je puise, c’est bien la comptabilité. Je pense vraiment que l’économie vient de la comptabilité. Les pratiques comptables sont nées en même temps que l’écriture humaine dans l’ancienne Mésopotamie et l’Égypte, où les dirigeants ont développé des systèmes de comptabilité pour rendre compte de la manière dont ils stockaient les richesses au fil du temps. Quel est le premier acte qui crée l’économie ? Ce n’est ni la production ni l’échange (marchand ou autre). C’est le stockage de la richesse dans le temps, auquel j’associe l’investissement.
Pour moi, l’investissement est une catégorie large qui a trait à la manière dont nous nous situons par rapport à l’avenir. Il s’agit d’une scène d’action très importante. Ce qui est unique dans l’essor de la civilisation humaine sédentaire, c’est le stockage des choses dans le temps. Nous avons commencé à stocker des choses lorsque nous avons créé les premiers États du monde et, selon moi, les premières économies du monde. Comment évaluer, comptabiliser, distribuer et conceptualiser ce que nous stockons au fil du temps ? C’est là que naît l’économie.
DJ : Bien que vous visiez une théorie de l’économie en général, vous consacrez également plusieurs essais à la théorisation du capitalisme en tant que forme historiquement spécifique, et peut-être unique, de la vie économique. Dans le chapitre trois, « Le capital en tant que processus », vous définissez le capital comme suit : « Le capital est un type particulier de processus d’évaluation pécuniaire, associé à l’investissement, dans lequel le capital peut (ou non) devenir un facteur de production. Vous poursuivez en affirmant que la « plus grande transformation » du capitalisme consiste à « ordonner l’action économique actuelle vers un avenir incertain, par opposition à la simple reproduction du passé économique ». Peut-être pourrions-nous développer chacune de ces affirmations. Le capital est-il une forme particulière dans laquelle nous stockons la richesse au fil du temps, une forme qui s’accompagne d’un type particulier d’orientation vers l’avenir ?
JL : Il serait peut-être préférable de dire que le capital est la manière dont nous stockons la valeur dans le temps. Je considère la richesse comme quelque chose de matériellement incarné qui a une utilité – on pourrait parler de « valeur d’usage » si l’on veut. Le capital est, je pense, déjà plus intangible. Il peut être simplement capturé dans les comptes, dans les grands livres, sur un écran d’ordinateur, ou sous la forme de valeur sans nécessairement correspondre à la richesse. L’un des aspects étranges du capitalisme est que nous ne comprenons pas encore tout à fait comment ces relations de valeur interagissent avec la production de richesse. Nous savons qu’il y a eu un moment dans l’histoire du capitalisme, à peu près à l’époque de la révolution industrielle, où ces processus se déroulaient de manière tout à fait parallèle. L’accumulation de capital sous forme de valeur conduisait à des augmentations de la productivité en ce qui concerne la production de richesses. Aujourd’hui, la situation semble beaucoup plus compliquée. Ces deux dynamiques sont beaucoup plus distendues.
L’argent étant une réserve de valeur dans le cadre du capitalisme, les détenteurs d’argent sont toujours confrontés au choix de l’investir dans la production ou de continuer à le stocker dans des formes liquides de richesse. Ainsi, ce premier acte – décider comment la richesse évolue dans le temps, et donc comment l’économie évolue dans le temps – est toujours en train de se reproduire.
Mon sentiment qu’il faut faire une distinction très nette entre la richesse et la valeur vient probablement de ce que j’ai entendu [Moishe Postone][6] dire lors d’un séminaire à l’université de Chicago il y a 20 ans. C’est une idée qui vient de Marx. Mais je pense aussi que la valeur provient des attentes futures. Il est possible d’y parvenir grâce à Marx, mais il faut pour cela contourner de nombreuses discussions sur la théorie de la valeur du travail : le travail mort incarné dans les marchandises.
Dans un passage de la Théorie générale de Keynes, que je cite dans le livre, il affirme que toute richesse est produite par le travail, critiquant ainsi la notion de capital en tant que « facteur de production ». Pour Keynes, il n’y a qu’un seul facteur de production – le travail – et je suis d’accord avec lui. Keynes a une théorie de la richesse basée sur le travail, mais la valeur est une question différente. Il n’a pas du tout de théorie axiomatique de la valeur, qu’il s’agisse de travail, de marginalisme ou autre. Au lieu de cela, il affirme, en s’inspirant d’une ligne pragmatique issue de Cambridge à l’époque, particulièrement évidente chez Wittgenstein, que la valeur est une question de « convention ». Essayer de théoriser un processus subreptice par lequel des valeurs plus réellement objectives existent dans l’économie, en dehors de nos tentatives actives d’évaluer les choses par le biais de pratiques telles que la comptabilité, n’est pas une façon utile de penser la valeur dans l’économie, à mon avis. En tout cas, elle peut très facilement basculer dans la métaphysique. Quelle est la véritable valeur d’une marchandise ? Je ne pense pas qu’il y en ait une.
DJ : L’argent est l’un des concepts que vous nous exhortez à réintégrer dans l’image de l’économie réelle, car il a été largement exclu par l’économie néoclassique. Je me demande si nous pourrions parler du rôle que vous voyez jouer à l’argent dans l’économie réelle, et aborder également un autre concept clé de votre livre : le désir. Si l’argent est une réserve de richesse au fil du temps et si, en particulier sous le capitalisme, la question de savoir s’il faut stocker la richesse dans l’argent ou l’investir dans des placements fixes à long terme se pose constamment, les désirs des détenteurs de richesse quant à la manière de détenir cette richesse semblent jouer un rôle crucial dans la vie économique.
JL : Je pense qu’il y a une question intéressante avant cela. Comment en arriver à une théorisation de l’économie dans laquelle l’argent est exclu ? L’argent semble très important dans la vie économique. C’est une étrange réussite que de l’avoir conceptualisée comme étant en dehors de l’économie réelle ! Mais il y a tout de même quelques raisons de le faire.
La première est que la monnaie est un symbole, un signe. Il est donc facile de la classer, d’un point de vue épistémologique, comme épiphénomène : elle ne fait pas partie du monde matériel, c’est-à-dire de la « base ». Une deuxième raison est que l’on peut intégrer la monnaie dans le marxisme, dont nous avons parlé, ou dans l’économie néoclassique, mais il doit s’agir d’un type de monnaie très spécifique : soit un équivalent universel, soit un moyen d’échange. Pourtant, nous savons que la monnaie a d’autres fonctions dans l’économie dans laquelle nous vivons. L’une de ces fonctions consiste à stocker de la valeur. De ce point de vue, le capitalisme se distingue en partie par le fait que l’argent devient une réserve de valeur dominante.
Je tiens à souligner à quel point le problème de la monnaie est épineux. Keynes était un économiste monétaire. Il a écrit le Traité de la monnaie, qu’il pensait être son couronnement, puis il l’a abandonné et a écrit la Théorie générale. Dans cette dernière, il voulait notamment montrer comment la monnaie était liée à la sphère de la production. Il s’agit là d’un défi de taille, et personne n’est parvenu à élaborer un concept économique qui intègre pleinement la dynamique monétaire et le domaine de la production. Ce n’est tout simplement pas facile à faire en raison de l’équipement conceptuel dont nous avons tous hérité.
Donc, pour répondre à votre question : dans une économie capitaliste, l’argent doit être investi dans la production pour qu’il y ait production. La production dans son ensemble, l’emploi dans son ensemble, sont déterminés par l’incitation à investir. Mais l’incitation à investir est toujours en concurrence avec ce que Keynes appelle la préférence pour la liquidité, qui est une préférence psychologique sous le capitalisme qui peut être exercée par l’épargne et la thésaurisation de l’argent, la « propension à thésauriser ».
Quelle est la place du désir dans tout cela ? Dans le livre, le « sujet économique » paradigmatique n’est pas un travailleur. Il s’agit plutôt du type de sujet désirant dont il est question dans Freud ou dans l’Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, que je présente dans un chapitre sur la manière de conceptualiser le « flux » dans la vie économique. Si nous utilisons l’argent comme moyen d’échange, il s’agit alors d’un moyen pour atteindre une fin, où ce que nous désirons est ce que nous achetons avec de l’argent. Mais une fois que l’argent devient une réserve de valeur, il est possible qu’il soit désiré comme une fin en soi, même de manière pathologique. C’est précisément le diagnostic de Keynes sur le capitalisme : il nous permet de thésauriser pathologiquement de l’argent, face à l’incertitude, de sorte que nous ne réalisons pas notre potentiel économique dans les domaines actuels de la production et de la consommation. Dans ces conditions, il est très important de réfléchir à la manière dont le désir fonctionne pour les sujets économiques, car dans des conditions d’incertitude, il va déterminer où l’investissement se déplace. S’oriente-t-il vers la production ? Est-il thésaurisé sous forme d’argent ? Le désir devient crucial pour la dynamique qui crée l’économie réelle telle que nous la connaissons.
DJ : Il y a deux essais dans le livre qui font intervenir la psychanalyse de la manière la plus explicite. Dans l’un, « Primal Capital », vous utilisez le récit de Freud sur la névrose obsessionnelle pour expliquer le concept de Keynes sur la « propension à thésauriser ». Dans l’autre, « Stocks et flux », vous utilisez l’Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari comme moyen de reconceptualiser l’idée de « flux » dans l’économie. Plutôt que de considérer le capital comme un élément qui circule dans l’espace à l’ère de la mondialisation, comme c’était le cas à la fin du XXe siècle, vous considérez le capital comme un stock qui peut détourner ou réguler les flux de revenus au fil du temps.
Ces affirmations sont au cœur des chapitres les plus historiques de The Real Economy. Ici, je vous interprète comme racontant l’histoire du capitalisme américain au vingtième siècle comme une histoire de préférence pour la liquidité. A certains moments ou à certaines époques, la propension à thésauriser est surmontée et, pour un certain nombre de raisons contingentes, il y a une incitation généralisée à investir. À d’autres moments, dont le nôtre, la vie économique est en proie à ce que vous appelez la « loi de Keynes » : la propension à thésauriser l’emporte, la richesse est épargnée en prévision d’un avenir incertain et une contrainte de demande commence à se faire sentir dans le présent. Pourriez-vous expliquer comment votre théorie de l’économie réelle nous aide à comprendre les transformations du capitalisme au cours du dernier demi-siècle ? En quoi ce cadre est-il utile aux historiens ?
JL : Permettez-moi d’insister sur la névrose et la « propension à thésauriser », car je pense que c’est très difficile à comprendre, ou du moins il m’a fallu beaucoup de temps pour penser que je l’avais compris. Le point essentiel est que nous devrions considérer la thésaurisation comme quelque chose qui va au-delà des cas évidents (mettre de l’argent sous le matelas, par exemple). Keynes pensait que la spéculation elle-même était une sorte de thésaurisation – un mouvement d’argent entre différents objets de désir, mais rien ne se fixe jamais, tout va si vite que l’investissement réel, l’engagement réel, n’a jamais lieu. J’ai eu un véritable déclic lorsque j’ai lu la Théorie générale en même temps que je donnais un cours dans lequel je lisais beaucoup de Freud. Freud parle du désir du névrosé obsessionnel de créer de l’incertitude, ce qui l’empêche d’entrer dans le monde et de vivre sa vie d’une manière significative et riche. Je pense que c’est aussi ce que Keynes disait. Peut-être avons-nous tous connu des périodes de notre vie qui nous ont semblé pleines d’activité, mais qui, avec le recul, nous ont fait réaliser que nous n’avions pas grandi ou évolué du tout. Rien ne s’est vraiment passé. Je pense que c’est là le diagnostic le plus original de Keynes sur la pathologie du capitalisme. Le capitalisme connaît la thésaurisation traditionnelle, mais il y a aussi ce revers de la médaille : la spéculation, où les investisseurs ne peuvent pas fixer leurs désirs sur un objet suffisamment longtemps pour s’engager dans un investissement.
Si l’on se réfère à l’arc du vingtième siècle, on constate un taux élevé d’investissements fixes dans les structures industrielles pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Cela a fait précisément ce que Keynes avait dit que cela ferait. Il a augmenté la production et l’emploi, entraînant une hausse des salaires et des profits. Mais quelque chose s’est produit dans les années 1980 : une préférence beaucoup plus marquée pour la liquidité, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Le capital est beaucoup plus mobile, plus instable, et nous souffrons d’une incitation insuffisante à l’investissement. C’est précisément à cette époque que la science économique (et d’autres disciplines également) a commencé à décrire le capital comme un « flux », par opposition à un « stock ». Cette obsession du flux dans le discours académique et politique de la fin du vingtième siècle indique que le capital a changé. Le capital est devenu un indice de préférence croissante pour la liquidité.
Quant à la valeur de ce récit, c’est à d’autres de décider, mais je dirais que le défi, peut-être une faiblesse, de mon récit est qu’il semble pointer vers un registre très psychologique et subjectif. L’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu consacrer du temps à la psychanalyse dans ce livre est que ce registre psychique est important pour le capitalisme et que nous devrions l’analyser en tant que tel. Mais lorsqu’il s’agit d’écrire l’histoire, la question est de savoir si l’on peut relier le registre psychologique à d’autres registres : ce qui se passe dans la politique, la culture et les mouvements sociaux. Il faut équilibrer ces registres et les relier dans un récit convaincant. L’un des enjeux du livre est que nous pourrions être en mesure de le faire. Je pense qu’il existe des récits puissants que nous pourrions écrire en nous appuyant sur cette perspective théorique.
DJ : Dès que l’on pose la question de savoir qui surmonte la propension à thésauriser dans les États-Unis du XXe siècle, quelles sont les incitations à investir qui finissent par l’emporter , on est plongé dans des questions sociales et historiques. En particulier, vous êtes plongé dans des questions relatives à l’État. Que peut faire l’État pour inciter les détenteurs de richesses à en faire usage ? Qui contrôle l’incitation à investir ?
L’un des chapitres les plus importants de votre précédent ouvrage, [Ages of American Capitalism][7], est un compte-rendu de la réponse à ces questions dans les États-Unis de l’immédiat après-guerre, lorsque le mouvement ouvrier a tenté, en vain, d’obtenir un minimum de contrôle sur le processus d’investissement. Il me semble que les enjeux politiques de The Real Economy sont similaires. Les questions centrales qui déterminent la forme de notre vie économique concernent le contrôle du processus d’investissement : si ce contrôle est socialisé ou individualisé, comment il est déterminé, comment nous pourrions le reconfigurer à notre époque. Diriez-vous que c’est juste ?
JL : Oui, je suis d’accord. Le livre comporte un aspect normatif. Si la préférence pour la liquidité est élevée, si les détenteurs de richesses s’accrochent essentiellement à leur patrimoine, cela va accroître les inégalités. Il y a toutes sortes de raisons de s’y opposer. Mais il ne suffit pas de dire que tant que l’on investit dans le capital fixe, c’est bon. Non seulement le montant de l’investissement, mais aussi ce dans quoi nous investissons, devraient être soumis à un test démocratique de légitimité. Mais même dans ce cas, on peut supposer qu’il y aurait une procédure démocratique par laquelle nous continuerions à investir dans des choses comme un système énergétique à base de combustibles fossiles.
Pour revenir à un point précédent : l’un des aspects de la thésaurisation – et ici l’image des gens qui fourrent des pièces de monnaie sous le matelas ou dans le sol est en fait utile – est que si vous ne pouvez pas accéder au capital, vous ne pouvez pas le contester. Nous souffrons encore de nostalgie dans nos politiques de production industrielle. Est-ce que je veux à nouveau construire des usines géantes et magnifiques ? Non, je ne le souhaite pas. Mais j’aimerais que le capital soit littéralement fixé dans des espaces où les gens, en particulier ceux qui sont privés de pouvoir, peuvent le contester. Sinon, on se retrouve dans une situation où les gens ordinaires n’ont pas d’influence réelle sur le capital, ce qui s’est produit au cours des cinquante dernières années. Cela n’a pas été une bonne chose.
DJ : Cela nous amène à deux autres moments historiques sur lesquels vous revenez à plusieurs reprises dans The Real Economy. Il s’agit de l’émergence du capitalisme et, potentiellement, de notre émergence de lui. Dans les deux cas, la relation entre le capitalisme et la contingence, c’est-à-dire notre capacité à exercer un certain contrôle sur ce qui est, à bien des égards, un système compulsif, constitue une préoccupation majeure. Le début et la fin du capitalisme semblent être des périodes de contingence accrue que vous souhaitez explorer. Commençons par le début. Les historiens et les théoriciens sociaux ont proposé un grand nombre de récits concurrents sur l’émergence du capitalisme. Dans le livre, vous proposez deux histoires d’origine ou généalogies différentes. La première est le développement de l’idée d’« incertitude radicale », qui est liée à la transformation de la monnaie en réserve de richesse, dans le bassin méditerranéen du XIIIe siècle. Une autre est l’essor des investissements étatiques dans l’Empire britannique du XVIIe siècle, que vous attribuez à l’élargissement spatial de l’économie par la colonisation. Je me demande si vous pourriez nous parler de ces deux histoires d’origine. Pourquoi se concentrer sur eux ? Qu’est-ce qu’un récit adéquat de l’émergence du capitalisme devrait démontrer, selon vous ?
JL : Ces deux récits découlent de ma théorisation d’une économie capitaliste dans laquelle la valeur du capital est liée à l’avenir par le biais d’une certaine forme d’attente habituelle. Comment en arrive-t-on là, historiquement ? Comment nous attendons-nous à avoir un certain type d’avenir qui se réalise ensuite ? Cela diffère d’une approche typique des origines du capitalisme, qui recherche les origines de l’accumulation du capital. À cet égard, je pense que Marx a la meilleure approche. Il affirme que vous n’avez pas besoin d’une accumulation primitive (richesse du passé stockée sous forme de capital), mais plutôt d’un certain type de société. Pour Marx, cela signifie un type particulier de relation sociale, le travail salarié, mais mon point de vue est différent.
J’ai écrit le dernier chapitre du livre alors que je participais à un groupe de lecture sur la Théorie générale avec des étudiants de troisième cycle ici à Chicago. L’un d’entre eux, Patrick Graham, m’a demandé un jour : « Lorsque Keynes parle de la valeur du capital qui vient de l’avenir et du fait que le présent est déterminé par l’avenir, veut-il dire que nos idées sur l’avenir déterminent le présent ? Ou veut-il dire littéralement qu’il y a un chemin causal qui va de l’avenir au présent ? » Je pense que c’est peut-être la deuxième hypothèse ! Pour en revenir à la formation de l’« incertitude radicale », on trouve dans l’Europe médiévale une conception moralisée de l’incertitude qui entre en concurrence avec les notions religieuses d’un avenir qui n’est pas ouvert à l’activité économique capitaliste telle que nous la concevons.
La deuxième explication que je propose concerne l’élargissement géographique du monde économique, qui est en soi un moyen d’introduire une nouvelle notion d’avenir dans la vie économique. Dans le livre, j’appelle l’économie un « ordre spatio-temporel limité », ce qui signifie qu’elle peut intégrer une demande « externe » soit en modifiant les attentes futures, soit en élargissant les frontières spatiales de la vie économique. Voilà donc l’origine du XVIIe siècle que je propose. La découverte des Amériques et la conquête européenne du monde ont été des moyens d’ouvrir et d’exploiter une source externe de demande, qui a ensuite déclenché un nouvel ensemble d’attentes à l’égard de l’avenir, avec des implications pour ce que j’appelle le « côté offre » de l’économie, en rapport avec la structure de l’entreprise, l’utilisation du travail salarié et le recours aux combustibles fossiles (en plus des facteurs traditionnellement considérés comme relevant de cette catégorie). Je vois le capitalisme émerger de manière contingente comme la conséquence involontaire de ces développements.
DJ : Comment les historiens devraient-ils envisager la contingence après ce moment – après l’émergence du capitalisme ? Dans The Real Economy, vous affirmez que « le capitalisme est intrinsèquement vulnérable aux efforts collectifs visant à imaginer et à réaliser des avenirs économiques différents du passé ». Vous poursuivez en affirmant que les récits des historiens sur le capitalisme pourraient nous aider à exploiter cette vulnérabilité dans le présent. Une fois que l’économie devient capitaliste, où voyez-vous des moments de contingence qui pourraient conduire non seulement à des changements au sein du capitalisme, mais aussi à une émergence de celui-ci ?
JL: Je pense que cette question est liée à un certain nombre de problèmes. Il y a une pensée très marxiste selon laquelle le capitalisme était, dans son propre contexte, libérateur. Il nous fait envisager l’avenir comme ouvert et contingent, et quelque chose à ce sujet est au moins potentiellement émancipateur. Mais je pense que la réponse de Keynes serait de dire qu’une partie de ce qui bloque le potentiel émancipateur du capitalisme est la manipulation de cette incertitude par les détenteurs de richesses. En d’autres termes, nous devrions réfléchir à la manière de distinguer les différents types d’incertitude que le capitalisme engendre. Il peut engendrer des attachements pathologiques à l’incertitude qui sont liés aux inégalités et à la répartition inégale du pouvoir. Celles-ci bloquent toute forme de créativité, ce qui nous ramène au thème pragmatique de l’incertitude en tant qu’invitation à l’expérimentation : générer de nouvelles possibilités et de nouveaux avenirs.
L’une des choses que j’aime beaucoup dans Anti-Oedipus, dans sa critique de Lacan, est l’argument de Deleuze et Guattari selon lequel aucun sujet ne souffre jamais d’un manque d’objet. Les désirs de chacun se fixent sur un objet, même si c’est de façon temporaire. Si vous travaillez à partir de cet argument et que vous le reliez à d’autres points de ce chapitre, vous constaterez que même si vous ne possédez pas de richesses, votre désir est toujours situé ou fixé quelque part. Je pense que ma conception de l’économie dans le livre est ouverte à ce type de réflexion. Cela permettrait une vision plus large et sociale de l’économie, au-delà de la dynamique de la propriété des richesses.
Si vous envisagez les choses de cette manière, l’une des possibilités que cela ouvre serait une histoire sociale du capitalisme qui ne soit pas écrite comme un récit décliniste (la plupart des gens ne voulaient pas du capitalisme, puis on le leur a fait avaler), comme une fausse nostalgie d’une classe ouvrière dont les aspirations révolutionnaires ont été contrariées, ou, ce qui est tout aussi important, comme un récit cynique sur la complicité des travailleurs ou de la classe ouvrière avec le capital. Certains chercheurs, comme Gabriel Winant, travaillent sur ce sujet, ce qui est une bonne chose, car c’est une tâche énorme que de rompre avec ces récits dépassés et éculés qui ont dominé l’écriture de l’histoire sociale du capitalisme au vingtième siècle. Le besoin de nouvelles formes émancipatrices de réflexion sur le capitalisme, y compris sous la forme de nouvelles histoires, ne pourrait être plus urgent aujourd’hui.
Jonathan Levy est professeur au Centre d’histoire de Sciences Po, Paris. Il est l’auteur de Freaks of Fortune : The Emerging World of Capitalism and Risk in America (Harvard UP, 2012) et de Ages of American Capitalism : A History of the United States (Random House, 2021). Il a obtenu son doctorat à l’université de Chicago.
Daniel Judt est doctorant en histoire à l’université de Yale. Ses recherches portent sur la théorie sociale de gauche et l’économie politique dans les États-Unis de la fin du XXe siècle.
Image en vedette : « Stockage de céréales, Ramesseum, Nouvel Empire, par Flemming Ubbesen, [CC BY 3.0][8] via [Wikimedia Commons][9].
[1] : https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691252551/the-real-economy?srsltid=AfmBOoreqH4-1Jdvp79GLmJjFjVPpRWYiVNVus8EThsps3o6H7MAp2Ew
[2] : https://www.jhiblog.org/2023/11/28/capitalizing-truth-pragmatism-and-the-logics-of-capital/
[3] : https://www.cambridge.org/us/universitypress/subjects/economics/history-economic-thought-and-methodology/years-high-theory-invention-and-tradition-economic-thought-19261939?format=PB&isbn=9780521274784
[4] : https://www.jhiblog.org/files/2025/02/real_economy_cover-683×1024.jpeg
[5] :
[6] : https://www.cambridge.org/core/books/time-labor-and-social-domination/B2429FE0E1B401CC2F775DC2683C2025
[7] : https://www.penguinrandomhouse.com/books/227741/ages-of-american-capitalism-by-jonathan-levy/
[8] : https://creativecommons.org/licenses/by/3.0,
[9] : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grain_storage,Ramesseum,_New_Kingdom-_panoramio.jpg
