Je comptais faire un billet sur, autour de la religion… le jour de Noël me semblait un moment approprié1Voir un des billets les plus populaire de ce blog : Repas de Noël avec les Bochimans. Mais Noël est-elle encore une fête religieuse ? Que reste-t-il des valeurs chrétiennes et catholiques dans la frénésie consommatoire du « Temps des fêtes » ?
Mais ce fameux « temps des fêtes » de fin d’année, ce creux de la lumière… il est plus vieux, plus ancien que la Nativité chrétienne. En fait celle-ci fut d’autant plus efficace et prégnante qu’elle a calqué ses rites et fêtes sur un calendrier civique ou culturel souvent lié aux moments saisonniers auxquels étaient associés des appels aux dieux (dieux des plantes et de l’agriculture; des cycles annuels des éleveurs et chasseurs; des mers imprévisibles et généreuses…).
nouvelles valeurs
Les familles rurales étendues qui se réunissaient à l’occasion des fêtes dans la grande maison. La distance et le peu de moyens de transport rendaient ces réunions exceptionnelles. Les familles urbaines, moins étendues, sont plus proches physiquement mais éloignées par leurs agendas chronométrés au quart d’heure. Ce qui rend aussi exceptionnel les réunions familiales.
La famille refuge, rempart de sécurité et de solidarité. Particulièrement dans les sociétés pauvres en services publics ? Le modèle des sociétés « nordiques », suivant la théorie de Inglehart, celles qui ont poussé le plus loin la lutte contre le sexisme et le paternalisme amenant un engagement politique des femmes sans pareil. Quarante-sept pour cent des élus sont des élues (en Suède). Le soutien public à la participation féminine ou égalitaire, grâce à un système de garderies, de congés parentaux obligatoires, de services aux ainés frêles… réduit la pression sur les familles tout en facilitant la participation des femmes au marché du travail.
La famille élargie aux amis, aux proches, aux personnes seules. La famille traversée de tensions politiques et culturelles dues aux écarts de générations, aux différences professionnelles et de fortunes. Tensions politiques soumises, aiguillonnées par les événements : élections, référendums, crises…
Moins de religion, de religiosité dans les coutumes… Les curés ne viennent plus fouiner dans les chambres à coucher, et c’est tant mieux. Mais une « société des choix individuels » qui ne compte que sur le marché pour répondre et soutenir ces choix, cette liberté, sera vite aux prises avec des niveaux d’inégalités insoutenables. Les « Cahiers de la bonne chanson » étaient aussi importants que les chants religieux dans les fêtes familiales. Des cahiers réalisés par un religieux désireux de promouvoir la « bonne chanson » et faire connaître et se préserver la tradition et le folklore francophone.
Les institutions, droits et programmes que nous avons créé depuis 75 ans afin de remplir les fonctions auparavant portées par des communautés religieuses et la charité chrétienne, ces institutions résultent de décisions collectives, politiques. Entre l’intention du législateur et la prestation de services de l’employé il y a une tension qui peut devenir conflictuelle. Pourtant les acquis historiques que sont les écoles, collèges et universités; ces hôpitaux, centres de soins et cliniques; ces réseaux de garderies, de clubs de sports, de groupes d’entraide et de soutien aux… enfants, mères seules, malades, vieillards, immigrants… ce sont ces institutions, ces services accessibles au quotidien qui réalisent, actualisent les nouvelles valeurs de nos sociétés a-religieuses.
Les Suédois sont les moins religieux mais aussi les plus généreux en aide internationale2La Suède consacre 1,36% de son revenu intérieur brut à l’aide internationale. Le Canada: 0,25%. Les plus égalitaires en termes de participation des femmes aux postes de pouvoir. Ce qui explique sans doute les avancées sociales en terme de soutien à la famille.
En tant que collectivités morales nous avons le devoir de punir, discréditer les comportements qui compromettent l’avenir collectif. Nous avons le pouvoir de réduire l’attractivité de certains produits, de certains avoirs et comportements. Si nous nous sommes débarrassés de la chape de plomb des soutanes et cornettes, ce n’est pas pour autant le « free for all« . Enfin ce ne devait pas l’être… le professionnalisme et la déontologie des infirmières et des travailleurs sociaux devaient remplacer les directives et principes qui orientaient les religieuses et religieux qui auparavant exerçaient ces fonctions.
Si le « temps des fêtes » est un temps de générosité et de partage… ces traditions ont été passablement frelatées par les pressions sociales et le consumérisme dominant.
« Il existe une forme de redistribution des richesses qui s’inscrit dans une démarche véritablement désintéressée. [Elle] repose sur un principe de solidarité collective : l’impôt. »
/
Continuer la lecture de « tradition, coutume, religion »Notes
- 1Voir un des billets les plus populaire de ce blog : Repas de Noël avec les Bochimans
- 2La Suède consacre 1,36% de son revenu intérieur brut à l’aide internationale. Le Canada: 0,25%



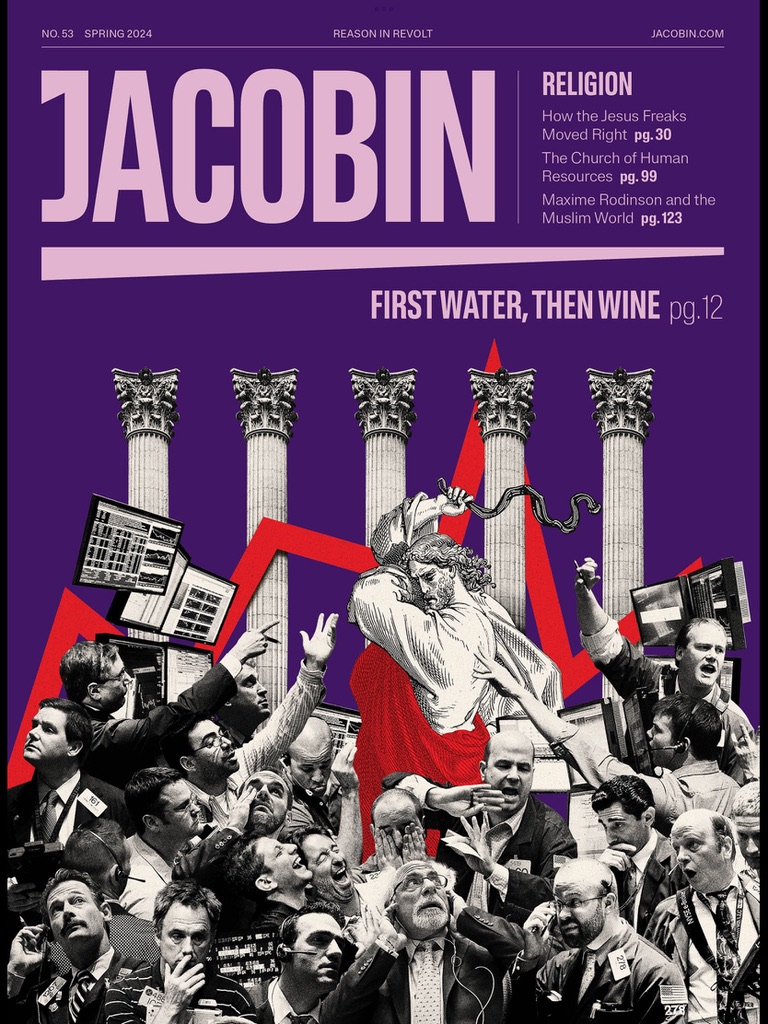



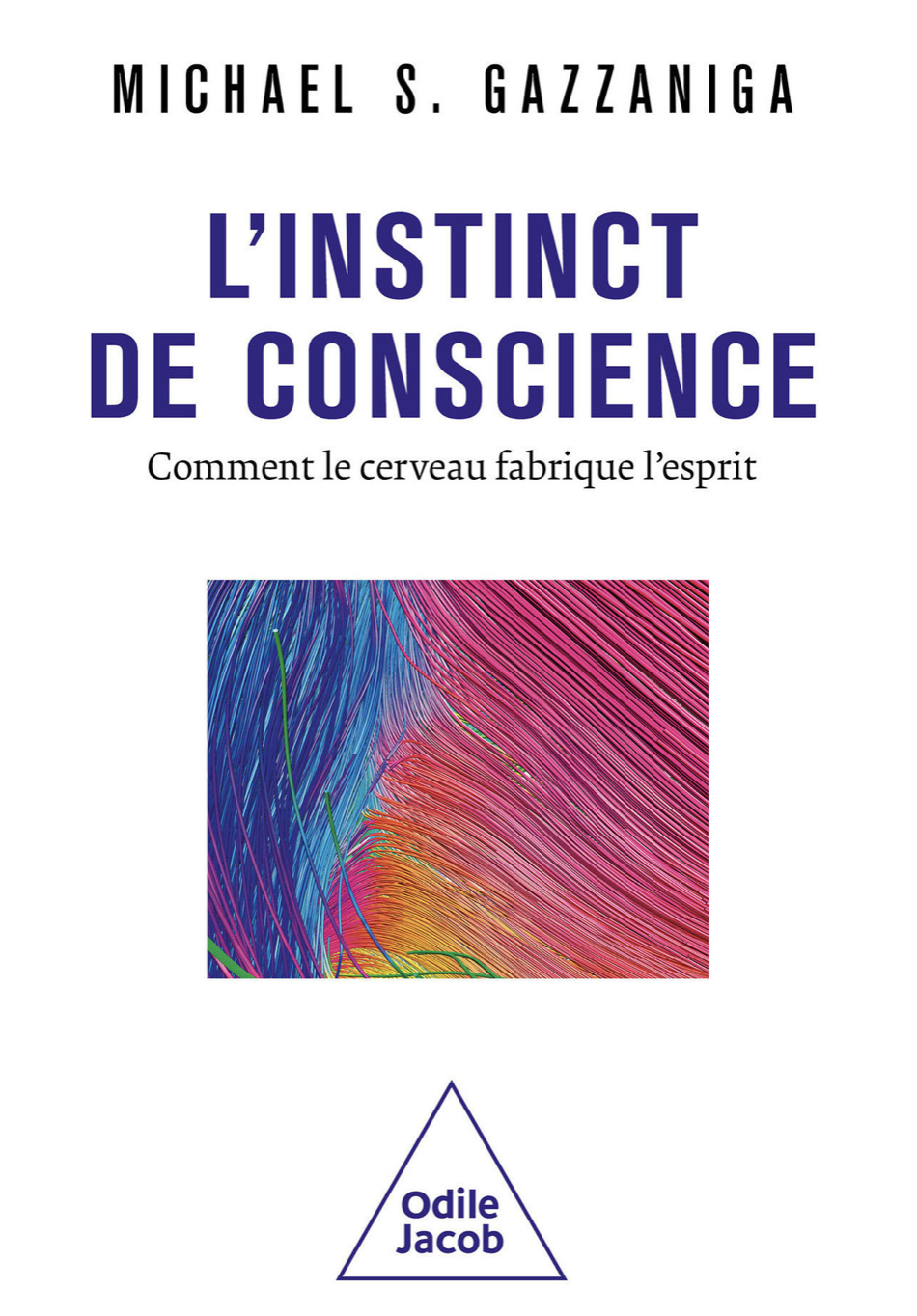
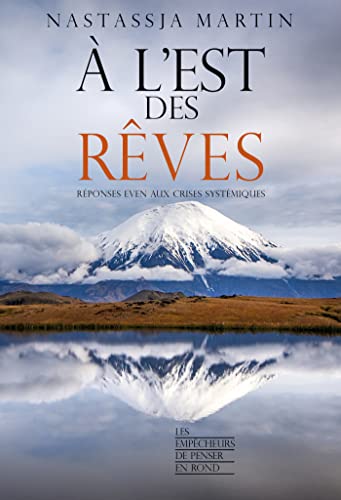


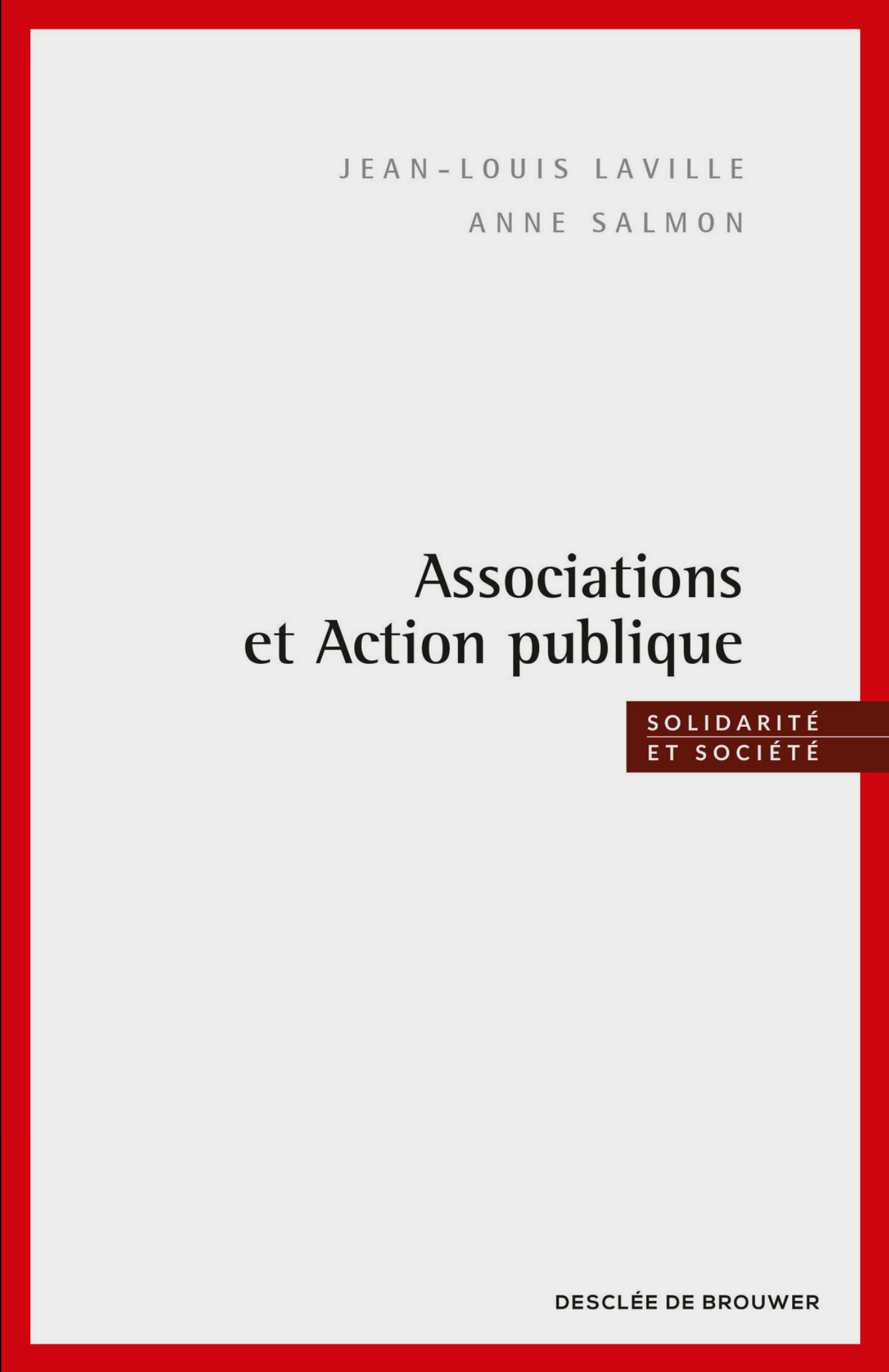
 C’est à une telle lecture des attachements et liens interespèces, associée à une approche d’anthropologie économique que Anna Tsing se livre avec
C’est à une telle lecture des attachements et liens interespèces, associée à une approche d’anthropologie économique que Anna Tsing se livre avec  Un ambitieux projet que celui de Latour, qui a voulu associer ses lecteurs dans un processus d’écriture et de poursuite de la recherche amorcée par son
Un ambitieux projet que celui de Latour, qui a voulu associer ses lecteurs dans un processus d’écriture et de poursuite de la recherche amorcée par son