Lettre à ma députée
Madame Carole Poirier, députée du Parti québécois représentant le comté de Hochelaga-Maisonneuve,
Je veux d’abord vous remercier, chère Carole, pour votre présence constante, infatigable dans le quartier et votre lutte, notre lutte pour obtenir un accès décent à des services médicaux de première ligne.
Par ailleurs si je prend la plume (ou le clavier) aujourd’hui c’est que j’ai un malaise lorsque je vois la prochaine campagne électorale du PQ s’articuler autour du slogan « Un État fort ». Je suis assez âgé pour que cela me rappelle, inévitablement, les années ’60-70 où un tel slogan référait à un mouvement de fond, une vraie révolution qui a transformé et développé en peu de temps les systèmes de l’éducation, de la santé, de l’épargne collective des Québécois.
Mais à la fin des « trente glorieuses » (1945-1975) n’est-ce pas l’affirmation présomptueuse et trop souvent péremptoire des prérogatives de l’État qui a creusé la tombe de la social-démocratie et ouvert la porte à trente années de domination néo-libérale ? Oui, il faut réaffirmer l’importance de l’action publique, j’en suis. Mais l’État fort des années 2020-2050 devrait être différent de celui des années 1950-1980.
L’État animateur des années 80-90 fut trop défensif, déséquilibré qu’il était par la délocalisation et la fin du pacte fordiste. Aux prises avec les risques d’inflation et un endettement croissant, l’État avait vite abandonné son rôle d’entrepreneur pour se replier sur celui d’animateur. Si elle a permis de vaincre le « bloc communiste » et de réduire l’ampleur des conflits armés entre grandes puissances, cette longue période de libre développement du capital et du marché nous a aussi conduit au bord d’un gouffre environnemental et climatique. La politique du laisser faire n’est plus possible. Faut-il pour autant souhaiter le retour aux sixties ?
Comme le rappelait récemment Yves Vaillancourt dans les pages du Devoir (Les libéraux ont mis à mal un riche héritage social), les politiques sociales des années ’90 ont été vigoureuses et progressistes. C’est peut-être parce que l’« État fort » a su reconnaître sa faiblesse et accepter de négocier avec les mouvements syndical, communautaire, de l’économie sociale et du patronat… Au lendemain d’un référendum perdu (mais presque gagné) les rapports à la fédération canadienne pouvaient être rediscutés sinon renégociés, Ottawa ayant, de son côté, presque perdu.
Je suis d’accord avec Mintzberg : on se préoccupe trop de circonscrire les pouvoirs de l’État pour laisser l’initiative et la liberté aux acteurs privés et pas assez de la nécessaire limitation des errances et égoïsmes d’un privé qui se préoccupe peu de l’avenir, du bien commun et des laissés pour compte du développement actuel et passé.
Comment résister à l’actuelle vague populiste et éviter d’avoir nous aussi notre « mini-Trump » ? Au cours des trente dernières années (années funestes ? fumeuses ?) les États ont été contraints. Ils ont réduit leur capacité de taxation et ont emprunté aux riches plutôt que de les taxer ! Ceux-ci devenant deux fois gagnant : en payant moins de taxes et en recevant des intérêts (voir Du temps acheté Wolfgang Streeck).
S’il faut se rappeler, et rappeler à la gauche avec Yves Vaillancourt, que les années ’90 ont permis l’adoption de nombreuses politiques sociales progressistes, il faudrait aussi se rappeler et reconnaitre la justesse de certaines critiques de la droite : les mesures « mur-à-mur » n’ont pas toujours été favorables et manquent souvent de flexibilité. C’est d’ailleurs la première chose que vous m’avez dite, Mme Poirier lorsque nous avons échangé quelques mots sur la place du marché, récemment : « Nous voulons redonner voix aux régions — mais sans le « mur-à-mur » d’avant. »
La principale note d’espoir dans ce contexte pré-électoral plutôt maussade – c’est l’accord tripartite autour d’une promesse d’adoption d’un système électoral proportionnel. Mais ne nous emballons pas car on nous a déjà (plusieurs fois) fait cette promesse, aussitôt reniée une fois le parti au pouvoir. Le fait que cette promesse soit soutenue par tous les partis d’opposition est une première. Mettre en oeuvre la proportionnalité exigera plus qu’un amendement à la loi électorale. C’est à une nouvelle gouvernementalité que nous devons aspirer.
Et j’ai bien peur que le renouveau soit perçu par les électeurs québécois comme se trouvant plutôt du côté de la CAQ, tellement les stratégies mises de l’avant par la plateforme du PQ semblent orientées vers la préparation d’un troisième référendum : le renouveau attendra le nouveau pays. Comme s’il fallait être souverainiste pour souhaiter avoir un prochain gouvernement qui ne soit pas de droite.
 Pour faire court, car ce billet s’allonge, comment le PQ prévoit-il articuler pouvoir d’État et gestion des communs ? Ce nouvel État sera fort à condition d’être ouvert, flexible, sagace. Comment l’État saura-t-il fédérer les communs (villes, régions, secteurs économique…) ? C’est d’un Nouvel État fort que nous avons besoin. Et je ne crois pas que c’est en répétant, 132 fois plutôt qu’une((autant pour une plateforme « sans slogan »)), que ça nous prend un État fort pour les familles, les agriculteurs, les étudiants… que disparaîtront les effets du brainwashing de la droite depuis 40 ans : « l’État est trop fort, trop gros, trop coûteux, trop bureaucratique… »
Pour faire court, car ce billet s’allonge, comment le PQ prévoit-il articuler pouvoir d’État et gestion des communs ? Ce nouvel État sera fort à condition d’être ouvert, flexible, sagace. Comment l’État saura-t-il fédérer les communs (villes, régions, secteurs économique…) ? C’est d’un Nouvel État fort que nous avons besoin. Et je ne crois pas que c’est en répétant, 132 fois plutôt qu’une((autant pour une plateforme « sans slogan »)), que ça nous prend un État fort pour les familles, les agriculteurs, les étudiants… que disparaîtront les effets du brainwashing de la droite depuis 40 ans : « l’État est trop fort, trop gros, trop coûteux, trop bureaucratique… »




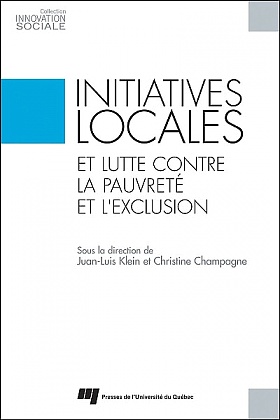 Et je suis pris (les deux bras jusqu’aux coudes) dans un processus particulier d’accompagnement d’un organisme local, lui-même aux prises avec des difficultés plutôt éloignées des débats théoriques. Pourtant j’ai trouvé appui dans la lecture de ce recueil Initiatives locales et lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Publié en 2011 sous la direction de Klein et Champagne, on y trouve de nombreuses descriptions de projets développés en, par différents milieux (urbains, ruraux, de banlieues), et aussi des essais de théorisation, de synthèse tirées de ces expériences toutes plus idiosyncrasiques les unes que les autres. Notamment la conclusion sous la plume de Jean-Marc Fontan et autres, intitulée Conditions de réussite des initiatives locales.
Et je suis pris (les deux bras jusqu’aux coudes) dans un processus particulier d’accompagnement d’un organisme local, lui-même aux prises avec des difficultés plutôt éloignées des débats théoriques. Pourtant j’ai trouvé appui dans la lecture de ce recueil Initiatives locales et lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Publié en 2011 sous la direction de Klein et Champagne, on y trouve de nombreuses descriptions de projets développés en, par différents milieux (urbains, ruraux, de banlieues), et aussi des essais de théorisation, de synthèse tirées de ces expériences toutes plus idiosyncrasiques les unes que les autres. Notamment la conclusion sous la plume de Jean-Marc Fontan et autres, intitulée Conditions de réussite des initiatives locales.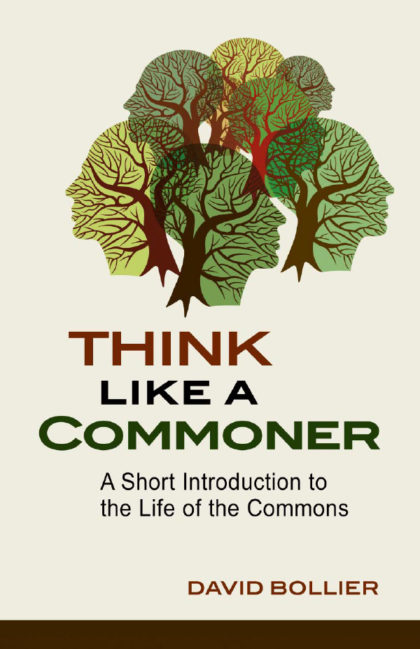
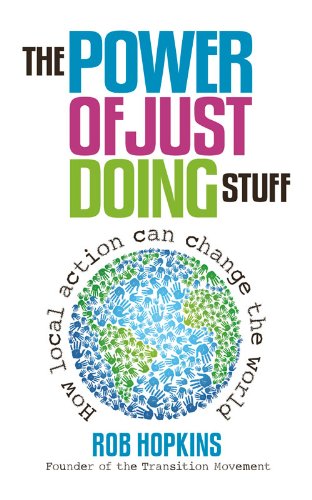
 ces mouvements et expériences, aussi jalouses soient-elles de leur autonomie, si l’on veut faire changer de cap au paquebot de l’extra
ces mouvements et expériences, aussi jalouses soient-elles de leur autonomie, si l’on veut faire changer de cap au paquebot de l’extra
