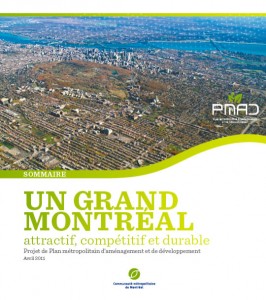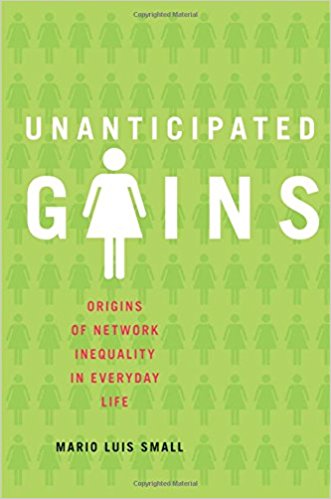Il est intéressant de constater que les parutions récentes sont souvent disponibles en format numérique (PDF ou EPUB) pour environ la moitié du prix du format papier. Enfin !
Ces trois titres rendent compte d’initiatives locales visant le développement territorial, la santé ou encore la lutte à la pauvreté.
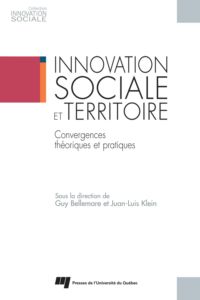
Innovation sociale et territoire tente une approche panoptique du territoire qui relierait les différentes disciplines (géographie, urbanisme, économie, sociologie) qui l’étudient. Des articles sur des initiatives de certains Offices municipaux d’habitation, sur la spatialité et le maintien à domicile, sur l’économie sociale en contexte de mondialisation, sur le développement régional et les relations industrielles… et d’autres plus généraux, sur l’innovation sociale ou la démocratie participative.
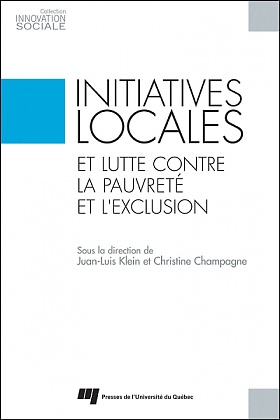
Initiatives locales et luttes contre la pauvreté et l’exclusion propose une analyse de 10 initiatives, dans trois régions du Québec (Montréal, Saguenay Lac-Saint-Jean et Bas-Saint-Laurent), identifiant les types de leadership, les acteurs mobilisés et stratégies déployées. Un beau tour d’horizon d’une diversité de projets innovants.
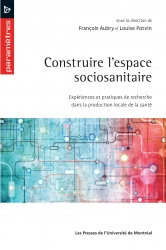
Construire l’espace sociosanitaire résume un ensemble d’expériences et de recherches en matière de « production locale de la santé ». Il s’agit de pratiques circonscrites au domaine de la santé publique, c’est-à-dire que les pratiques du réseau de la santé qui ont lieu dans les cliniques médicales, les hôpitaux, les laboratoires et pharmacies ne font pas ou peu partie de l’espace sociosanitaire décrit. Malgré ces limites, ou peut-être grâce à elles, le recueil comporte plusieurs textes intéressants, notamment une belle introduction à la théorie de l’acteur-réseau, une discussion sur les multiples sens du concept de communauté, une brillante analyse situant une action locale dans le cadre de planifications centralisées, ou encore une mise en perspective de différentes théories de l’acteur (stratégique, théâtral, réseau, communicationnel, historique, réflexif) appliquée à l’expérience de planification-développement dans le quartier Villeray de Montréal. Des textes qui rendent compte des travaux de recherche de la Chaire Approches communautaires et inégalités de santé.