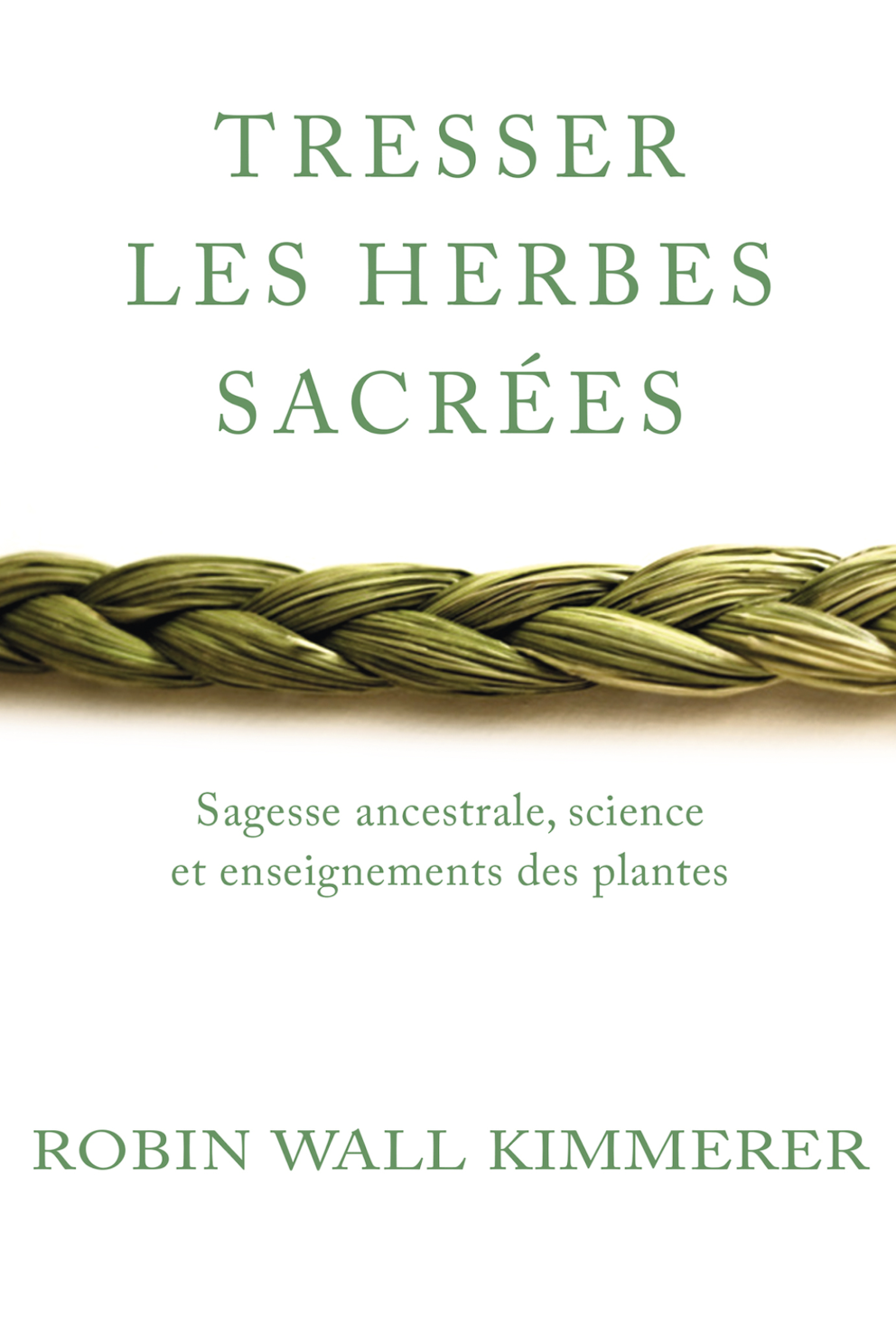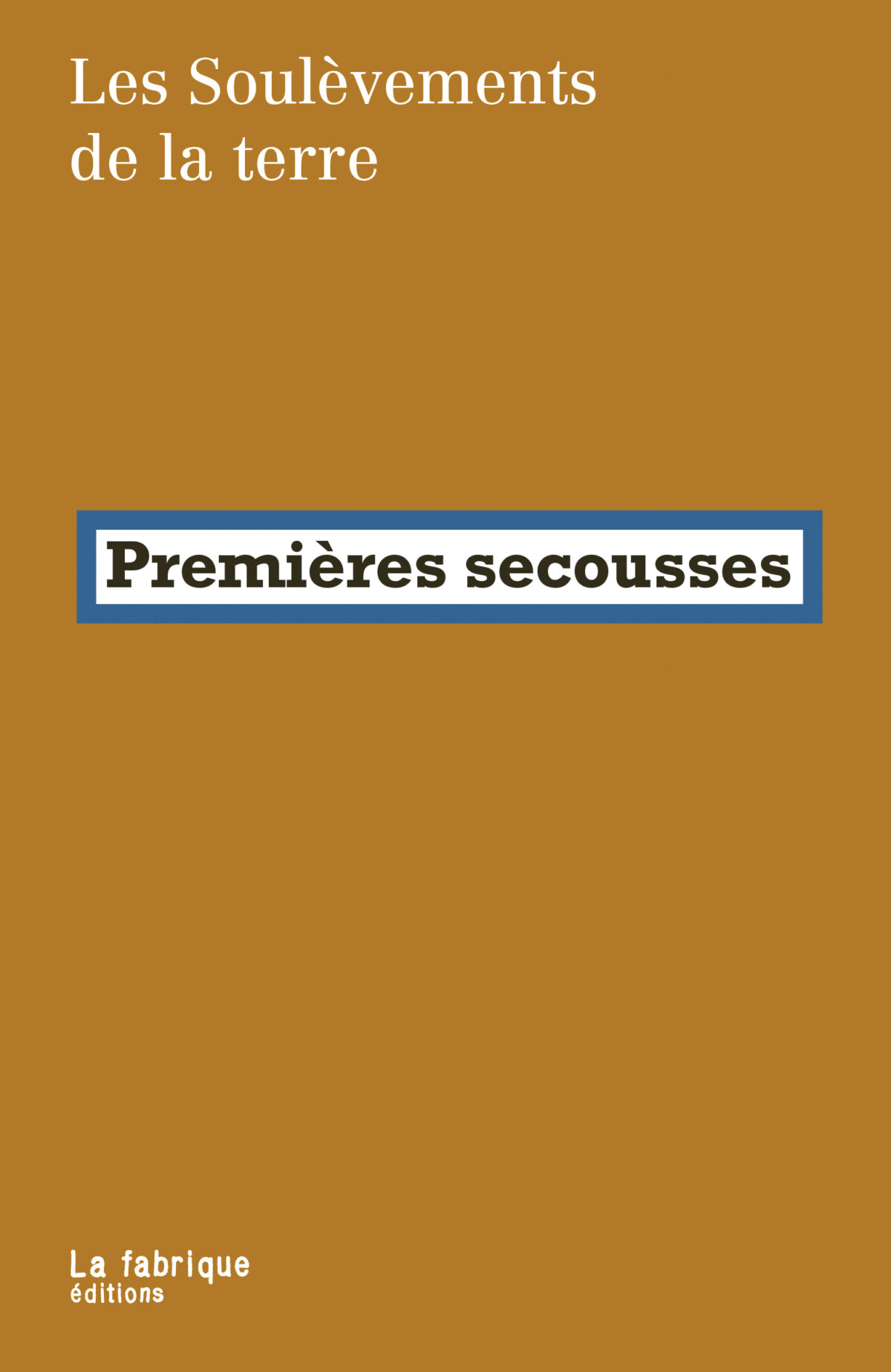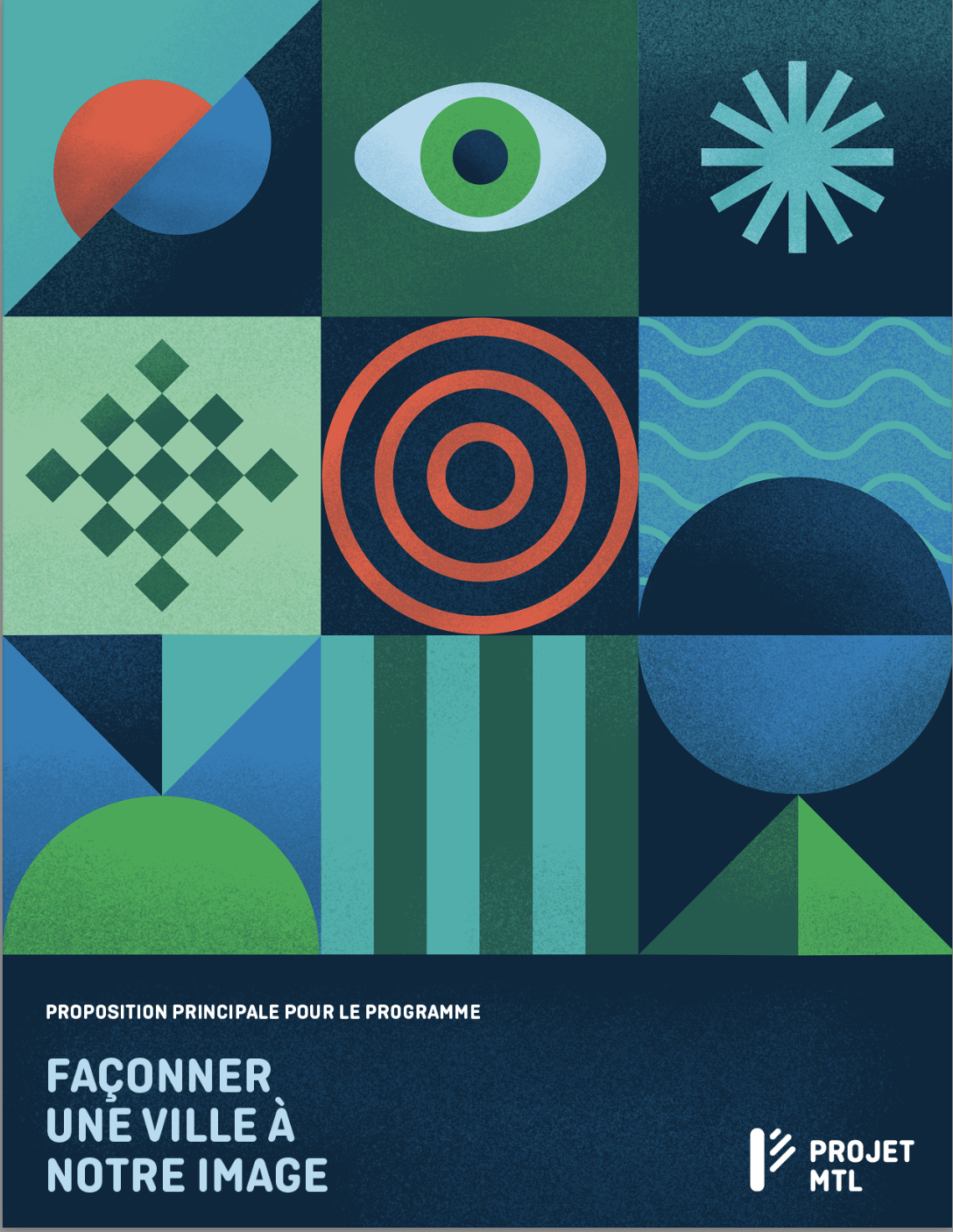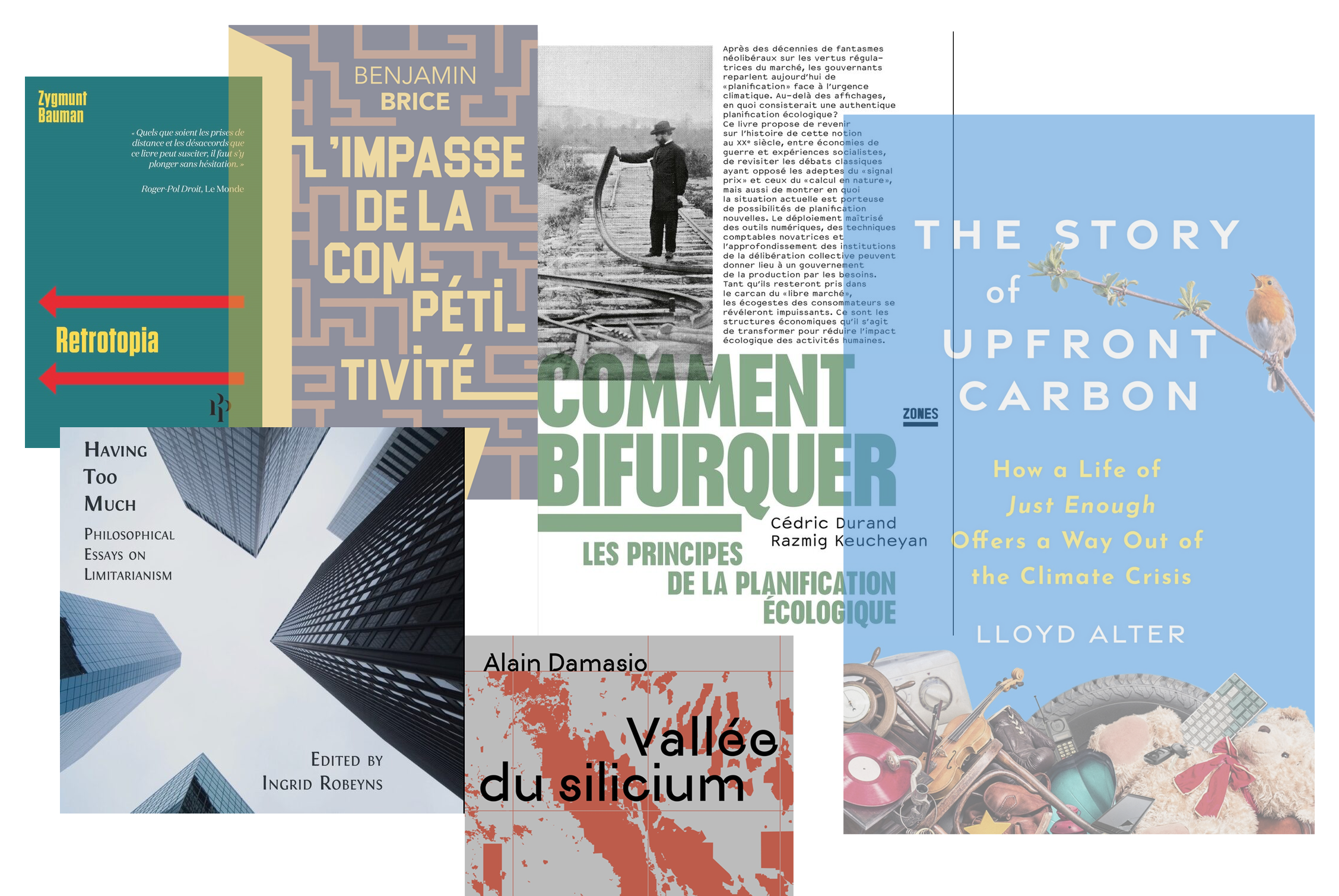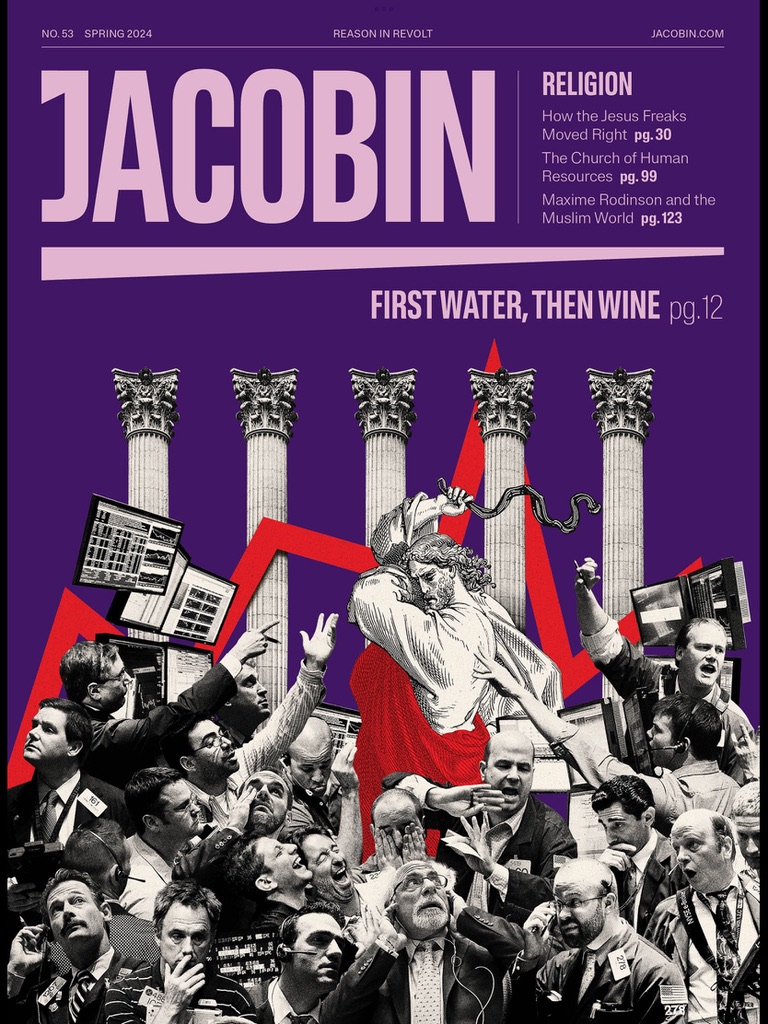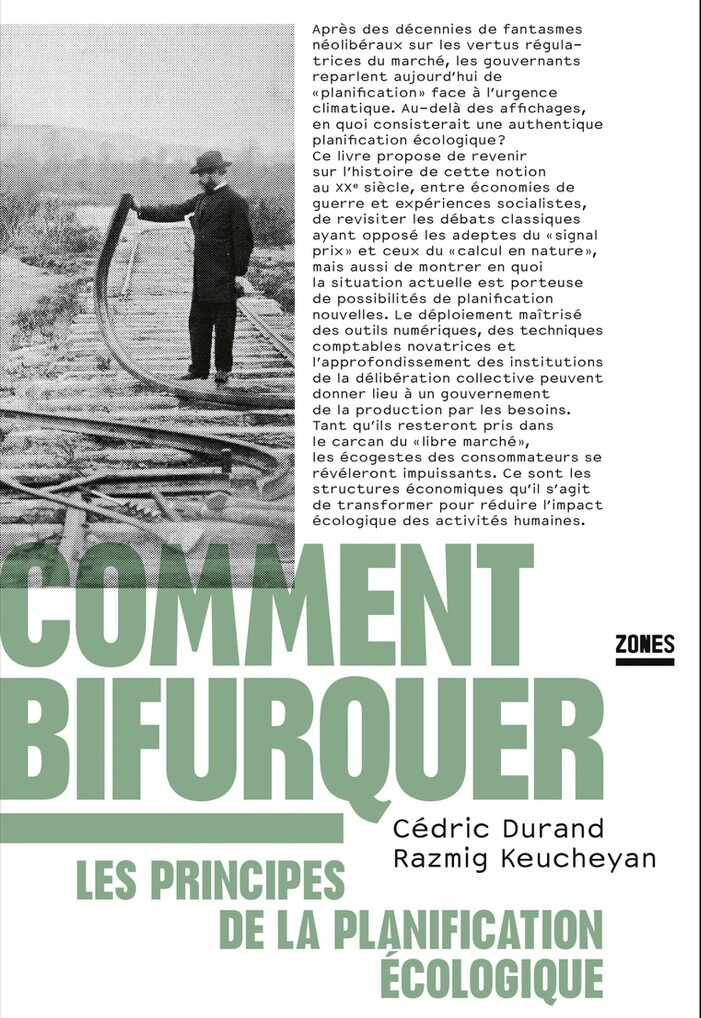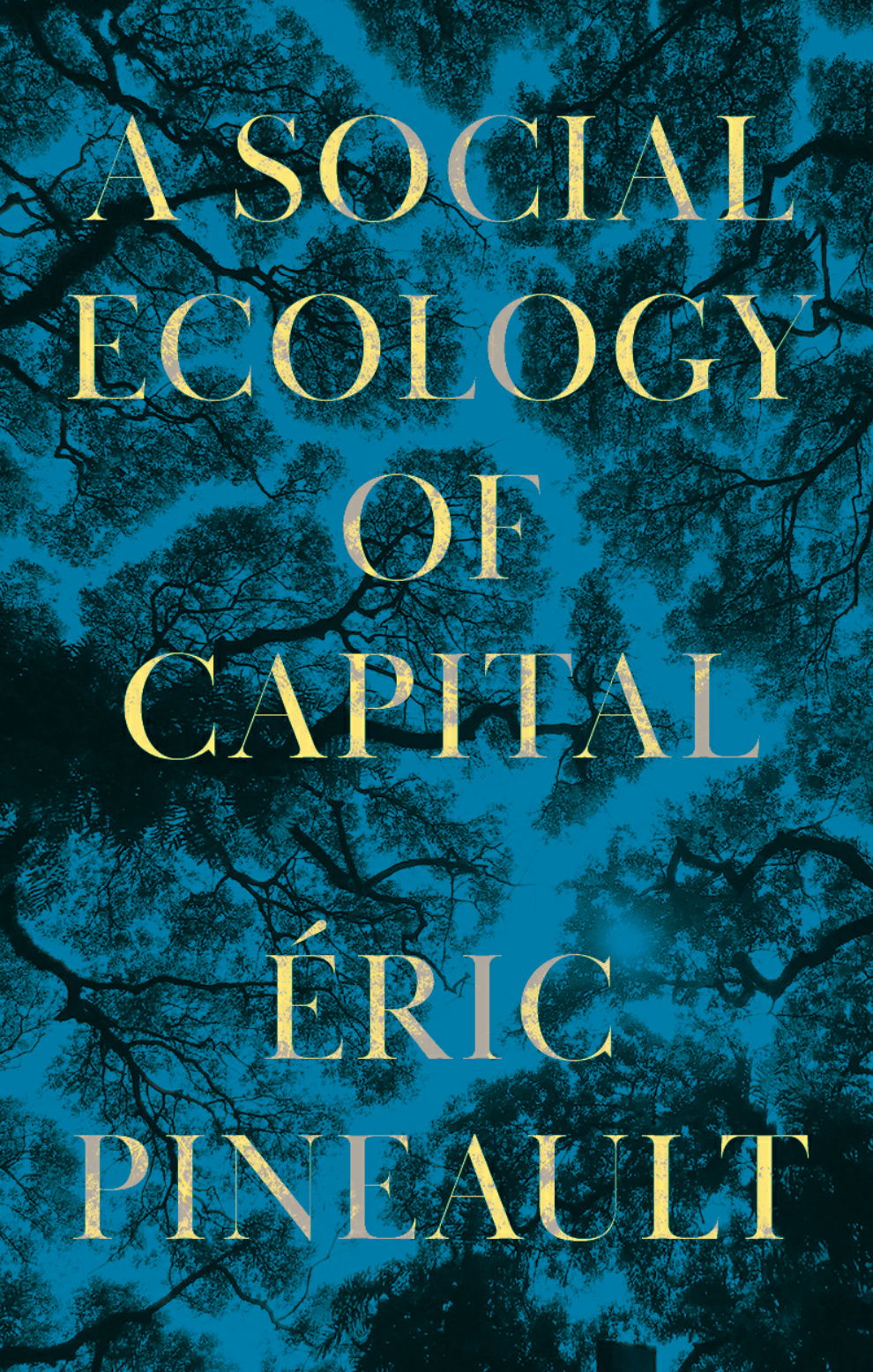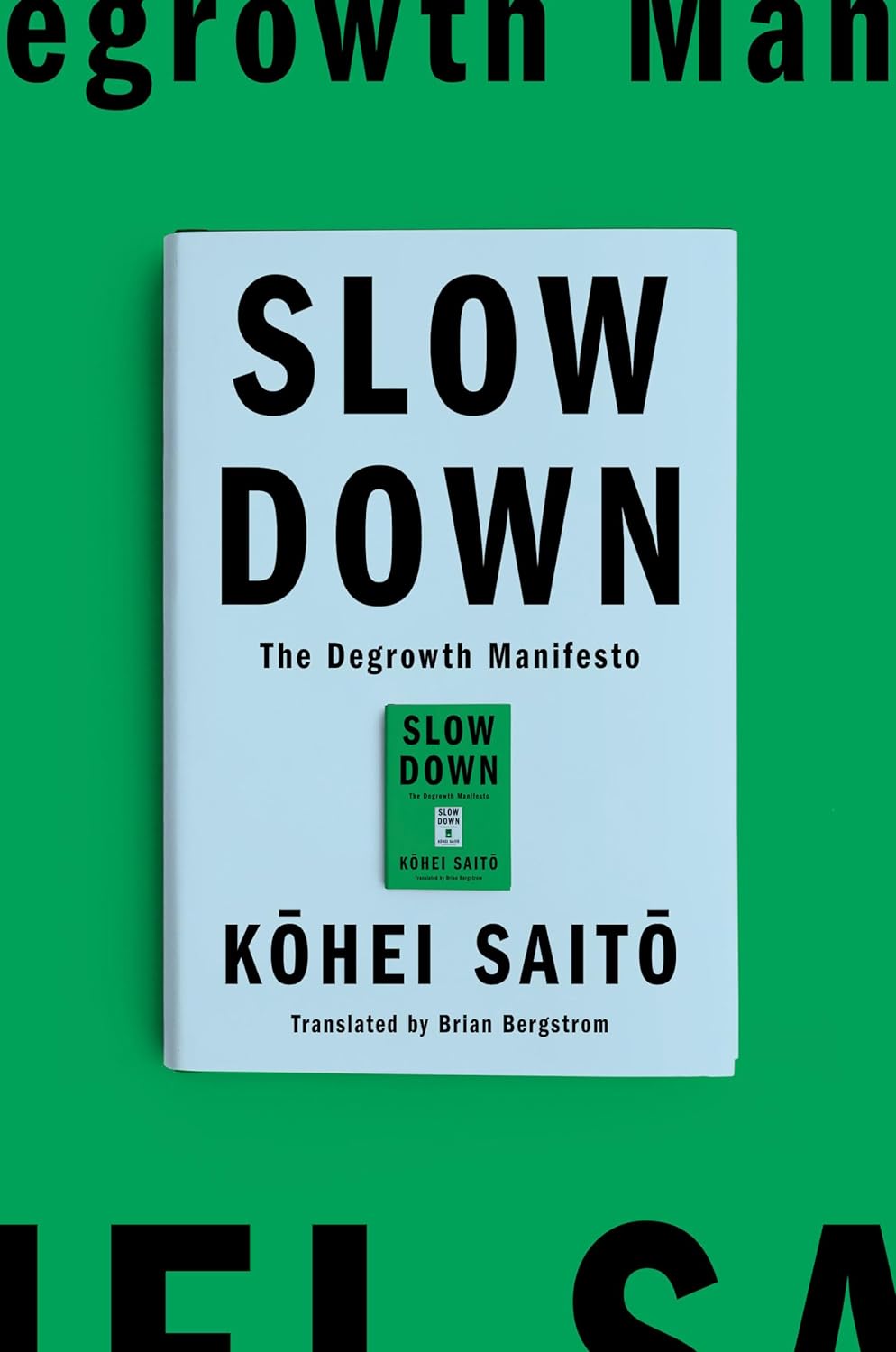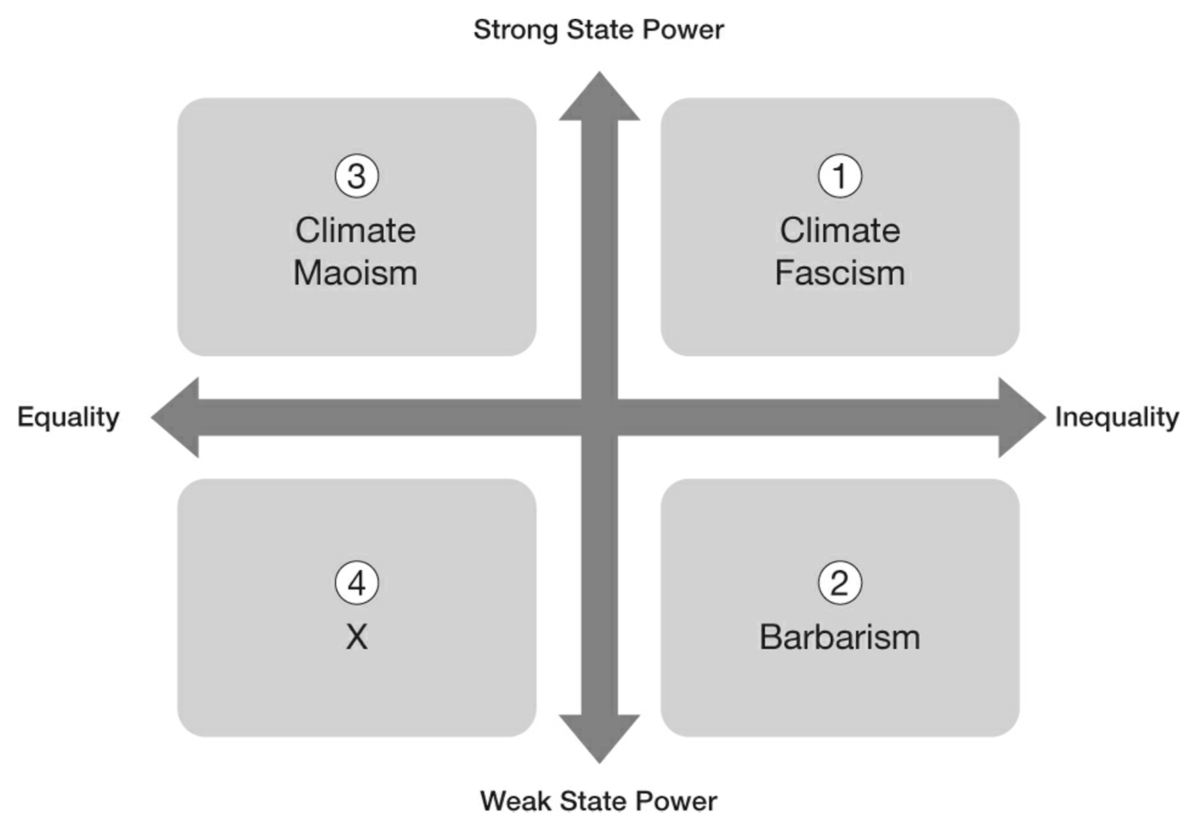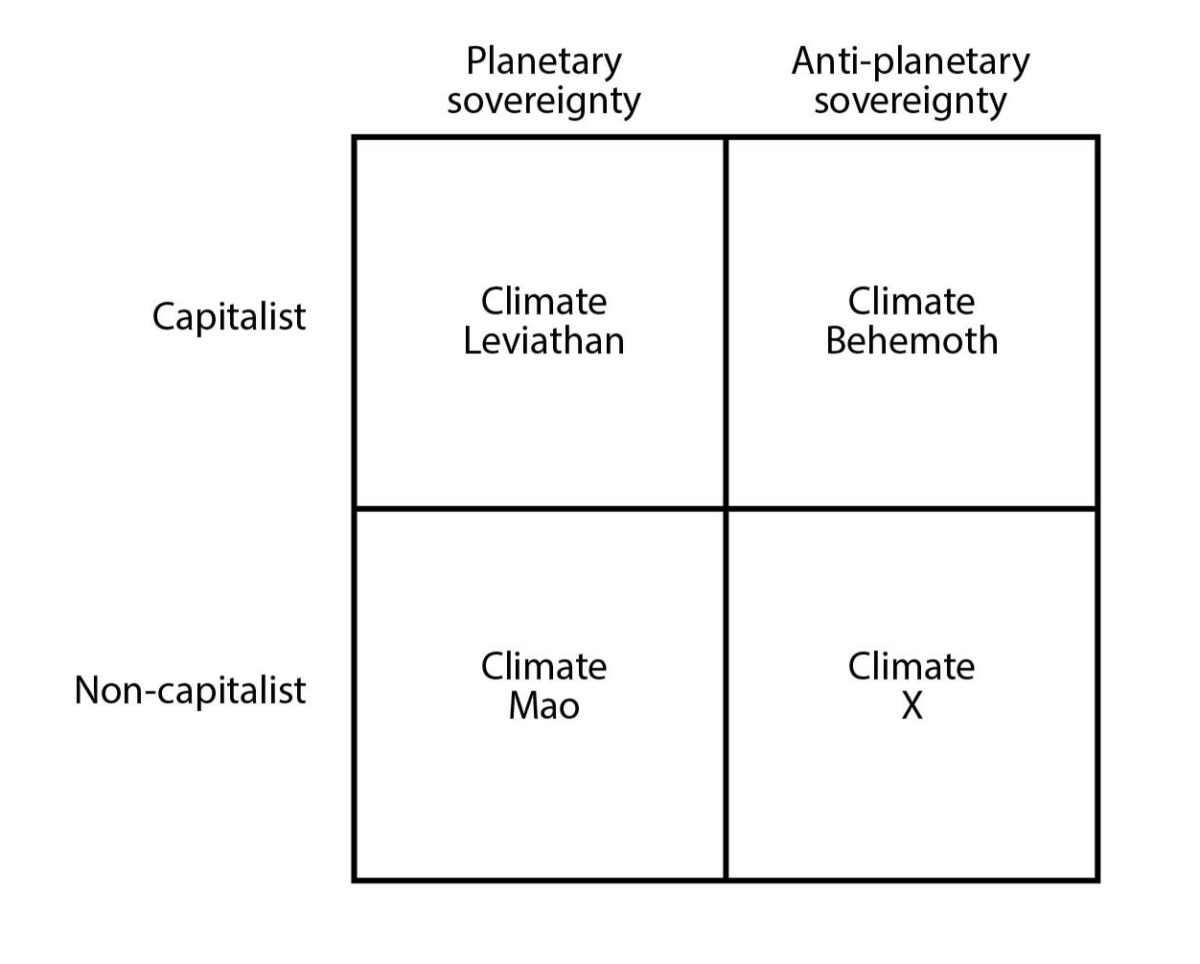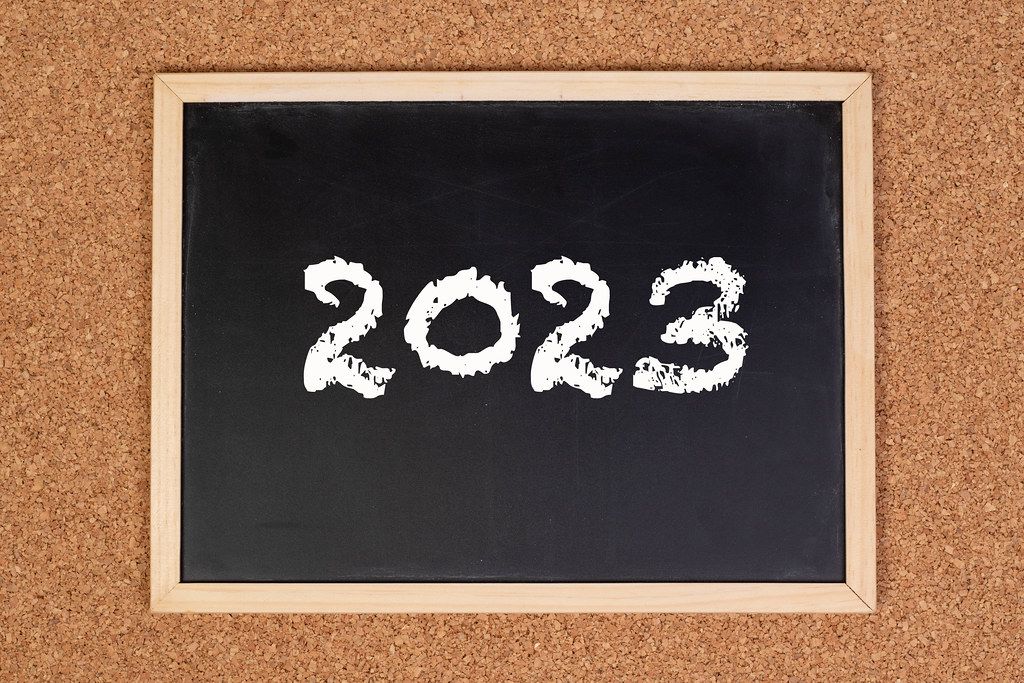Les MRC
- la MRC de Montcalm expriment leur ferme opposition à tout projet de pipeline semblable à Énergie Est
- la MRC de Montcalm réitèrent leur appui à la gestion de l’offre et réclament un soutien renforcé à l’agriculture d’ici
- les MRC de Brome-Missisquoi et de La Haute-Yamaska viennent de signer une entente pour la mise sur pied d’un circuit d’autobus interrégional.
- la MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) lance son projet de série balado Mémoire familiale avec lequel elle souhaite faire découvrir son histoire, son patrimoine ainsi que son identité par la mémoire de huit individus.
- Aussi à propos de mémoires : Récits du territoire, deux régions (Lanaudière et Côte-Nord) parlent par l’intermédiaire de leurs habitantes et habitants. Un balado de Communagir.
Municipalités
Mascouche
100 logements sociaux et abordables supplémentaires pour aînés autonomes.
L’immeuble de 100 logements qui sera bâti à Mascouche représente un investissement gouvernemental de 21,5 M$, auxquels s’ajoutent la contribution de la Ville de Mascouche qui cédera le terrain et offrira certains congés de taxes et coûts de raccordements. L’Office municipal d’habitation de la Rive Nord (OMHRN) assurera la gestion de l’immeuble et la sélection des personnes qui y résideront.
AUSSI : La ville de Mascouche présente son Plan d’action 2025 à l’égard des personnes handicapées
Repentigny
À l’occasion du Jour de la Terre, la Ville de Repentigny présente une version actualisée de sa Politique de foresterie urbaine et de biodiversité. Cette mise à jour vise à verdir davantage le territoire et à mieux protéger les arbres, les espaces verts et la nature, afin d’améliorer concrètement la qualité de vie de tous les citoyens[1] et de renforcer la résilience collective face aux changements climatiques.
Saint-Félix-de-Valois
La municipalité bonifie l’accès aux logements abordables
Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois a bonifié l’enveloppe pour le programme de supplément au loyer (PSLQ) à 19 000 $ lors de l’adoption du budget 2025 le 11 décembre dernier.
Les locataires qui bénéficient de ce programme paient un loyer correspondant à 25 % de leur revenu. La balance du loyer est couverte par le gouvernement via les Offices d’habitation (90 %) et les Municipalités (10 %).
« Cette enveloppe de 19 000 $ permet donc de financer jusqu’à 190 000 $ annuellement en loyer dans la communauté, ajoute Audrey Boisjoly. Ça a un effet levier vraiment intéressant et permet de soulager rapidement un grand besoin en logements abordables. »
Montréal
Budget participatif de Montréal : bilan de la troisième édition (2024-2025)
La Ville investit 45 M$ pour réaliser des projets proposés et choisis par la population. Plus de 880 idées ont été proposées et plus de 28 000 personnes ont participé au vote pour déterminer les projets à réaliser. Découvrez les 7 lauréats.
Sainte-Agathe-des-Monts
Une nouvelle entente intermunicipale en matière de loisirs pour favoriser l’accès aux sports et aux activités récréatives
DÉCLARATION DE RÉCIPROCITÉ (Qc)
concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité
Guides – outils – interventions
Mission 1000 tonnes lancent un guide pratique de nettoyage des cours d’eau
Chaises des générations
Rosemont-La Petite-Patrie, un arrondissement qui s’engage pour les générations futures!
Le regroupement des Mères au front, en collaboration avec l’école Sainte-Bernadette-Soubirous, offre à l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie une Chaise des générations décorée par les enfants afin qu’une place symbolique à la mairie d’arrondissement soit réservée à la prochaine génération.
C’est à l’occasion du Jour de la Terre, le 22 avril 2025, que les enfants de 6e année ont fait le don d’une Chaise des générations.
Aussi
LA MRC D’ARGENTEUIL DÉVOILE LA CHAISE DES GÉNÉRATIONS OFFERTE PAR LES ÉLÈVES DU PROGRAMME ALTERNATIF DE L’ENVOL-DU-COLIBRI
Guide pour l’organisation d’événements écoresponsables
À l’occasion du Jour de la Terre, la MRC de Vaudreuil-Soulanges est fière de dévoiler son tout nouveau Guide pour l’organisation d’événements écoresponsables, un outil concret, développé en collaboration avec les responsables de la gestion des matières résiduelles des 23 municipalités de la MRC et destiné à accompagner les organisateurs d’événements de petite, moyenne ou grande envergure.
Construction durable
Un outil innovant pour verdir les appels d’offres en construction
Cet outil de référence présente des clauses prérédigées et personnalisables à intégrer dans les documents d’appels d’offres facilitant ainsi le déploiement des mesures de détournement de l’élimination des matières résiduelles, par la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation.
Efficacité énergétique
Hydro-Québec déploie la trajectoire d’efficacité énergétique la plus ambitieuse de son histoire
Les bibliothèques aux ÉU
Un billet de La bibliomancienne
Fondée en 1848, la Boston Public Library (BPL) est la première grande bibliothèque municipale gratuite aux États-Unis. Dès son origine, elle a porté une vision profondément démocratique : celle de l’accès au savoir pour toutes et tous, indépendamment du statut social ou économique. Son inscription gravée sur le fronton — « Free to all » — est devenue un emblème puissant de la mission publique des bibliothèques américaines.
Urbanisme
Plus de 700 logements locatifs à venir à Montréal
Le projet est conçu avec une vision axée sur le développement durable, mettant en avant des normes exemplaires d’accessibilité aux logements. Le bâtiment intègre des espaces communs attrayants, comme une cour intérieure verdoyante, un hall d’entrée double hauteur vitré avec un espace détente, une salle de conditionnement physique, un chalet urbain et une terrasse au toit. Situé tout près de la station de métro et de la gare Vendôme, Station C offrira un accès rapide et pratique au réseau de transport en commun.
Densification urbaine et écosystème
Répondre à la crise du logement tout en préservant l’écosystème et en s’intégrant dans le patrimoine déjà bâti, c’est ce que propose un nouveau projet d’architecture à Sutton.
Beyond Congestion Pricing: Strategies for Revolutionizing Urban Mobility
How cities are leveraging data and technology to improve their transportation networks and reduce traffic.
Santé
Réseau de recherche CARES
Un réseau interdisciplinaire, piloté par l’INRS, pour un Québec et des régions en santé
« Un réseau québécois de recherche en santé consacré aux contextes spécifiques et besoins criants des régions rurales et éloignées, trop souvent ignorées ou oubliées. Le CARES prend donc toute son importance dans le contexte actuel d’iniquité touchant la prestation des soins de santé et de services sociaux dans ces régions. »
L’avenir de la santé publique est en jeu
Un article de David Wallace-Wells, du New York Times.
Que j’ai traduit (avec DeepL).
« Ce qui est le plus effrayant avec la rougeole, ce ne sont probablement pas les décès qui y sont liés, dont deux ont déjà été enregistrés cet hiver, les premiers aux États-Unis depuis dix ans. Ce n’est peut-être même pas le risque de paralysie irréversible à vie, connu sous le nom de panencéphalite sclérosante subaiguë, qui n’existe qu’une fois sur 10 000. Il s’agit plutôt de l’effet beaucoup plus courant que le virus peut avoir sur ce que l’on appelle la mémoire immunologique, créant une amnésie immunitaire qui peut anéantir votre capacité à lutter contre de futures infections. » Suite…
Écologie
Vers un contrat éco-social : l’Accord de gestion vivante, ma traduction de l’article de Dark Matter Labs (DML) : Towards an eco-social contract: the Living Stewardship Agreement, 7 avril 2025
Un article qui flirte avec la technologie de la chaine de blocs (blockchain) sans jamais la nommer… et soulève des questions concernant le respect de la vie privée dans ces réseaux « denses » qui mettent en relation et qualifient actants et agents en inscrivant dans des registres permanents leurs interactions et engagements.
Il me semble avoir noté ailleurs chez DML (mais je n’ai pu retrouver l’article en question) une ouverture, un intérêt pour la technologie blockchain. Je voulais comprendre mieux cette question, liée étroitement à cette des cryptomonnaies. La très longue (37) page de Wikipedia m’a introduit assez bien. Notamment sur les conséquences écologiques de la logique de computation de masse, supposément pour garantir la sécurité, la résistance aux « attaques de 51% ». (Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?)
Ma conclusion : le caractère inattaquable ou permanent des chaines de blocs est relatif; et son coût est prohibitif en énergie; des registres garantis par des structures humaines, comme l’État, pourraient être imaginés, construits, avec des coûts environnementaux plus légers. Plutôt que des chaines de blocs, ce sont des bases de connaissance évolutives mais qui doivent assurer leur pérennité.