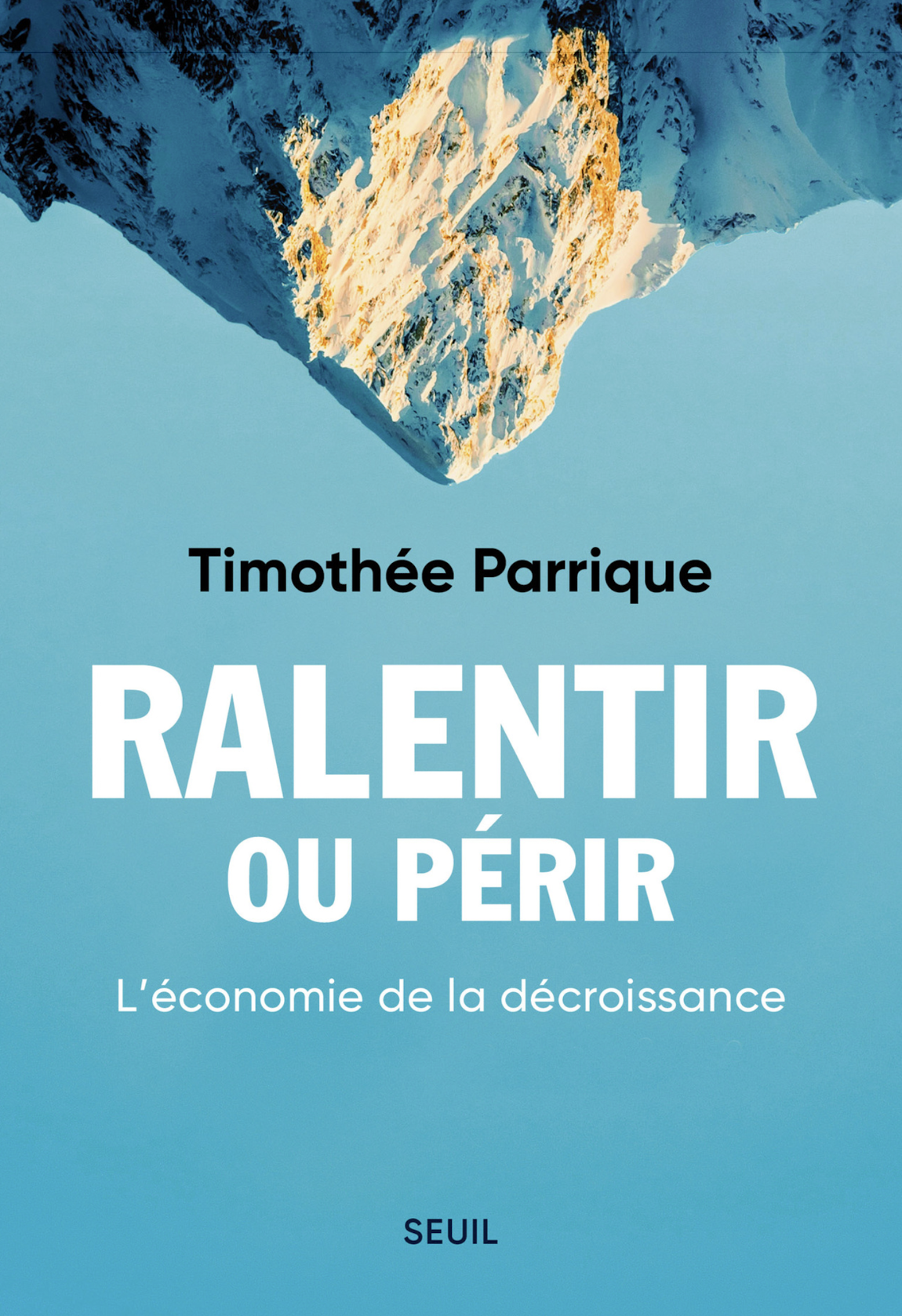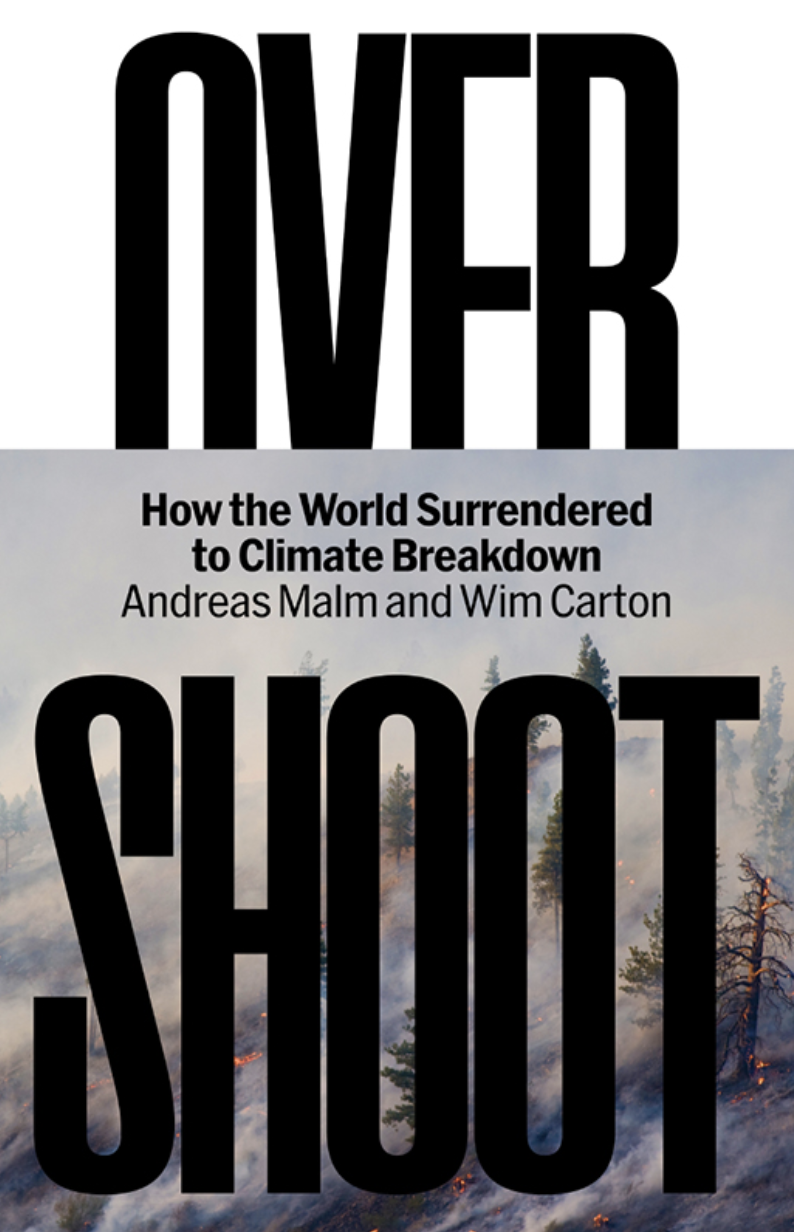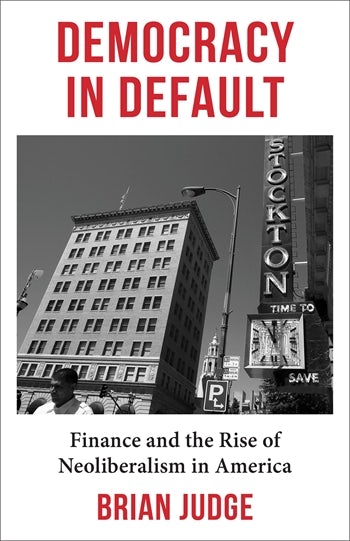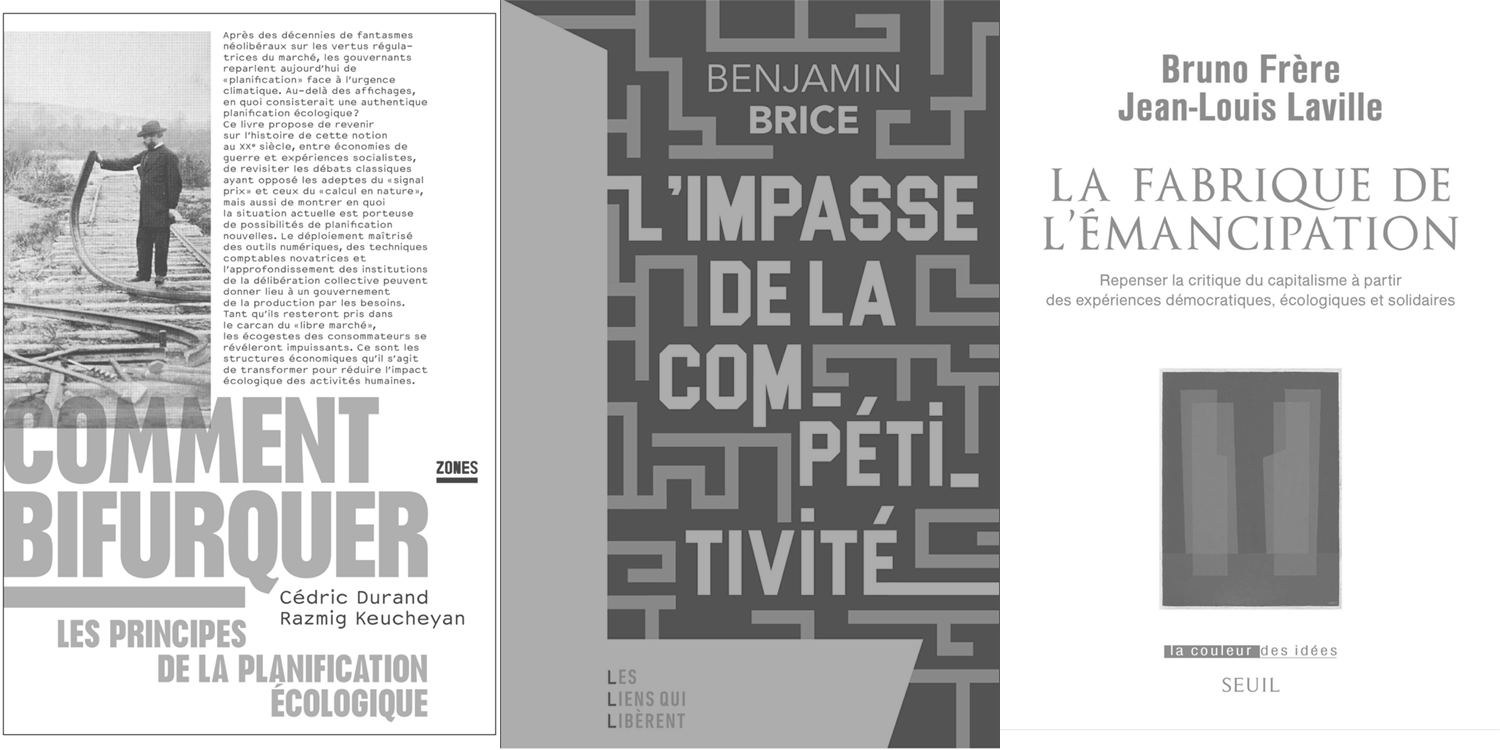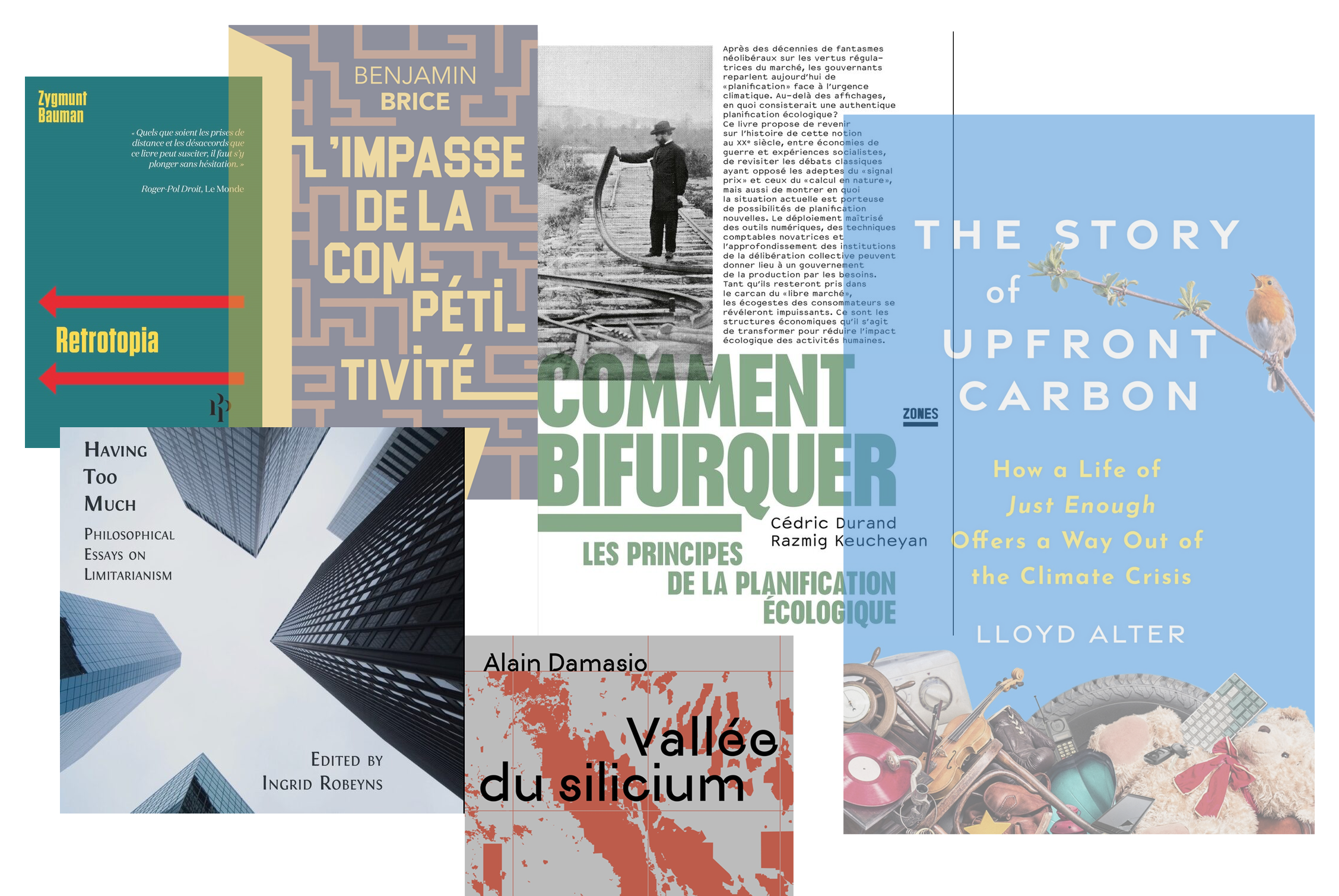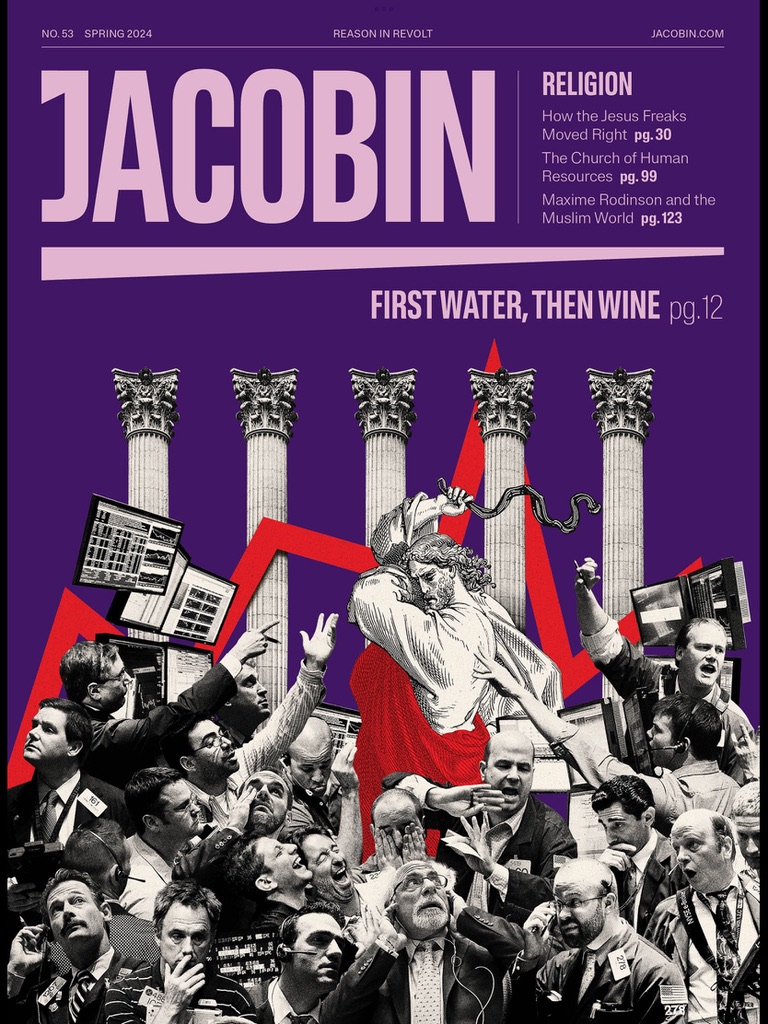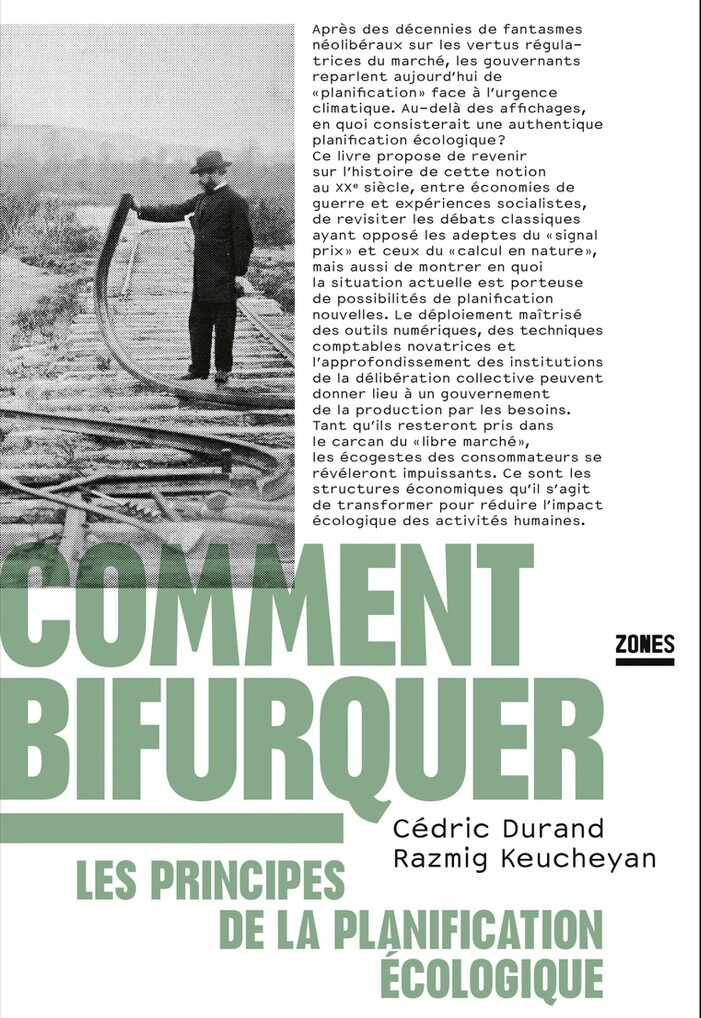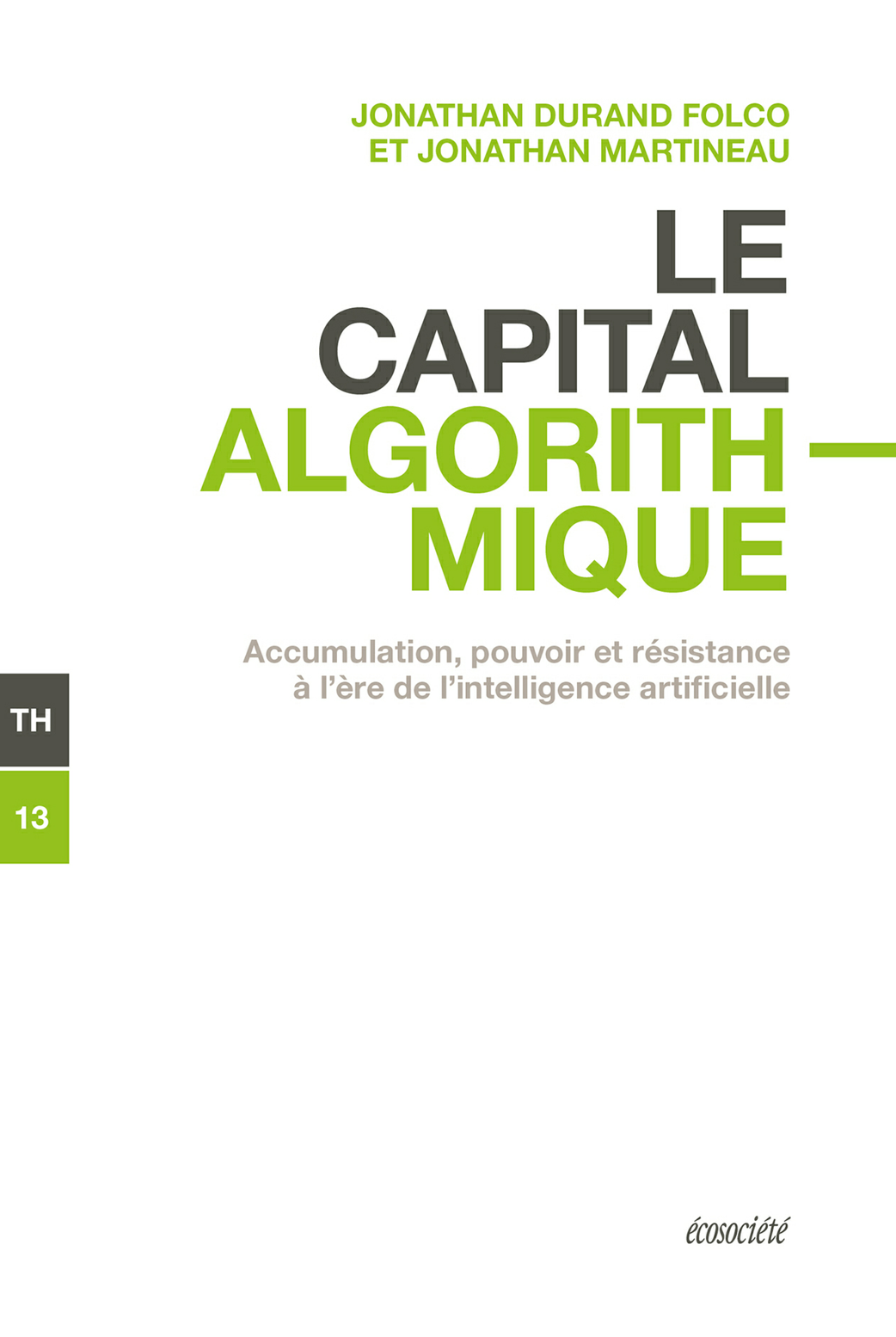Des alternatives financières se pointent avec des principes écologiques, on parle d’économie écologique, de bioéconomie ou même de finance biorégionale. Le « développement durable » ou la « croissance verte » sont des concepts à oublier : il faut planifier la décroissance, dans le sens de réduire les flux de matières et d’énergies qui sont engouffrés dans l’actuel système de production/consommation.
Suite au Sommet sur l’économie sociale qui s’est tenu à Montréal les 14 et 15 mai dernier, un post annonçait la déclaration Vers une économie du bien commun, soutenue par différentes organisations : Multitudes, le Front commun pour la transition énergétique, la coalition Ensemble Pour la Suite du Monde, Virage Collectif, la Caisse d’économie solidaire Desjardins et le Chantier de l’économie sociale.
Je connaissais ces organisations, sauf Virage Collectif. Une organisation qui « aspire à une économie durable, qui répond aux besoins des communautés tout en respectant les limites de nos écosystèmes. » Elle se dit un pôle de solutions pour une finance axée sur le bien commun. Je trouve sur leur site web quelques documents, dont By disaster or design. Une sévère critique de l’état actuel de l’économie mondiale, et un appel à la décroissance, au financement « post-croissance » par l’Arketa Institute for post-growth finance. J’ai fait une traduction (avec DeepL) de ce document PDF (Par désastre ou dessein) mais avec un résultat mitigé, en particulier lors des changements de page1comme si le puissant moteur de traduction ne pouvait reconnaître qu’une phrase se poursuit sur la page suivante ! et certains titres de sections. Je vous conseille de garder la version originale en parallèle…
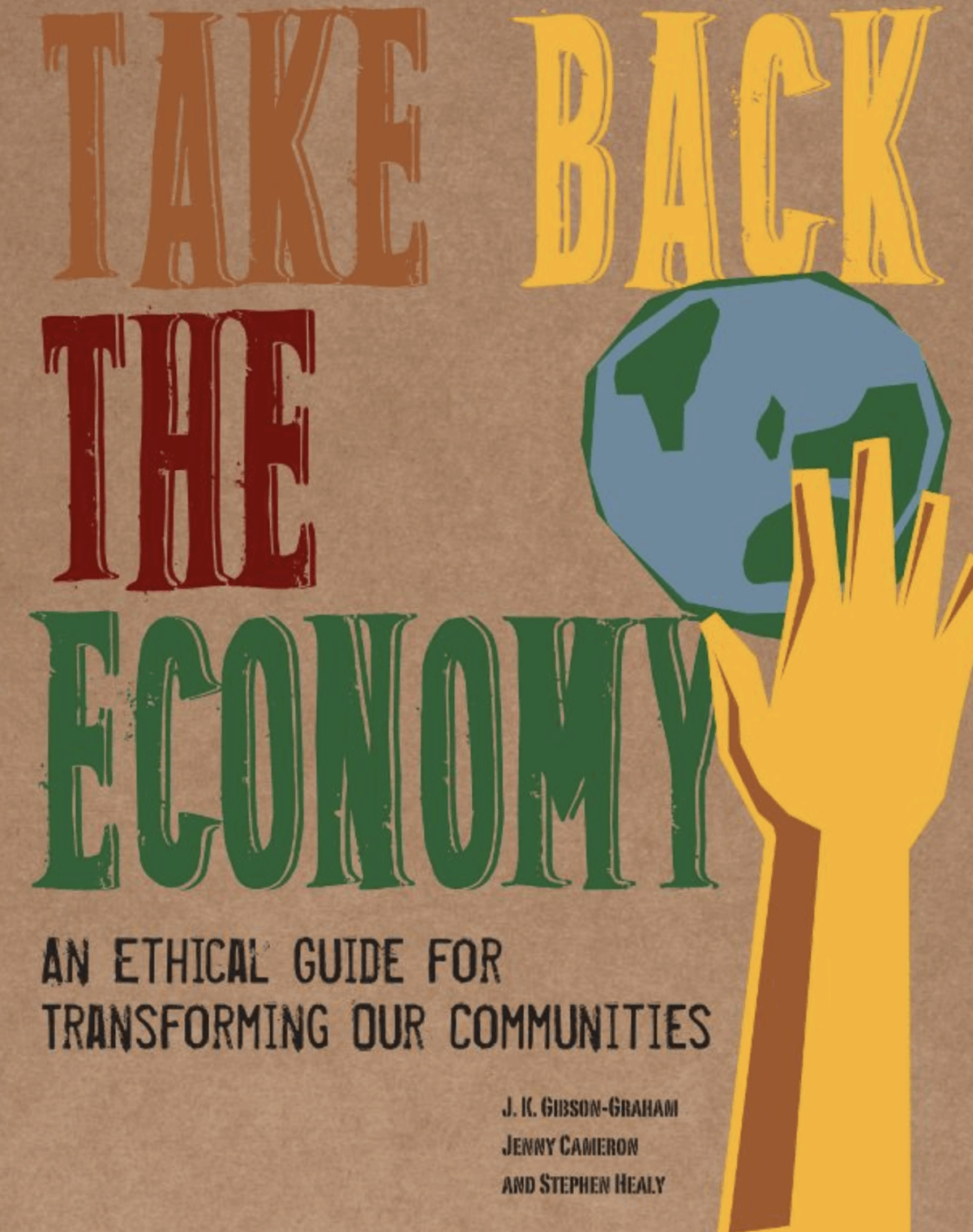
Cette plongée dans la finance « alternative » ou « post-croissance » m’a amené à poursuivre (ou commencer) la lecture de certains livres que j’avais en stock depuis quelques temps. Take Back the Economy – An Ethical Guide for Transforming Our Communities, publié en 2013 par J.K. Gibson-Graham, Jenny Cameron, et Stephen Healy, offrant des outils pédagogiques pour les formateurs et animatrices qui propose une vision élargie de l’économie (voir l’iceberg – en français – popularisé par le même centre Community Economies). L’économie, le marché, le travail, la propriété, la finance sont abordés dans un langage accessible, avec des exemples tirés d’expériences vécues en différents pays.
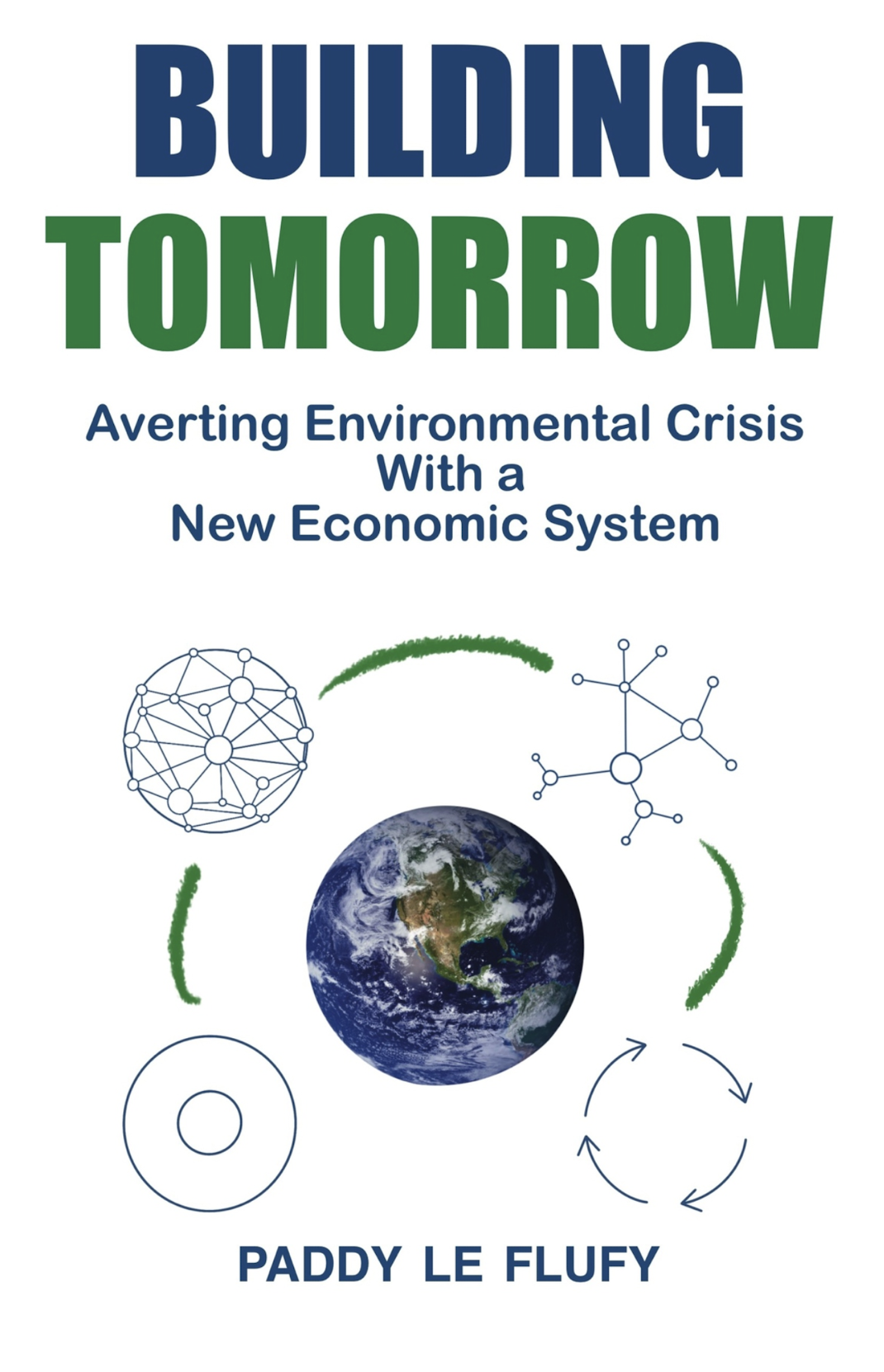
Building Tomorrow: Averting Environmental Crisis With a New Economic System, publié en 2023 par Paddy Le Flufy, présente en six chapitres (220 pages), les différentes dimensions d’une économie renouvelée. En commençant par le paradigme du beignet (donut). Pour un bon résumé en français de cette théorie des limites planétaires à respecter voir Bonpote : L’économie du donut – définition et analyse critique. Le Flufy décrit dans son deuxième chapitre l’économie circulaire, puis dans son troisième, les « gardiens du futur », comme nouveau modèle de gouvernance visant à servir l’ensemble des parties prenantes plutôt que seulement les actionnaires, s’appuyant sur les exemples d’entreprises comme Patagonia et Fairphone. Le chapitre quatre présente quatre « organisations régénératives » : Fab Labs, Transition Networks, Bendigo Comunity Banks et Open Source Ecology. Le cinquième chapitre (Sovereign Money) présente le système monétaire actuel qui impose la croissance, et introduit l’alternative de la monnaie souveraine, où les banques centrales auraient le contrôle sur la création de monnaie et pourraient orienter celle-ci vers les fins socialement souhaitables. Le dernier chapitre porte sur les monnaies locales et systèmes locaux d’échange…
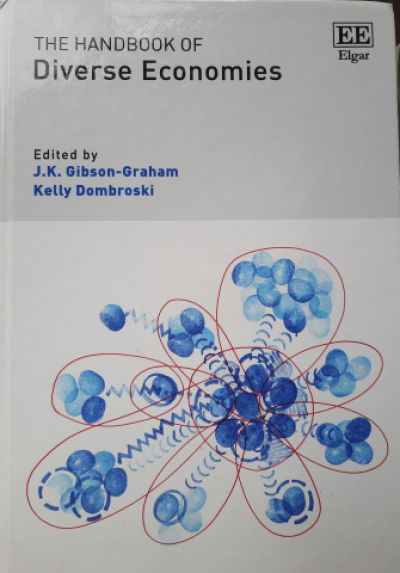
Un autre livre issu du Community Economies me semble intéressant : The Handbook of Diverse Economies. Plusieurs chapitres sont disponibles sur cette page.
Je n’ai pas encore acheté le livre : à 100$, je vais m’assurer que j’y trouverai mon compte !
Des articles
J’ai rassemblé sur deux pages thématiques les articles qui me semblent intéressants pour alimenter ma plongée économique : Post-croissance, post-growth, décroissance et Finance et économie communautaires, alternatives, biorégionales.
Quelques-uns de ces documents m’ont semblé assez intéressants pour mériter une traduction :
- Building a local structural basis for economic change? A case study on grassroots initiatives from a ‘social provisioning’ perspective, par Roman Hausmann, Anne-Kathrin Schwab. Ecological Economics, janvier 2025 – Ma traduction : Construire une base structurelle locale pour le changement économique ? (à noter : plus d’une centaine de références)
- Le travail auto-organisé dans la pratique : le cas des initiatives communautaires contre les inondations en Écosse – Traduction de Self-organizing work in practice: the case of community-based flooding initiatives in Scotland
- Money Commons: Review of ‘Remaking Money for a Sustainable Future’, by Ester Barinaga Martín – ma traduction : L’argent comme commun
- A Brief Sketch of Four Models of Democratic Economic Planning, par Audrey Laurin-Lamothe, Frédéric Legault et Simon Tremblay-Pepin – ma traduction : Quatre modèles de planification économique démocratique
- Finance as a form of economic planning – ma traduction : Finance et planification économique
- What the Mercantilist Got Right, Dani Rodrik, mai 2025 – ma traduction (pdf corrigé) Ce que les mercantilistes avaient compris.
- Qu’est-ce que l’économie des fondements, traduction de What is the foundational economy?
Si vous avez des suggestions dans la même veine, n’hésitez pas !
gilles.beauchamp [a] gmail.com
Tout ce travail devrait me permettre d’écrire prochainement quelques billets. En attendant, je reste sceptique quand à la capacité des économies alternatives ou communautaires à faire face aux Blackrock, Vanguard et State Street de ce monde… Sans doute faudra-t-il passer par le politique pour avoir quelque rapport de force, comme disait Daniel Schmachtenberger à la fin de sa conférence à Stockholm et dont je parlais il y a un an.
Faire du lobbying auprès des gouvernements, qui, eux, peuvent forcer les corporations et puissances de l’argent, alors que les seules forces d’opposition n’y arriveraient pas.
Notes
- 1comme si le puissant moteur de traduction ne pouvait reconnaître qu’une phrase se poursuit sur la page suivante !