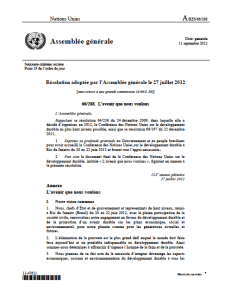Je sais bien qu’on est en pleine campagne électorale municipale… mais je n’ai pu décrocher du sentiment d’urgence instillé par les rapports et documents qui appellent à une transformation radicale de nos procédés technologiques et pratiques industrielles. Les deux reportages récents diffusés à l’émission Découverte (Les changements climatiques : (1) état des lieux et (2) le mur) ne sont que les derniers à répéter : Nous nous dirigeons plein gaz vers une autre planète. Les cris d’alarme des scientifiques n’y changent rien.
Même si le dernier rapport du GIEC (résumé pour les décideurs [pdf-en] adopté le 27 septembre) consolide, pour les uns, les bases scientifiques de ses prévisions en expliquant les raisons probables de ses erreurs prévisionnelles passées, cela n’empêche pas les autres de prendre ces ajustements (aléas inévitables de toute démarche scientifique – Climate uncertainty shouldn’t mean inaction, G&M) comme des preuves d’incertitudes et de nouvelles raisons de procrastiner.
Pourtant, il faudra bien agir, très bientôt et c’est urgent, non seulement pour réduire enfin le émissions de gaz à effet de serre mais aussi protéger ce qui reste des ressources communes à l’humanité : le fonds des mers, l’air, l’eau, les métaux rares… Il faudra agir malgré l’incertitude. N’est-ce pas d’ailleurs le propre du politique que d’agir malgré le caractère incomplet de l’information détenue, malgré les opinions divergentes. Le style ou l’orientation politique dictera la manière et la profondeur de la prise en compte des divers avis afin de construire une société apte à respecter et mettre en oeuvre cette action publique.
Devant notre incapacité à protéger les milieux marins de pratiques de pêche destructrices je me dis qu’il faudrait une « police des mers » qui soit à la hauteur du défi. Des « casques bleus » de la mer capables d’arraisonner des bateaux-usines et de policer les espaces et espèces protégés. Des casques verts… ?
Il semble que ce soit une question déjà travaillée par un comité ad hoc de l’ONU.
Le paragraphe 162 du document L’avenir que nous voulons adopté par l’ONU en juillet 2012 (Rio+20).
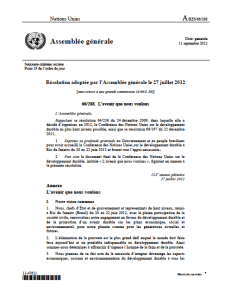 162. Nous sommes conscients de l’importance que revêtent la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées en dehors des juridictions nationales. Nous prenons note des travaux menés par le Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale sous l’égide de l’Assemblée générale. Nous appuyant sur ces travaux, nous nous engageons à nous attaquer d’urgence, avant la fin de la soixante-neuvième session de l’Assemblée générale, à la question de la conservation et de l’exploitation durable de la diversité biologique marine dans les zones qui ne relèvent pas des juridictions nationales, notamment en prenant une décision sur l’élaboration d’un instrument international dans le cadre de la Convention sur le droit de la mer. (Je souligne)
162. Nous sommes conscients de l’importance que revêtent la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées en dehors des juridictions nationales. Nous prenons note des travaux menés par le Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale sous l’égide de l’Assemblée générale. Nous appuyant sur ces travaux, nous nous engageons à nous attaquer d’urgence, avant la fin de la soixante-neuvième session de l’Assemblée générale, à la question de la conservation et de l’exploitation durable de la diversité biologique marine dans les zones qui ne relèvent pas des juridictions nationales, notamment en prenant une décision sur l’élaboration d’un instrument international dans le cadre de la Convention sur le droit de la mer. (Je souligne)
Ce « groupe de travail spécial officieux à composition non limitée » (Ad Hoc Open-ended Informal Working Group) tenait sa sixième rencontre du 19 au 23 août dernier (résumé des travaux par IISD.ca – voir aussi le « Advanced, unedited rewporting material » (pdf 12 p.) rédigé par les co-présidents du Groupe de travail) . De son nom officiel : Groupe de travail spécial officieux à composition non limitée chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale. La zone BADJN. Ce groupe avait tenu les 2 et 3 mai et les 6 et 7 mai 2013, deux « ateliers intersessions visant à mieux comprendre les problèmes et à préciser des questions clefs afin de contribuer aux travaux du Groupe de travail » (résumé des délibérations – 38 pages – tiré du site officiel du Groupe de travail). Origine de ce comité : paragraphe 73 de la résolution 59/24 – Les océans et le droit de la mer, adopté par l’assemblée générale des Nations unies le 17 novembre 2004 :
73. Décide de créer un groupe de travail spécial officieux à composition non limitée qui sera chargé d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, en vue :
a) De recenser les activités passées et présentes de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes concernant la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale ; b) D’examiner les aspects scientifiques, techniques, économiques, juridiques, écologiques, socioéconomiques et autres de ces questions; c) D’identifier les principaux enjeux et les questions devant faire l’objet d’études plus poussées pour faciliter leur examen par les États ; d) D’indiquer, le cas échéant, les solutions et méthodes permettant de promouvoir la coopération et la coordination internationales pour la conservation et l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale ; [source: résolutions de la 59e assemblée générale de l’ONU]
La première réunion de ce groupe de travail s’est tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 13 au 17 février 2006. Il en était à sa sixième rencontre en août dernier, soit près d’une rencontre par an depuis sa création.
*_*_*
Le caractère ouvert de ces comités permet d’accueillir des participants de la société civile, du monde scientifique et industriel autant que de l’activisme citoyen. Mais les représentants des États ont encore des privilèges et prérogatives, comme de participer au huis-clos des « amis de la présidence » qui décide, finalement, des agendas ou résolutions. Ce qui n’est pas pour plaire aux participants issus des organisations de la société civile.
Mais les travaux avancent tout de même et les diverses contributions de la société civile se posent comme la base d’un éventuel « instrument », d’un accord ou mieux, d’une renégociation de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). D’autres comités ouverts à la participation de la société civile semblent sur le point de conclure des ententes, notamment sur la surveillance et l’élimination du mercure : la Convention de Minamata sur le Mercure doit être signée, demain 10 octobre 2013 à Minamata.
*_*_*_*_*
Les travaux sont lents, complexes. Ce comité sur la BADJN a commencé son travail en 2006, et prévoit aboutir à une décision prise par l’ONU lors de sa soixante-neuvième session (2014-2015). Pendant ce temps, on pêche 10 fois plus qu’on déclare officiellement de prises : « les navires de pêche chinois ont siphonné, loin de leurs côtes, entre 3,4 millions et 6,1 millions de tonnes de poissons par an entre 2000 et 2011. Dans le même temps, Pékin ne déclarait que 368 000 tonnes de poisson en moyenne auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Douze fois moins que la réalité estimée par les spécialistes des ressources halieutiques ! » (Le Monde, 2013.04.04)
*_*_*_*_*_*_*
Nous ne savons pas exactement, pas encore, ce qu’il faut faire, ni comment le faire. Mais nous le saurons de mieux en mieux, et il faudra alors avoir le moyen de mettre en oeuvre ce savoir. La construction de cette capacité d’agir, distincte du développement du savoir, doit se faire en même temps mais en parallèle que celle de notre capacité de comprendre et de surveiller.
Je termine ce parcours réflexif avec un peu la même question qu’au départ, mais mieux informée : les structures actuelles de représentation et de négociation internationales sont-elles adaptées à l’urgence de la situation ? J’en arrive à me demander si nous ne devrions pas bâtir une véritable gouvernance internationale basée sur la représentation directe plutôt que des représentations d’États… Ce sera pour un autre billet.
SHIFT magazine is a volunteer-run non-profit magazine whose focus is on examining our global emergency, and strategies for adapting to the future in store for us as the world rapidly changes. Speaking honestly and compassionately about the converging crises of ecological and economic collapse and peak resources, we aim to deliver not just food for thought, but inspiration to practical action.

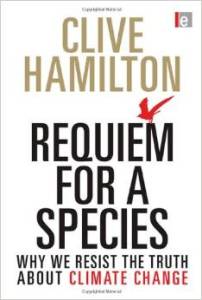







 On parle d’un téléphérique entre l’Entrée maritime et l’île Sainte-Hélène… Je pense qu’un pont piétonnier et cycliste donnant accès aux îles de Boucherville et au parc national serait aussi intéressant. Surtout si on l’inscrit dans un aménagement reliant cet ouvrage de génie civil à l’Espace pour la vie. Cela ne serait pas le seul chemin pour s’y rendre, évidemment. Mais cela contribuerait à construire une Ville qui se marche.
On parle d’un téléphérique entre l’Entrée maritime et l’île Sainte-Hélène… Je pense qu’un pont piétonnier et cycliste donnant accès aux îles de Boucherville et au parc national serait aussi intéressant. Surtout si on l’inscrit dans un aménagement reliant cet ouvrage de génie civil à l’Espace pour la vie. Cela ne serait pas le seul chemin pour s’y rendre, évidemment. Mais cela contribuerait à construire une Ville qui se marche.