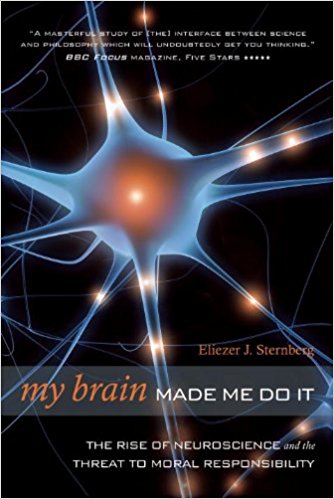Le débat sur la nature de l’esprit humain entre les déterministes-réductionnistes et les tenants d’autre chose (dualistes nouveau genre ?) a remplacé, poursuivi l’ancien débat dualiste / monistes ou encore idéaliste / matérialiste. Mais, à part remplir les étalages des libraires de parutions érudites, quels sont les enjeux de tels débats ? Cela fera-t-il vraiment une différence que l’une ou l’autre tendance l’emporte ? En fait les positions radicalement opposées sont souvent le fait de procédés rhétoriques : il a toujours été plus facile de valoriser son point de vue quand celui de l’adversaire conduit le monde au cataclysme !
Mais les méchants ne sont pas toujours ceux qu’on pense. Ainsi le caractère profondément dualiste, imposant une séparation essentielle entre le corps et l’esprit, du point de vue de Descartes, qu’on a critiqué avec raison, aura sans doute été le plus grand contributeur, facilitateur du développement de la position matérialiste / scientifique d’aujourd’hui : en isolant de manière quasi étanche le monde de la matière de celui des idées, de l’âme, cela aura permis de dégager l’expérimentation scientifique de la tutelle de l’Église et ainsi facilité le développement rapide des sciences et de la position matérialiste-moniste. (suite sur la page Neurosciences et liberté – I)