Nous avons 25 ans pour réaliser une radicale transition écologique et économique, répétait Benoît Lévesque à sa conférence d’ouverture du colloque qui se tenait hier dans le cadre du 84e congrès de l’ACFAS sur les transferts de connaissance (#ACFASC30 @ACFAS2016). Une transition qui se fera avec ou sans nous, sur laquelle nous aurons, ou pas, du contrôle.
On peut certainement ajouter que cette Transition se devra aussi d’être politique, et culturelle. Sûr qu’on ne peut tout faire en même temps (comme disait encore Benoît), et que nous devrons travailler avec les forces, les ressources en place. Mais comme ces ressources ont été chambardées récemment, autant profiter de l’occasion pour se doter de nouvelles structures en fonction des nouveaux défis.
C’est peut-être mettre beaucoup de pression sur les fameux « gouvernements de proximité ». Mais a-t-on vraiment le choix ? Nous avons 25 ans pour penser, planifier, réaliser et déployer une transformation de nos modes de production-consommation et passer d’un paradigme extractiviste à court terme à une gestion à long terme basée sur l’entretien des capacités de renouvellement de la planète.
Évidemment ces gouvernements de proximité ne porteront pas seuls le poids et les choix des transformations structurelles de nos sociétés. Mais parce qu’ils viennent remplacer, réinventer les liens entre société civile et politique, entre le développement économique et le vivre ensemble, la création de ces nouveaux espaces publics ouvre la possibilité d’une réflexion et d’une mobilisation profondes.
Certains espaces publics régionaux (CRÉ, CLD, forum jeunesse) ont été dissous alors que d’autres sont maintenus ou développés (CI-U-SSS, CAR). Certaines institutions locales (CLSC, CDC) ont été fusionnées-démentelées et ont perdu des capacités d’ancrage et de mobilisation des communautés. Le report sur les MRC, avec la moitié des ressources à la clé, de mandats auparavant discutés régionalement risque d’avoir un effet centralisateur assujettissant les programmes et actions à des cadres plus directifs et étroits en provenance des ministères. À moins que les acteurs des sociétés civile, politique et économique ne s’organisent pour réfléchir, influencer les décideurs locaux, et appuyer le maintien d’une autonomie, d’une capacité locale instituante. Une capacité locale qui se manifestera peut-être d’abord par sa compétence à se concerter régionalement, nationalement.
Parmi les questions de recherche ouvertes par les transformations en cours, la relation entre les professionnels chargés de porter, administrer les programmes publics et les élus responsables devrait être étudiée. À quelles conditions cette relation permettra-t-elle de maintenir une souplesse garante de la qualité de l’intervention publique ? Comment des élus « à temps partiel », dans les petites et moyennes municipalités, apprendront-tils à transiger avec des ressources professionnelles encadrées par des programmes venus d’en haut pas toujours adaptés ?
Le rôle que les organisateurs de CLSC ont pu jouer, alors que les ressources telles les CLD, CDEC, CDC et autres projets d’économie sociale n’existaient pas encore, marqué par l’expérimentation, l’innovation et la contestation des programmes publics inadéquats ou inexistants, ce rôle était sans doute facilité par l’autonomie très grande et la légitimité politique acquise à leur institution de rattachement (CLSC) par l’électivité d’un conseil d’administration où les citoyens occupaient une grande place. Alors que ces institutions locales ont été par deux fois amalgamées au cours des 10 dernières années, elles ont perdu cette qualité d’autonomie et d’espace public local. Mais les professionnels du développement des communautés n’avaient pas pour mandat de défendre une structure institutionnelle particulière. Les structures institutionnelles ont été changées mais les communautés restent. Il faut continuer de travailler, dans un nouveau contexte, à outiller et soutenir les leaders locaux, de la société civile ou politique, mais aussi – Transition oblige – de la société économique.((Le concept de société civile incluait à l’origine les acteurs du monde économique mais la puissance acquise par ces derniers ou plutôt la puissances des structures et réseaux dans lesquels ils doivent s’insérer ont amené la société civile à se déployer avec un appui du politique plutôt que de l’économique.))
Les pôles régionaux d’économie sociale de même que certains centres de recherche ou de transfert de savoirs collaboratifs (CRISES, ARIMA, CACIS, CCROC, TIESS… mais aussi quelques CCTT, ces centre de transfert collégiaux découverts à l’ACFAS ) seront peut-être à même de stimuler, orienter les instances publiques résiduelles. Il faudra aussi compter sur ce que Bourque et Lachapelle ont appelé les ICDC((Dans L’organisation communautaire en CSSS, 2010)), des infrastructures communautaires de développement des communautés. La partie « milieu » ne peut être limitée, circonscrite au seul pôle d’économie sociale. Il faudra à ces ICDC un soutien audacieux de la part des fondations philanthropiques, dans l’esprit de ce que proposait Anne Kubisch dans 20 ans d’initiatives de revitalisation au sein de 48 collectivités : « Les fondations sont susceptibles de fournir le financement le plus souple pour les activités liées au développement des capacités d’agir du milieu, tandis que le financement public est susceptible de se limiter à des activités sectorielles. » (p. 96)
Aussi extraits de ce texte, traduit et mis à disposition par Dynamo (ici le pdf complet).
La fonction de bâtir et d’entretenir les liens entre les acteurs locaux et entre la collectivité et les acteurs externes, notamment les entreprises et les organismes publics, doit être mise en évidence et rehaussée comme composante clé de l’action locale. […]
L’action locale ne peut pas à elle seule stimuler les réformes systémiques qui permettent aux résidents de quartiers à faible revenu d’avoir accès à des structures susceptibles d’améliorer leurs conditions de vie. Le domaine doit se doter des moyens de travailler à ces deux niveaux, soit à l’interne et à l’externe. […]
[L]es stratégies visant des réformes politiques plus vastes qui sont axées sur l’affectation des ressources et la réforme des structures qui reproduisent l’iniquité aux États-Unis doivent être activées à une échelle supérieure au palier local.
Ont nourri ma réflexion ces derniers temps :
- La concertation régionale en développement social au Québec à la fin de 2015, Verreault, Lussier et Bourque, Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC)
- 20 ans d’initiatives de revitalisation au sein de 48 collectivités, Kubisch Anne, Patricia Auspos, Tom Dewar et Prudence Brown (traduction et adaptation Dynamo), 2010, (2015 éd. française)
- Impératif transition, Michael Lewis et Pat Conaty, 2012 (2015, éd. française)
- Le défi de l’innovation sociale partagée, Fontan, Klein et Bussières, 2014
- L’innovation sociale, Benoît Lévesque, Jean-Marc Fontan et Juan-Luis Klein, 2014.
Ici le programme détaillé du colloque Austérité ou virage de l’État? Réseaux locaux d’action collective face aux transformations institutionnelles.

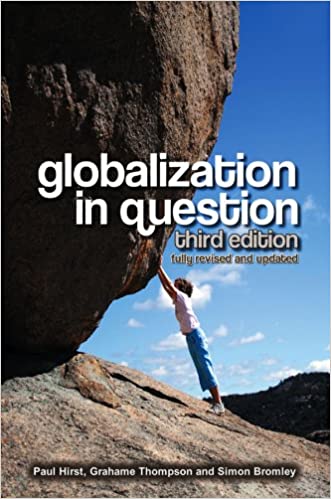
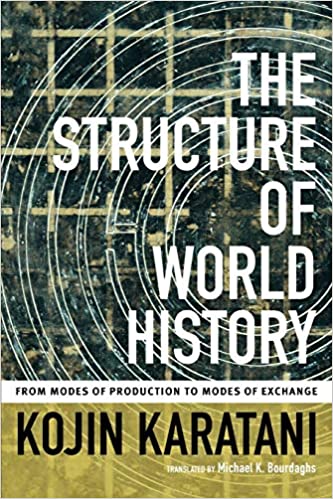

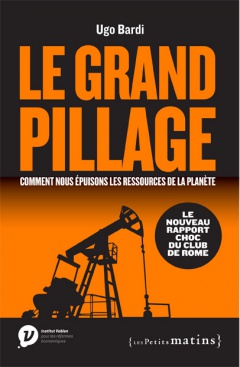
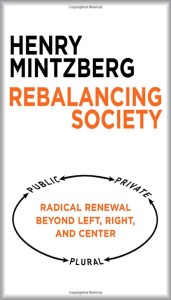
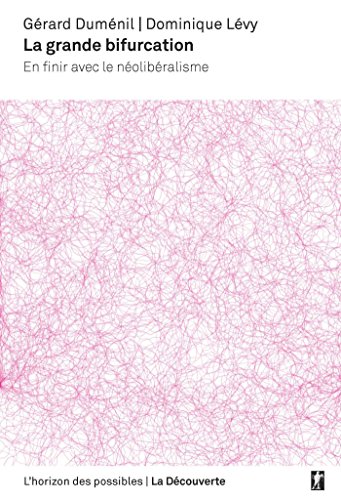


 Le
Le