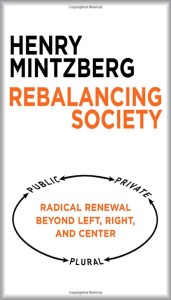« La solution n’est pas d’inventer une nouvelle institution alors que les institutions se sont vidées depuis longtemps faute de société civile active »
Bruno Latour
Cette affirmation de Latour, dans le cadre d’une entrevue du magazine Reporterre, aura été l’impétusqu’il me fallait pour commencer ce billet. Cette affirmation et quelques autres du même genre : « [L]ʼÉtat aujourd’hui est totalement incapable d’anticiper ce quʼil faut faire pour passer du système de production visant le développement à lʼinfini, à un système qui suppose de pouvoir durer sur un territoire viable. » Ou celle-ci, encore plus forte : « [S]avoir si l’on va pouvoir se servir de la crise pour que la société civile s’empare de la situation et plus tard parvienne à «recharger»l’État avec ses nouvelles tâches et de nouvelles pratiques ».
Le phénomène des gilets jaunes en France est le prétexte de l’entrevue, fil jaune qui oriente les questions de l’interviewer alors que les réponses de Latour débordent largement ce phénomène pour poser la question de l’atterrissage de l’humanité, le retour sur terre des humains qui s’étaient envolés grâce à un mode de production insoutenable. (Voir Où atterrir ?) C’est moins à Mai 68 qu’il faut comparer les gilets jaunes qu’aux « cahiers de doléances » du mois d’août 1789. Les protestataires d’aujourd’hui devraient s’inspirer de ces cahiers, dit-il, (voir en annexe de l’article les cahiers de Niort et de Travers), pour formuler des revendications qui soient moins générales que « faisons payer les riches » et une position qui soit moins attentiste à l’endroit de l’État.
J’ai aussi ce sentiment, devant l’urgence et l’ampleur de la Transition nécessaire, que la solution ne peut venir d’en haut. Non pas qu’il ne faudra pas en venir à un plan, à des programmes établis et financés… mais parce que ce plan exigera de chacun de tels engagements et changements qu’il serait contreproductif de vouloir les imposer du dehors ou d’en haut. Il faudra que ces changements viennent du dedans. Ou des voisins, des pairs… de là l’importance de cette société civile, et des organisations de la société civile (OSC). Comme disait Latour :
La transformation de la société, de son infrastructure matérielle, est une entreprise tellement colossale que ce n’est pas quelque chose à demander à l’État, ou au président.
Cependant, valoriser la société civile à l’encontre ou en dénigrant les pouvoirs publics, 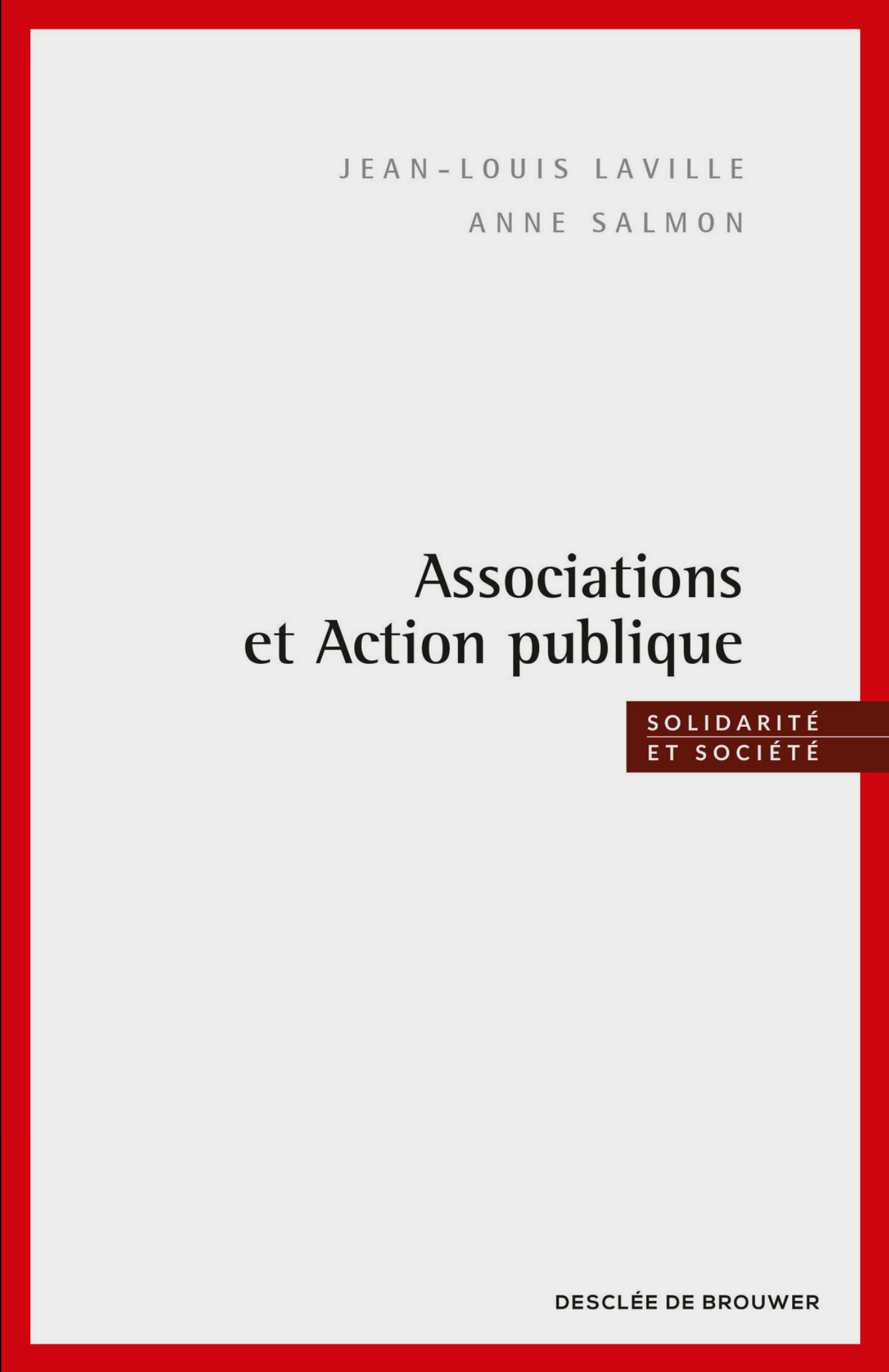
c’est une orientation, un point de vue déjà présent chez Hayek, le maître à penser de nos gouvernements néolibéraux depuis 35-40 ans. Jean-Louis Laville le rappelle bien dans Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise : Governance and Democracy (1) (pages 146-149, 160) et dans Associations et Action publique (2) (pages 551-557, 582, 600). Hayek préfère les mécanismes du marché, de l’agrégation des choix individuels aux mécanismes de la délibération et de l’action collective. Il met en valeur les OSC parce que ça coute moins cher, c’est plus souple, et qu’on les contrôle plus facilement que des programmes et institutions publiques. Laville et Salmon, en s’appuyant sur Habermas, Ostrom, Polanyi et Mauss, montrent que ces OSC peuvent se définir autrement que comme de simples producteurs de services moins chers, et plutôt comme des participantsà la création d’espaces publics, capables d’une action publique qui déborde les formes traditionnelles de l’action politique.
Espace public et économie
Nancy Frasercritique Habermas quand il rejette l’économie hors de la sphère publique. « La rhétorique de l’économie privée exclut certains sujets et intérêts du débat public en les plaçant dans une logique économiste, en considérant qu’ils sont déterminés par les impératifs impersonnels du marché ou qu’ils relèvent des prérogatives de la propriété “privée”, ou encore qu’ils constituent des problèmes techniques pour les managers et les planificateurs. » (3) Toujours citée par Laville (2), Fraser montre le « caractère inadmissible, du point de vue féministe, de la position habermassienne rapportant l’économie et l’État aux systèmes, l’espace public et la famille aux mondes vécus. » (4).
« [P]ar rapport à Habermas qui s’insurge contre la technicisation des débats économiques les soustrayant à la discussion publique, Fraser (5) fait un pas de plus en identifiant la portée des formes économiques alternatives. Comme elle le note ‘ leur mise en débat dans l’espace public n’est pas séparée de ces pratiques mises en œuvre par les personnes concernées. Des activités sont organisées autour de biens communs comme l’eau, la santé sans qu’elles soient dissociables des espaces publics où elles sont abordées ‘. » (Association et Action publique, p. 597).
Il faut inclure l’économie dans l’espace public, non pas l’économie de marché (ou pas seulement) mais l’économie substantive, cette « autre acception de l’économie, qui insiste sur les interdépendances entre les êtres humains et avec les milieux naturels. Cette seconde définition substantive repose sur une anthropologie économique, qui fait alors apparaître des principes de comportements différents du marché, la redistribution où une autorité centrale a la responsabilité de répartir les richesses, la réciprocité qui correspond à la relation établie entre des groupes ou des personnes grâce à des prestations prenant sens par le lien social dont elles attestent, l’administration domestique structurant la production et le partage en vue de la satisfaction des besoins des membres de la famille. » (6)
Cette inclusion, ce réencastrement de l’économie dans la société prend une nouvelle dimension lorsqu’on veut tenir compte non seulement des besoins humains mais aussi des équilibres et besoins d’autres espèces vivantes et ressources de nos environnements. Latour, dans l’entrevue déjà citée : « Il faut refaire maintenant, avec la question écologique, le même travail de réinscription dans les liens et les attachements que le marxisme a fait à partir de la fin du XIXe siècle. Sachant que les êtres auxquels on est relié pour subsister, ce ne sont plus les êtres dans la chaîne de production ou dans les mines de charbon, mais tous les êtres anciennement « de la nature ». Et que c’est beaucoup plus compliqué, et donc, c’est mon argument, beaucoup plus nécessaire. »
Anthropologie et champignons
 C’est à une telle lecture des attachements et liens interespèces, associée à une approche d’anthropologie économique que Anna Tsing se livre avec Le champignon de la fin du monde(7). Et, non, il ne s’agit pas du champignon atomique.
C’est à une telle lecture des attachements et liens interespèces, associée à une approche d’anthropologie économique que Anna Tsing se livre avec Le champignon de la fin du monde(7). Et, non, il ne s’agit pas du champignon atomique.
Il s’agit des champignons matsutake, qui ont la particularité de pousser sur les ruines, dans les forêts détruites. Aussi, l’auteure ira à la rencontre des cueilleurs de l’Oregon, vétérans des guerres américaines ou immigrants sans-papiers, qui vendent chaque soir les fruits de leur cueillette. Sur les ruines des forêts de grands pins Ponderosa, elle étudie comment sont organisés, souvent sur des bases ethniques et culturelles, les échanges d’un produit de luxe, le matsutake, qui se retrouvera finalement dans les épiceries fines japonaises. Son enquête l’amènera en Finlande, au Japon, en Chine, où l’on retrouve chaque fois la destruction d’une ancienne forêt et les conditions précaires de cueilleurs à la recherche d’un champignon qui pousse en relation symbiotique avec les premiers arbres (pins, le plus souvent) qui repoussent sur les ruines. C’est une saga interespèces où s’insèrent une leçon d’économie politique sur la chaine d’approvisionnement dans différents pays et une introduction à la mycologie où sont exposées les relations interrègnes de dépendance entre le monde végétal et celui des champignons.
En conclusion : s’il faut inclure l’économie dans nos débats et concertations, dans nos espaces publics, il faut la saisir dans toutes ses formes (marché, redistribution-services publics, réciprocité-coopération, domestique). La réintégration devenue nécessaire des « externalités » (pollutions, rejets divers, effets sur la nature et la société) dans le calcul des coûts-bénéfices ne pourra se résoudre que par la délibération des parties prenantes. Mais comment tenir compte, faire participer les espèces non-humaines à ces délibérations autour de communs à préserver ? C’est à une question semblable que Lionel Maurel tente de répondre dans une série d’articles sur son blogue S.I.Lex :
- Accueillir les Non-Humains dans les Communs (Introduction);
- Communs & Non-Humains (1ère partie) : Oublier les « ressources » pour ancrer les Communs dans une « communauté biotique »;
- Communs & Non-Humains (2ème partie) : En-deçà des arrangements institutionnels, les « agencements socio-écologiques »
Bonne lecture !
(1) Jean-Louis Laville, Dennis Young, et Philippe Eynaud, éditeurs, Civil Society, the Third Sector and Social Enterprise : Governance and Democracy, Routledge, 2015
(2) Jean-Louis Laville et Anne Salmon, dir, Associations et Action publique, Desclée de Brouwer, 2015
(3) Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et distribution, Paris, La Découverte, 2005
(4) Nancy Fraser, Le féminisme en mouvements. Des années 1960 à l’ère néo-libérale, Paris, La Découverte, 2013
(5) Madeleine Hersent, Jean-Louis Laville et Magali Saussey, entretien avec Nancy Fraser, Revue française de socio-économie, n ° 15, 2015
(6) Jean-Louis Laville, Pleyers, Bucolo, Coraggio, dir., Mouvements sociaux et économie solidaire, page 10, 2017
(7) Anna Lowenhaupt Tsing , Le champignon de la fin du monde, 2017
Articles suggérés :